Il faut parfois s’éloigner de la nef, en humer l’air au large, pour discerner ce qui, dans l’Église, bruisse à bas bruit. Tandis que les archevêques, mitre droite et regard baissé, se réunissent en synodes d’écoute et d’inclusion, une génération se dresse. Elle n’attend plus l’assentiment d’en haut. Elle ne quémande ni validation ni permission. Elle s’agrège, se forme, s’enrôle. C’est là le phénomène le plus singulier, le plus français aussi, de cette dernière décennie : un catholicisme de jeunesse, fervent, identitaire, combatif, qui pousse ses racines dans la terre retournée d’un monde en perte de boussole.
Ce renouveau, les clercs en jean et col romain l’observent avec inquiétude ou condescendance ; les journalistes l’ignorent ou s’en moquent. Mais les chiffres ne mentent pas, ni les foules silencieuses des pèlerins de Chartres, ni les séminaires pleins dans les diocèses amis de la tradition. Ce sont de jeunes hommes et femmes, parfois issus de familles sans religion, qui découvrent dans la messe tridentine une architecture de vérité, un rythme pour l’âme, une beauté qui ne s’excuse pas. Ils n’y viennent pas par mimétisme. Ils y arrivent comme on revient d’exil, après avoir tout essayé, tout consommé, et tout vomi.
Loin des cénacles universitaires, des salons où l’on disserte encore sur l’héritage de Vatican II comme Alain de Benoist parlerait de l’École de Francfort, c’est sur les réseaux sociaux que se propage la foi. L’abbé Matthieu Raffray, par ses appels au « combat spirituel », #bagarrebagarreprière, y suscite l’adhésion d’un public jeune et vigoureux. Le frère dominicain Paul-Adrien d’Hardemare, en hoodie ou en bure, y défend une théologie classique avec une clarté d’instituteur. Ces prêtres de la Toile, pour parler comme un vieux maître de poste, ont compris ce que nombre de prélats ont oublié : que la jeunesse veut du sang, de l’éclat, du sacré, et non des simagrées d’ouverture.
Dans cette effervescence spirituelle qui saisit une frange de la jeunesse occidentale, il serait réducteur de ne considérer que le seul retour au catholicisme. Une autre quête, plus souterraine mais bien réelle, anime certains jeunes Français et Européens : celle d’une religion dite « native », enracinée dans les paysages, les mythes et les rites préchrétiens. Cette aspiration, souvent inspirée par les pratiques païennes de l’Antiquité — qu’elles soient gréco-romaines, celtiques ou germaniques — traduit le désir d’un rapport immédiat au sacré, non médiatisé par l’universalisme chrétien.
Pourtant, cette tentative de retour aux cultes des anciens dieux se heurte à une difficulté de taille : ces traditions, longtemps effacées par la croix, n’ont pas laissé de structures vivantes. En dépit des efforts des anciens du GRECE et de son mouvement de jeunesse, il en résulte souvent un syncrétisme hésitant, où s’entrelacent folklore, esthétique et imaginaire mythologique, sans qu’émerge un cadre religieux pleinement habitable. Là où l’Église offre encore une théologie, une liturgie, un langage du salut, les néo-paganismes tâtonnent encore, portés par la nostalgie d’un âge d’or plus rêvé que retrouvé.Le catholicisme nouveau qui se lève n’est pas tiède. Il n’est pas non plus nostalgique, même s’il se nourrit d’un héritage liturgique multiséculaire. Il est post-sécularisé. Il naît dans un monde désenchanté, non pour se replier, mais pour se battre. Il est la réponse d’une jeunesse qui voit monter un islam politique sur son sol, et un progressisme dissolvant dans ses écoles.
L’un impose, l’autre déconstruit. Face à cela, les jeunes catholiques ne réclament ni réforme, ni aggiornamento. Ils exigent la foi de leurs pères — celle qui sanctifiait les batailles, bénissait les vendanges, et redoutait l’enfer.
Au sein de cette effervescence spirituelle et identitaire, Victor Aubert émerge comme une figure de proue du renouveau catholique chez les jeunes Français de droite. Fondateur et président d’Academia Christiana, il a su fédérer une jeunesse en quête de repères autour d’une vision enracinée du catholicisme et de l’engagement civique. Depuis sa création en 2013, l’association organise des universités d’été, des colloques et des formations qui mêlent enseignement philosophique, pratique liturgique traditionnelle et activités communautaires. Aubert, enseignant en philosophie et père de famille, incarne cette génération qui refuse le relativisme ambiant et aspire à une vie cohérente avec ses convictions.Sous la direction de Victor Aubert, Academia Christiana est devenue un creuset où se forment des jeunes décidés à lier foi, culture et action politique, dans un esprit de transmission et de résistance aux dérives de la modernité. Notons aussi des profils comme celui de Jean-Eudes Gannat que ses apparitions sur TVLibertés comment à rendre populaire. Il illustre un activisme politique identitaire avec un engagement catholique critique à l’égard des dérives de l’institution qui attire lui aussi toute une frange de la jeunesse.
En d’autres siècles, on eût parlé de « réveil ». Aujourd’hui, il s’agit plutôt d’un redressement. Car ces jeunes gens, souvent issus des classes moyennes, voient bien que le discours clérical majoritaire, engoncé dans les concepts de « dialogue », de « périphéries » ou de « fraternité universelle », les exclut par défaut. Leur foi n’est pas faite pour plaire. Elle est exigeante, verticale, hiérarchique. Elle est romaine avant d’être synodale. Et c’est pourquoi l’institution les rejette — avec une rigueur qu’elle n’applique jamais aux théologiens de la dilution.
Le cas de Chartres, où les pèlerins traditionalistes ont été interdits d’entrée dans la cathédrale, est à ce titre révélateur. Quelle peur, quel embarras, pousse des évêques à fermer leurs portes à des jeunes en prière, tandis qu’ils les ouvrent si volontiers aux happenings interreligieux ou aux concerts sous les voûtes ? L’explication est simple : ces jeunes ne flattent pas l’air du temps. Ils rappellent, par leur seule présence, ce que fut la chrétienté. Et cela gêne.Pourtant, c’est là le visage le plus vivant de l’Église en France. Tandis que les autres courants déclinent, que les messes modernes s’étiolent, que les prêtres conciliaires meurent sans successeurs, les communautés traditionalistes recrutent. À Fréjus-Toulon, à Bayonne, dans les maisons de l’Institut du Bon Pasteur ou de la Fraternité Saint-Pierre, les vocations affluent. Ce sont des jeunes gens, souvent passés par des grandes écoles, parfois sortis de familles non pratiquantes, qui choisissent l’autel. Ils ne le font pas pour fuir le monde. Ils le font pour le sauver.
Ce retournement est, à bien des égards, un défi lancé à Rome. Car le pontificat actuel, dans sa volonté d’alignement sur les consensus mondiaux, ne sait que faire de cette jeunesse. Il la craint, il la bride, il la soupçonne d’arrières-pensées politiques. Il oublie que la foi est toujours politique, puisqu’elle engage des corps, des lois, une vision du monde. Le catholicisme, en renaissant chez les jeunes, retrouve sa dimension militante — celle des apôtres, des moines bâtisseurs, des martyrs.
L’Église, si elle veut vivre, devra un jour ou l’autre tendre la main à ces enfants qu’elle a méprisés. Sans quoi, elle continuera de s’étioler dans les conseils pastoraux et les sessions de formation « inclusives ». Car cette jeunesse n’est pas l’Église de demain. Elle est celle d’aujourd’hui, debout, chapelet au poing, le regard tourné vers le ciel. Elle est aussi celle de demain, car ces jeunes forment des familles où l’enfant est attendu, où le berceau est perçu comme une arme de combat civilisationnel.
Il serait erroné de croire que cette jeunesse en quête de verticalité ne se manifeste qu’en France, comme un phénomène d’exception gauloise ou le sursaut isolé d’un vieux pays chrétien. Ce qui se joue ici s’inscrit, en réalité, dans une dynamique plus vaste, un mouvement de fond qui traverse tout l’Occident, du Midwest américain aux landes anglaises, des banlieues romaines aux campus allemands. Si la Bretagne prie de nouveau, l’Ohio aussi. Si Chartres voit revenir ses pèlerins, les églises de Brooklyn rallument leurs cierges. Ce que nous prenons pour une bizarrerie nationale est peut-être, plus profondément, le symptôme d’un retournement de génération à l’échelle de la civilisation. La suite de ce papier propose de quitter les clochers de France pour tendre l’oreille vers les nefs d’Amérique et d’Angleterre, où les mêmes hymnes, longtemps tus, résonnent de nouveau.
Un réveil de l’Occident ?
On croyait que l’Ancien Monde, sécularisé à cœur fendu, avait coupé les ponts avec ses sources vives. L’Europe, disait-on, ne serait plus jamais chrétienne. L’Amérique, à peine mieux lotie, troquait ses églises pour des stades, ses crucifix pour des slogans. Et pourtant — à bas bruit, sans cloches ni carillons — le sol bouge. De Paris à Varsovie, de Londres à New York, une jeunesse revient au tabernacle. Elle n’y revient ni pour l’ethnographie, ni pour le folklore : elle y revient pour y vivre. Et ce mouvement, qui dépasse les frontières et défie les statistiques, mérite d’être pris au sérieux, non comme un caprice passager, mais comme une réaction profonde à l’effondrement spirituel de nos sociétés.
Le New York Times, fidèle à son rôle de grande tisseuse de frivolités, croyait avoir flairé un caprice de mode lorsqu’il nota que certaines jeunes femmes, souvent proches du Parti républicain, arboraient désormais un crucifix au cou. Le journal, trop pressé pour écouter, supposa qu’il s’agissait là d’un bijou parmi d’autres, un « hot accessory » comme un autre, banal signe de distinction dans une époque postmoderne. Ce qu’il ne vit pas — ou feignit de ne pas voir — c’est que ce retour du crucifix dans l’espace public ne relevait ni de l’ironie, ni du simulacre. Il est, pour beaucoup, un acte de foi, non une parure. Et cette foi n’est pas un supplément d’âme, mais une réponse.
Depuis 2021, aux États-Unis, on observe un retour net de l’engagement chrétien chez les jeunes générations. Une étude de l’institut Barna, peu suspecte de mysticisme, relève une augmentation de douze points du nombre d’adultes déclarant avoir « pris un engagement personnel envers Jésus ». Ce basculement est porté par la génération Z et les millennials : ceux-là mêmes que l’on disait livrés au nihilisme numérique, repliés sur eux-mêmes, condamnés à l’éternel scrolling. C’est l’inverse qui advient : ces jeunes, confrontés à l’atomisation sociale, à la détresse mentale et à l’effritement des liens communautaires, se tournent vers l’Église comme on revient au foyer après un long hiver.
Le confinement, cet épisode de claustration imposée, a joué le rôle de révélateur. Il a ôté à la jeunesse ses rituels d’intégration, ses promesses de mondanité, ses ivresses douces. Il n’est pas étonnant, dès lors, qu’une partie d’entre elle ait cherché non pas l’évasion, mais le sens. À New York, dans les quartiers qu’on croyait définitivement livrés à l’indifférence religieuse, des paroisses prospèrent, des jeunes hommes se font baptiser, communient, entrent en catéchuménat. Une génération d’incrédules se fait instruire. Et, chose impensable pour les chantres du progrès linéaire, l’on voit se confirmer, de l’autre côté de l’Atlantique, les mêmes tendances qu’en France : une jeunesse revient au Christ non pour suivre la foule, mais pour lui désobéir.
Le phénomène est encore plus marqué chez les jeunes hommes. Ce sont eux qui, majoritairement, mènent cette reconquête intérieure. Dans une époque qui ne cesse de pathologiser leur virilité, de suspecter leur désir, de leur interdire toute posture verticale, l’Église apparaît comme le dernier lieu où l’on peut encore être un homme sans s’en excuser. On y apprend la maîtrise de soi, le don de soi, la protection des faibles. Loin des caricatures, c’est une masculinité fondée sur le service, non sur la domination, qui s’y transmet. Le succès fulgurant de figures comme l’évêque Barron ou le père Mike Schmitz, prédicateurs catholiques sur les réseaux sociaux, témoigne de cette soif d’enracinement.
La culture générale anglo-saxonne, souvent en avance de phase, donne des signes étonnants. Porter une croix y devient un signe codé de conservatisme, un clin d’œil muet à ceux qui refusent les diktats de l’idéologie dominante. Car c’est bien là le point nodal : le retour à la foi est un acte de subversion dans un monde saturé de conformisme progressiste. Ce n’est plus en arborant des piercings ou des slogans que l’on choque, mais en priant son chapelet, en allant à la messe, en jeûnant le vendredi. La provocation, aujourd’hui, c’est la liturgie. Et l’ordre du monde s’en trouve ébranlé.
Cette révolte contre le nihilisme prend les atours du dogme. Elle est d’autant plus efficace qu’elle ne cherche pas à séduire. À ceux qui vivent dans le simulacre, la génération montante oppose le réel. Dans une société où la sexualisation précoce est vantée, où des chanteuses simulent la débauche sur scène, où Biden a nommé à son gouvernement un hommes aimant se déguiser en chien, le catholicisme redevient un contre-monde. Il n’est pas seulement doctrine : il est refus, il est armature, il est muraille.
Comme l’a dit un comique américain avec une justesse imprévue : « Aujourd’hui, pour être subversif, il faut être catholique. Il faut faire son rosaire comme jadis on arborait sa crête iroquoise. » C’est cette vérité que n’osent affronter les éditorialistes du consensus : la foi est redevenue la seule forme de dissidence tolérable, car elle est à la fois plus ancienne que l’ordre établi et plus haute que ses simulacres.
Ce réveil touche aussi le Royaume-Uni, où les statistiques indiquent un retour discret mais réel de la pratique religieuse chez les jeunes. Les écoles catholiques y sont en tension d’effectif. Les universités y voient émerger de nouveaux cercles d’études chrétiennes. Les intellectuels de droite, naguère hostiles à toute transcendance, redécouvrent Chesterton ou Newman. Ce n’est pas un retour en arrière. C’est une évasion en avant, vers un autre ordre des choses.
Loin de n’être qu’un phénomène national, le retour à la foi des jeunes Français s’inscrit dans une trame occidentale. Et si cette génération tient tête à la tempête, c’est parce qu’elle a su raviver les foyers du sacrifice, de l’obéissance, et de la contemplation. Ce n’est pas un raz-de-marée, mais une source souterraine. Elle ne submerge pas. Elle irrigue.
L’Église, dans son incarnation romaine, devra s’en souvenir. Car ce que les évêques ne veulent plus proclamer, ce sont les enfants perdus de la modernité qui le rediront. En latin, s’il le faut. Et dans le silence des églises où l’on ne joue plus de guitare.
Balbino Katz
Illustration : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine









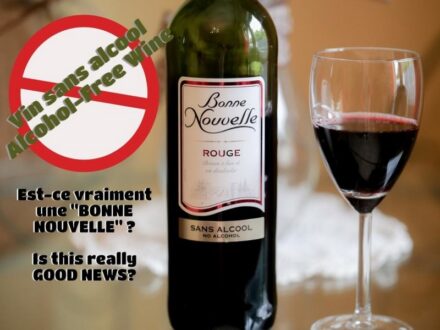




6 réponses à “Catholiques. Le retour des enfants prodigues d’Occident”
Franchement j ai a peine survolé l article ,,l age ? (73),le cancre incurable ? Mais n etant pas catholique ,appreciant toutefois les integristes ,les eveilleurs comme Escada ,Marion Sigaut ,Pierre Hillard etc ,je leur porte tout mon respect et admiration .Nous sommes a la phase Révélation ,eschatologique ,l intervention de Dieu est imminente .Nous assistons donc a la « techouva »pour certains ,au retour a Dieu pour d autres .C est trenscendant ,et vu que les anges sont chargés de marquer chacun selon sa position en vue de l intervention divine prochaine j ose esperer que Dieu permet aux bonnes ames de se mettre a l abrit sous sa bienveillance ,et alors les cavaliers seront lachés ,,
Comme toujours don Balbino nous a servi une pièce de choix et en effet les temps changent mais que de dégâts depuis une banale mise à jour et on assista au départ des tièdes et nous cassâmes pour célébrer la communion des copains, pâté de campagne, gros rouge genre Sidi Brahim, de même avec JIC, JEC,JOC, JAC…la Vie Montante est devenue vie descendante! Quelle débandade! L’abbé Raffray doit être originaire de la Manche (50) comme furent Ory, Lehérissey, Aubert, Gobert, Levasseur et combien d’autres…
Tristan, tout ça pour ça, quel retournement de veste !
Cher Balbino, bravo pour cette étude approfondie qui décrit avec beaucoup de pertinence ce mouvement de fond qu’est objectivement le retour au catholicisme de la jeunesse des sociétés occidentales déchristianisées.
Je me permets néanmoins de vous apporter la contradiction sur la part subjective de votre analyse : le ressort profond de ce renouveau catholique. Je pense en effet que vous appliquez à ce phénomène de conversions un filtre identitaire, légitime mais imparfait pour saisir ce qui touche à l’intimité de l’âme.
Si j’ai bien compris votre pensée, cette dernière est contenue dans votre phrase « Une jeunesse revient au Christ, non pour suivre la foule mais pour lui désobéir. » Pour moi, c’est là que le bât blesse. Non pas parce que dans l’absolu ce ne devrait de toute façon pas être le cas – la vraie conversion se fait par rapport au Christ, pas vis-à-vis de la foule ! – mais parce qu’il me semble que ce n’est pas le cas dans la réalité.
Vous parlez avec justesse de l’excellent travail accompli par Academia Christiana mais vous semblez en faire un passage obligé pour tous les nouveaux convertis. Or, sur les 18000 nouveaux baptisés de Pâques, je ne suis pas certain que beaucoup soient passés entre les mains de l’excellent Victor Aubert. De la même façon, vous citez le pèlerinage de Chartres, un succès objectif d’autant plus impressionnant qu’une partie – une partie seulement – de l’Église sort les griffes à sa seule évocation. Mais existent également le Frat, les Journées mondiales de la jeunesse, les forums de la communauté de l’Emmanuel et les centaines d’événements diocésains organisés chaque année, qui ne proposent pas la messe Tridentine mais rencontrent pourtant eux aussi de francs succès, hors de tout ressort culturel – j’exclus donc de cette liste les pardons bretons.
Permettez-moi d’insister sur deux points. Premièrement, le renouveau du catholicisme par la jeunesse n’a heureusement pas pour moteur les seules questions identitaires – à la différence du mahométisme par exemple. C’est parce qu’être catholique est avant tout une question de foi et non de pratique que le catholicisme vivra au-delà de toutes les civilisations humaines. Deuxièmement, la « fraternité universelle », si dévoyée que soit cette expression par la lecture progressiste qui en est souvent faite, est non seulement authentiquement catholique mais est également compatible avec un enracinement identitaire des fidèles. Le catholicisme est la religion de l’Incarnation, c’est valable pour le Christ, Dieu fait homme pour renouer l’Alliance avec l’humanité, mais c’est aussi bon pour les fidèles, nécessairement incarnés dans un espace géographique donné, une culture, une civilisation.
Oui, un commentaire très juste. On a tendance à voir midi à sa porte. C’est bien d’élargir al perspective et encourager les lecteurs à regarder tout le tableau et pas seulement la partie qui nous plait le plus.
Oui, un commentaire très juste. On a tendance à voir midi à sa porte. C’est bien d’élargir al perspective et encourager les lecteurs à regarder tout le tableau et pas seulement la partie qui nous plait le plus.