Du 11 juin 2025 au 11 janvier 2026, l’Institut du monde arabe à Paris consacre une grande exposition à Cléopâtre VII, dernière souveraine de la dynastie lagide. Intitulée Le mystère Cléopâtre, l’exposition propose un parcours dense et documenté pour tenter de démêler les faits de la fiction autour de celle qui fut à la fois cheffe d’État, stratège politique et figure de fantasmes occidentaux.
Une reine historique au cœur d’un récit romanesque
Née en 69 av. J.-C., Cléopâtre VII a régné sur l’Égypte jusqu’à son suicide en 30 av. J.-C., après la défaite d’Actium face aux forces d’Octave. Alliée successivement de Jules César puis de Marc Antoine, elle a su s’imposer comme une dirigeante habile dans un monde dominé par Rome. Mais sa mémoire a été vite brouillée : diabolisée par la propagande impériale romaine, fantasmée par les auteurs de tragédies et de récits populaires, la Cléopâtre réelle s’est peu à peu effacée derrière une figure de légende.
L’exposition réunit près de 250 œuvres – sculptures antiques, tableaux, objets d’art, films – pour dresser un portrait nuancé de la reine. Elle met en regard les recherches archéologiques et historiques les plus récentes avec la profusion d’interprétations qui, depuis l’Antiquité, n’ont cessé de remodeler son image. On y découvre comment l’icône féminine a été perçue tour à tour comme une déesse orientale, une séductrice vénéneuse, une mère érudite, une reine résistante ou une figure de la liberté.
Une légende façonnée à travers les siècles
Alors que les Grecs et les Égyptiens antiques l’honoraient comme une déesse, les auteurs romains, dans le sillage d’Auguste, en firent une femme débauchée responsable de la chute de Marc Antoine. Plus tard, les écrivains arabes du Moyen Âge la représenteront sous des traits plus nobles, érudite et protectrice de son peuple. À partir du XVIe siècle, sa figure est réinventée en Occident, notamment au théâtre, avant de devenir un objet de fascination cinématographique à l’ère des images de masse.
Sarah Bernhardt, puis Elizabeth Taylor, propulseront ainsi Cléopâtre dans l’imaginaire collectif, en héroïne tragique autant qu’en reine de beauté. Cette glorification n’est toutefois pas exempte d’instrumentalisations : Cléopâtre est devenue tour à tour symbole féministe, icône noire dans les luttes afro-américaines, incarnation de la résistance anticoloniale égyptienne, ou encore marque publicitaire.
L’exposition tente ainsi de faire le tri entre ces lectures multiples et parfois contradictoires. Elle souligne l’ambiguïté d’un personnage dont la modernité tient justement à cette plasticité : Cléopâtre fascine parce qu’elle échappe aux catégories toutes faites. Elle fut sans doute la première reine à s’adresser à ses sujets dans leur propre langue, une diplomate aguerrie, une stratège soucieuse de préserver l’indépendance de son royaume dans un monde en bascule. Et sa mort, bien loin de clore son histoire, a ouvert la voie à une mythification sans fin.
Toutes les informations sur l’exposition ici
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine












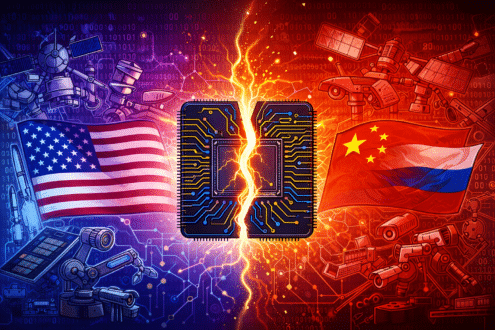

6 réponses à “Cléopâtre s’invite à Paris : une exposition-événement à l’Institut du monde arabe”
Que fait Cléopâtre à l’Institut du monde arabe ? Arabe, elle ne l’était pas, les Arabes n’ayant pas encore fondu sur l’Egypte. L’Egypte appartenait au monde hellénistique, et Cléopâtre – d’origine macédonienne – parlait grec, même si elle connaissait (probablement) le démotique. Qu’elle soit reléguée à l’IMA plutôt qu’au Louvre ou au Grand Palais en dit long sur le conformisme (l’antiféminisme ?) de nos conservateurs. Comme Aliénor d’Aquitaine, autre femme libre, Cléopatre est une victime d’historiens serviles, et pire encore des pieds plats qui lisent de travers les historiens !
Effectivement cette exposition est une facon d’arabiser la civilisation égyptienne. Cléopâtre était greco-berbère, comme sa fille Selene, reine de Mauretanie.
La France a toujours tendance à enrichir l’arabité, qui n’est rien d’elle meme. Cette institut du monde arabe construite a Paris, gérée par la France, pour humilier les kabyles de l’académie berbere que Giscard avait jeté en prison.
La continuité de la tres belle civilisation francaise.
Une façon comme une autre pour les Arabes de se construire l’Histoire d’un passé vertueux, civilisé, humaniste sur le dos d’un pays qu’ils ont fini par islamiser aux 3/4 persécutant toujours les Chrétiens coptes orthodoxes puis en créant le mouvement fondamentaliste des Frères Musulmans en 1928 et dont le projet est de conquérir le Monde.
Il faut bien reconnaître que depuis l’invention de l’Islam par Mohamed « l’analphabète » vers l’An 620, la « Civilisation Arabe » n’a guère apporté grand chose au progrès de l’Humanité, voire même l’a fait régresser.
Heureusement que Allah dans sa bonté leur a laisser de grands champs pétrolifères (mis en valeur par la technologie occidentale), parceque sinon ils en seraient resté à l’ère des bédoins avec leurs.chameaux.
Quel rapport entre Cléopâtre et le monde Arabe ? Presque sept siècles se sont écoulés entre sa mort et l’avènement du prophète qui rime avec conquête (sanglante, bien entendu).
Un tableau de Cléopâtre nue sera-t-il exposé à l’IMA ? Ce serait un vrai progrès pour aller dans le bon sens: abandonner le voile, empêcher les femmes de ressembler à des fantômes et les soustraire à l’emprise de cette religion d’intolérance. Vive la Femme Libre, par Allah je vous le dis tout haut!
L’islam n’est pas inventé, mais est un syncrétisme des différentes sectes chrétiennes unitaristes. Mohamet, lui, est inventé pour calomnier un dignitaire unitariste. L’histoire de l’islam et de l’arabe est la plus sérieuse falsification de l’humanité.
Nous constatons aujourd’hui meme les manœuvres pour construire un monde arabe, mais le commun continu à légitimer les mensonges des falsificateurs.
Mohamet est une figure litteraire. Personne ne l’a vu. De meme la Mecque dans le Hijaz est une pure invention. Au moyen age, personne ne la connaissait…Il ne y’a pas une pierre qui temoigne d’une vie dans ce desert.