Le 21 mai dernier, dans le cœur battant de la Maison-Blanche, sous les moulures compassées du Bureau ovale, s’est tenue une réunion d’une rare intensité politique. Le président américain Donald Trump y reçut son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, pour une entrevue qui, loin d’être tragique ou grotesque, fut d’une clarté brutale et salubre. Car il ne s’agissait plus ici de liturgie diplomatique ni de ce théâtre creux qu’affectionnent les chancelleries. Trump, en stratège de la dramaturgie médiatique, choisit ce moment pour exposer, sans fard, la réalité d’une persécution ignorée : celle des fermiers blancs sud-africains, victimes d’une violence ciblée, obstinément passée sous silence par les élites médiatiques.
Les images projetées dans le Bureau ovale ne prétendaient pas illustrer un point de vue, elles démontraient. On y voyait Julius Malema, tribun haineux de l’EFF, vociférant son fameux « Kill the Boer! », ainsi que des routes bordées de croix blanches, témoins muets de la terreur rurale. Ces scènes, captées sans montage ni artifice, disaient ce que l’on tait : dans l’Afrique du Sud post-apartheid, les Boers sont devenus les parias, cibles désignées d’un ressentiment qui a désormais force de loi tacite. Loin de toute complexité prétendue, ce pays est en faillite morale, institutionnelle, et bientôt, peut-être, territoriale.
Ramaphosa, embarrassé, tenta de faire bonne figure. Il s’abrita derrière des figures bien comme il faut de l’establishment boer – Ernie Els, Retief Goosen, Johann Rupert – pour maquiller l’évidence. Trump, implacable, exigea que l’on regarde la vérité en face. Ce ne fut pas un dialogue : ce fut un procès. Et les preuves étaient là, sous les yeux de tous.
L’attitude des journalistes présents fut à cet égard révélatrice. Une journaliste de NBC chercha à imposer le narratif usuel, celui d’un Occident coupable par essence, et de Blancs qui, même assassinés, restent suspects. Trump, fidèle à son style, l’interrompit sèchement et dénonça l’aveuglement idéologique de sa chaîne. Il avait raison. Car c’est bien cela, le fond de l’affaire : la presse occidentale, engoncée dans la haine de soi, refuse de voir ce que toute conscience libre devrait pourtant reconnaître — une minorité blanche, historique, enracinée, se trouve persécutée dans l’indifférence générale.
Les grands journaux — Le Monde, Libération, Le Figaro, The New York Times — n’ont pas investigué, ils ont balayé. Ils ont réduit l’épisode à une « mise en scène », évitant de confronter les faits, préférant gloser sur les manières de Trump plutôt que d’examiner ce qu’il montrait. La plupart d’entre eux omettent systématiquement les données sur les meurtres dans les campagnes sud-africaines, comme si le fait même d’être un fermier blanc annulait toute prétention au statut de victime. Cette asymétrie révèle moins un oubli qu’un programme : celui de l’occultation systémique.
Il faut ici rappeler que la vérité n’a pas besoin d’être agréable pour être reconnue. L’hostilité contre les Boers n’est pas une fiction : elle est attestée, répétée, exaltée même par des figures politiques de premier plan. Le fait que le parti de Julius Malema rassemble des milliers de partisans dans des stades, que ses slogans ne soient pas poursuivis par la justice, suffit à démontrer que cette haine ne relève plus de la marginalité.
Un article du Financial Times, plus mesuré dans la forme, apporte pourtant un contrepoint utile. Il rappelle que nombre d’Afrikaners, bien que confrontés à une criminalité endémique, ont su s’adapter à leur statut minoritaire. Certains ont prospéré, d’autres se sont repliés sur eux-mêmes, mais la majorité reste. Ce ne sont pas des exilés volontaires, ce sont des hommes enracinés. Et ceux qui quittent la terre de leurs pères, ne le font pas par caprice, mais par nécessité. Le ressentiment n’est pas un délire ; il est nourri par les slogans, les lois de confiscation sans indemnisation, les discriminations ouvertes dans l’accès à l’emploi et à l’éducation. Que cela s’appelle encore « démocratie » est un tour de passe-passe sémantique.
Trump, dans cette affaire, n’a pas révélé une vérité cachée : il a crié une évidence que d’autres taisent. Sa manière peut choquer, sa brutalité déranger, mais ce qu’il dit ne mérite ni le mépris ni l’indignation morale. Il faut être d’une naïveté historique sans bornes pour croire qu’un pays bâti sur l’antagonisme racial pourrait pacifier ses plaies sans effort, sans douleur, sans injustice nouvelle. L’Afrique du Sud, aujourd’hui, ne guérit pas — elle inverse les rôles. Et dans cette inversion, certains veulent voir une justice ; d’autres y reconnaîtront les prémices d’un désastre.
Le rôle des médias serait d’éclairer ces tensions, non de les couvrir d’un vernis idéologique. Tant qu’ils persisteront à nier l’évidence, à criminaliser les inquiétudes des peuples européens — qu’ils vivent à Pretoria ou à Brest — ils s’excluront eux-mêmes du débat et perdront ce peu de crédit qu’il leur reste.
Balbino Katz — chroniqueur des vents et des marées —
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



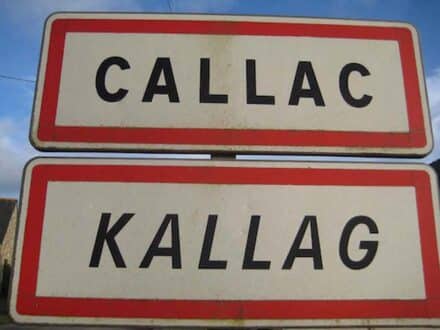

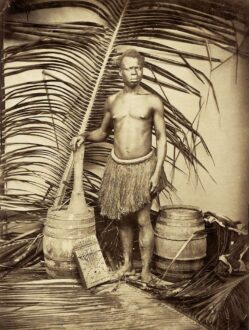





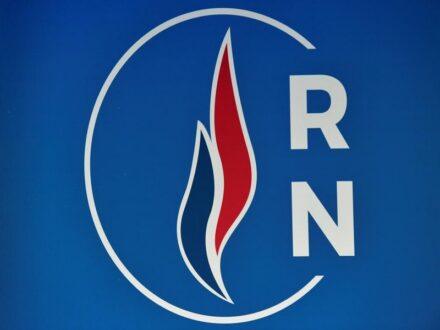


9 réponses à “Trump, Ramaphosa et le spectre des Boers”
Comme d’hab ces médias mainstream sont à gerber. Heureusement on a Breizh info et les autres.
Analyse très juste qui pourrait s’appliquer également à d’autres conflits.
La démographie bantoue doit énormément aux fermiers boers qui inlassablement nourrissent l’Afrique, sans jamais y renoncer.
Article excellent de Balbino Katz, qui ne prêche que la vérité.
Pour ceux qui ont connue l’Afrique du Sud du temps des Boers et constatent l’état aujourd’hui de ce pays qui était le Leader économique incontesté de toute l’Afrique, comme on dit, il n’y a pas photo.
Le constat est simple (Et les exemples, surtout en Afrique, ne manquent pas) : Le Noir africain (Pour ne pas parler la race negroïde) est incapable de gérer quoique ce soit. Pourquoi ? Parce que, bien que la bienséance se refuse de le dire, il y a un abîme incommensurable entre la race blanche et la race noire.
Et Trump, qui est un des rares dirigeants dans le monde à s’attabler aux vrais problèmes de notre planète, et évite de s’empêtrer dans un discours fallacieux qui ne dit pas la vérité, a totalement raison de mettre le doigt sur ce qui fait mal, et que l’on veut éviter de voir.
Et tout autant, mes félicitations à Albino Katz, pour, comme il le dit lui-même, de ne pas s’enferrer dans un discours qui nie l’évidence, et qui pousse à criminaliser les inquiétudes des peuples européens.
Le reve ,une partition du globe ,,les croyants judeochretiens ,civilisés d un coté et de l autre ,,les paiens ,loosers ,malfaisants disciples du diable ,Ce n est pas un reve ,,Dieu l a promis ,le Monde futur sous la direction du Messie ,Les mauvais seront eradiqués ,reduits en poussiere ,Et les bonnes ames sur la terre eternellement restaurée en paradis .
Les grands journaux « n’ont pas investigué », écrivez-vous. Plusieurs l’ont fait dans la presse anglo-saxonne, et aussi Le Monde en anglais. Assurément, il faut éviter de « gloser sur les manières de Trump » et considérer les faits. Selon les données de la Transvaal Agricultural Union of South Africa, principale organisation de défense des fermiers blancs d’Afrique du Sud, 23 fermiers blancs ont été assassinés en 2024 (et aussi 9 fermiers noirs, signe que certaines agressions sont crapuleuses et non racistes). C’est beaucoup, évidemment, mais parler de « génocide » comme le fait Trump est injustifié. On disait que Biden était gâteux quand il se trompait sur le prénom de ses fils. Et dire « génocide » au lieu de « assassinats », ça dénote quoi ?
L’Afrique du Sud, c’est le « S » des « BRICS »..
Saisissant constat. Heureusement qu’il existe encore des possibilités de dénoncer des vérités que tous les déniologues qui forment toute l gauch et nombre de médias s’efforcent à tout prix de cacher. Un grand merci.
L’oeil était dans la tombe et regardait Caïn…