En ce dimanche de Pâques, alors que la lumière filtrée des nuées océaniques ourlait les pavés mouillés de la vieille ville close de Saint-Malo, j’ai assisté à la messe de 10h30 en la cathédrale Saint-Vincent, haut lieu de mémoire et de recueillement pour les Malouins, mais aussi témoin muet des soubresauts de l’histoire européenne. Je venais, comme il m’arrive de le faire depuis quelques années, d’accomplir un détour méditatif à la nécropole du Mont d’Huisnes. Ce monument singulier, souvent ignoré des guides et des manuels, honore notamment les morts civils allemands en France entre 1944 et 1946 – enfants, femmes, vieillards – dont la dépouille repose dans la terre française, captifs d’une époque dont les haines s’étaient faites industrielles.
Ce lieu, suspendu au-dessus de la baie du Mont-Saint-Michel, dit à sa manière que les tragédies historiques ne se bornent pas à la version des vainqueurs. L’histoire, aurait pu dire Ernst Jünger, est toujours tragique dès lors qu’elle oublie le destin au profit du verdict.
Dans la nef encore clairsemée de la cathédrale Saint-Vincent, j’ai d’abord été frappé par le silence, ce silence dense que seules les pierres ayant connu le feu conservent. Ravagée en 1944 par les bombardements, elle fut restaurée avec un soin et une fidélité à la verticalité gothique qui témoignent d’un savoir-faire que notre époque, si désinvolte avec ses héritages, répugne trop souvent à reconnaître. Dans le transept sud, une fresque nouvelle d’Augustin Frison-Roche déploie ses bleus céruléens dans une lecture apocalyptique d’inspiration byzantine : le Christ à cheval tel le roi Arthur, la Vierge, la Jérusalem céleste, autant d’archétypes suspendus entre le monde sensible et l’éternel. Une œuvre que je ne qualifierais ni de «moderne» ni de «traditionnelle», mais d’eschatologique. Il ne s’agit plus de décorer : il s’agit de réveiller.
Au fil des minutes, la cathédrale se peupla : des familles, des enfants turbulents, des vieillards dignes, un peuple invisible dans les statistiques mais bien réel. Cette foule jeune venue d’outre les remparts – car peu résident encore intra-muros – reflète une vérité sociologique que nos élites oublient : ce n’est pas dans les cénacles des beaux quartiers que l’Église se régénère, mais dans les marges, les franges, dans ces périphéries dont parlait Carl Schmitt en évoquant les lieux d’où l’histoire rejaillit toujours par surprise.
L’entrée du curé, jeune et portant beau, accompagné d’un abbé plus âgé (on saura plus tard qu’il vient d’Argentine), fut sobre. Ni triomphalisme ni mièvrerie. Une liturgie selon le rite de Paul VI, chantée, rythmée, participée. Loin de ces liturgies dépouillées à l’excès, où l’on cherche la foi dans le néant décoratif, celle-ci respirait la ferveur simple et populaire. On y chantait juste, avec cœur ; les enfants s’agitaient, mais sans désordre. Dans le choeur, un homme jeune tenait sa partition d’une main et de l’autre cherchait à maintenir sa petite fille en équilibre sur ses épaules. Il me rappela cette pensée inspirée de Spengler : « Chaque culture renaît par ses enfants avant de mourir par ses élites. »
L’homélie du curé fut, me semble-t-il, d’une intelligence pastorale rare. Sans céder aux sirènes du traditionalisme rigide ni aux dérives molles du progressisme liturgique, il rappela avec pédagogie que la liturgie a toujours évolué et que figer la forme revient parfois à trahir le fond. Une leçon de bon sens et d’histoire, délivrée avec calme, à mille lieues des querelles hystériques qui enflamment les réseaux et que le gros des fidèles ignore superbement.
L’instant de la communion, recueilli, ordonné, révélait une autre chose : la jeunesse nombreuse qui s’avançait vers l’autel. Preuve que les sacrements sont conférés tôt, parfois très tôt, comme l’avait souhaité Pie X dans son décret Quam Singulari.
Sur le parvis, alors que les familles reprenaient le chemin de leur quotidien, j’ai pu m’entretenir avec l’abbé argentin, un esprit rare, thomiste réputé, qui séjourne en Europe pour nourrir une étude sur Celse, ce philosophe romain païen qui, dès le IIe siècle, avait discerné dans le christianisme un ferment de dissolution pour l’Empire. Celse n’était pas sans analogies avec les essayistes d’Éléments ou de Krisis : ceux pour qui le retour du religieux ne saurait être qu’un épiphénomène de la décadence ou un symptôme du ressentiment.
L’abbé me confia, en toute simplicité, que cette messe bretonne avait pour lui plus de signification que bien des colloques ecclésiologiques : il y avait vu l’Église vivante, incarnée, enracinée dans le terreau populaire, bien loin du nadir où il avait trouvé l’Eglise de France dans son dernier voyage dans les années 1990.
Le prêtre criollo n’avait pas tort. Que l’on veuille ou non, cette résurgence n’est pas une illusion d’optique. Il y a quelque chose de souterrain à l’œuvre, quelque chose que les indicateurs sociologiques ne captent pas encore. Une lente remontée. Un réveil discret. Comme ces marées bretonnes que l’on croit apaisées, mais qui, sans bruit, gagnent un à un les degrés des quais.
Au fond, cette messe à Saint-Malo m’a rappelé ce que m’avait dit autrefois Guillaume Faye : « Ce n’est pas la liturgie qui sauvera la foi, c’est la foi qui sauvera la liturgie. » Encore faut-il que cette foi soit vécue comme un engagement total, non comme une habitude culturelle. Or, les jeunes présents en cette cathédrale semblent bien porter cette exigence, à leur manière, sans bruit, loin des débats stériles.
Ainsi donc, en cette fin de mai, entre mémoire des morts d’un autre temps et promesse des vivants dans nos murs, la Bretagne m’a offert, à sa façon, une preuve que le monde ancien n’est pas tout à fait mort, et que, peut-être, le monde nouveau ne sera pas tout à fait orphelin.
Balbino Katz — chroniqueur des vents et des marées —
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine












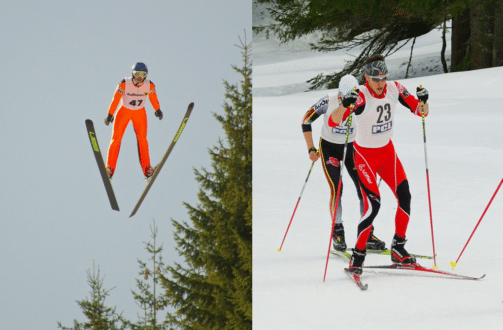

2 réponses à “Renaissance liturgique en terre bretonne : une messe dominicale à Saint-Malo”
Quand dès la première phrase le « je » apparaît et fleurit, on sait qu’on a affaire à l’éditorialiste Bambino Katz!
Amusant notre ami JLP!!! Il a l’oeil. Don Balbino me fait penser à un professeur de nationalité argentine qui ayant reçu l’hospitalité en France nous donnait des cours sur Gongora et le Gongorisme. Ce brave m’avait déclaré spécialiste du Gongorisme!