À Washington, il est une statue que l’on oublie trop souvent. Dans un coin discret du Musée national de l’air et de l’espace, un buste figé de Charles Lindbergh, le regard perdu au-delà de l’Atlantique, accueille les rares visiteurs qui daignent encore s’arrêter devant lui. Ce visage d’airain, impassible au long des décennies d’alignement atlantiste aveugle, aurait pourtant, ces jours-ci, esquissé ce que l’on pourrait appeler un soutire : un sourire tiré d’entre les mâchoires du bronze, presque imperceptible, mais bien réel pour qui sait voir.
Car voici que souffle un vent nouveau sur les rives du Potomac. Le Washington Post, sous la plume de Terell Wright, rapporte dans un article daté du 30 juin une évolution silencieuse mais décisive : la jeunesse républicaine américaine se détourne de l’orthodoxie pro-israélienne qui a longtemps tenu lieu de catéchisme dans les rangs conservateurs. Ce sont les campus qui bruissent de cette dissidence, et non les think tanks. À Miami University, à Xavier College ou à Saint Mary’s, les jeunes voix conservatrices ne se reconnaissent plus dans le soutien inconditionnel à l’État hébreu. Elles redécouvrent une vieille musique, celle du America First, que chantait Lindbergh à la veille de l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, au grand scandale des élites de la côte Est.
Un étudiant de Xavier, Josiah Neumann, résume avec aplomb cette nouvelle disposition : « Pour être America First, les étoiles et les bandes doivent passer avant l’étoile de David ». Tout est dit. On n’aurait pu entendre pareille déclaration, du moins sans dommages, dans les années Bush. L’Amérique change, et ce changement ne vient pas de ses élites, mais de ses marges : de ses jeunes, connectés non plus à la grosse presse mais aux médias alternatifs, comme le rappelle Andrew Belcher, président du club républicain de Miami University.
Le journaliste Terell Wright évoque avec nuance ce glissement d’opinion : non pas un rejet d’Israël en tant que tel, mais un désenchantement face à la surenchère militaire, à l’usage des fonds publics, et au spectacle de Gaza réduite en poussière sous les bombes américaines portées par d’autres. Ce désenchantement n’est pas nourri par une hostilité viscérale, mais par une perception renouvelée du monde et du rôle que l’Amérique doit y jouer. Même au sein des cercles chrétiens conservateurs, autrefois inconditionnels du sionisme, la parole se libère : « Ce ne sont pas les enfants qui ont demandé cette guerre », dit une jeune militante républicaine de l’Indiana. La compassion pour les civils gazaouis n’est plus un monopole des progressistes.
Quand le Musée de l’air et de l’espace, à côté du buste de Lindbergh, osera consacrer une salle à l’attaque du USS Liberty, ce navire espion américain frappé par l’armée israélienne en juin 1967 au large du Sinaï, alors on pourra dire que l’Amérique a véritablement changé. Ce jour-là, sous un ciel d’azur et de sang, des chasseurs et des torpilleurs israéliens s’acharnèrent durant plus d’une heure sur ce bâtiment battant pavillon américain, causant la mort de 34 marins et blessant 171 autres. Le gouvernement israélien plaida l’erreur d’identification, et Washington classa l’affaire dans le tiroir des oublis utiles. Aucun musée, aucune plaque, aucun hommage. Silence radio, depuis bientôt soixante ans. Il faudra bien, un jour, regarder ce passé en face, pour que la politique étrangère ne soit plus dictée par l’amnésie diplomatique.
Il ne faut pas surestimer ce frémissement. Le Congrès demeure majoritairement aligné sur les positions de Tel-Aviv, les lobbies veillent, et les commentateurs de profession récitent, comme en transe, le rosaire géopolitique hérité des années 2000. Mais ces mêmes médias, qui furent longtemps les hérauts de l’interventionnisme tous azimuts, Fox News en tête, ne font plus autorité auprès de cette jeunesse montante. Les jeunes républicains ne lisent plus The Wall Street Journal, ne regardent plus Hannity, et jettent sur CNN un œil aussi distrait que méfiant, comme on consulterait un almanach du siècle dernier. Leur monde est ailleurs : dans les podcasts prolixes de Joe Rogan, les philippiques en ligne de Matt Walsh, les fils brutaux et souvent chaotiques de X, cette agora sans filtre où l’immédiateté vaut mieux que le commentaire. À leurs yeux, la télévision ment par omission, la presse par habitude, les experts par construction. Ils ne croient plus aux récits, ils cherchent les images. Cette insoumission médiatique explique en partie pourquoi la version officielle du conflit israélo-palestinien s’effrite. On ne leur impose plus ce qu’ils doivent penser : ils veulent voir, juger, ressentir. Ce n’est plus Tel-Aviv qui fausse leur boussole, c’est Times Square lui-même qui a perdu le nord.
Cette jeunesse républicaine, à sa manière brouillonne mais sincère, semble redécouvrir une vérité politique élémentaire : l’alliance n’est pas la soumission. Que les États-Unis puissent avoir des intérêts divergents de ceux d’Israël n’est plus un sacrilège. Comme l’écrivait Ernst Niekisch, ce vieil hérétique de la gauche nationale, le réalisme politique commence lorsque l’on ose poser la question des finalités nationales. Une génération entière, qui n’a connu que les désastres de l’interventionnisme militaire, semble vouloir répondre à cette question, non plus avec des slogans, mais avec des actes.
Lindbergh, en son temps, fut haï, moqué, soupçonné, traité de traître. Il était peut-être simplement en avance sur la désillusion. Le voir aujourd’hui doucement réhabilité par les marges d’un parti qu’on disait fossilisé, c’est là une ironie qui fleure bon le retour du tragique dans l’histoire. Et si son buste sourit, ce n’est ni par vengeance, ni par orgueil. C’est que, peut-être, dans le bruissement indocile de cette jeunesse, l’Amérique redevient, fût-ce à tâtons, elle-même.
Balbino Katz — chroniqueur des vents et des marées —
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine




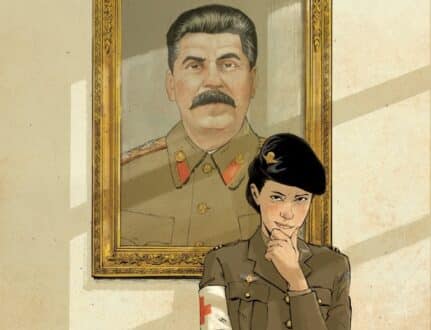




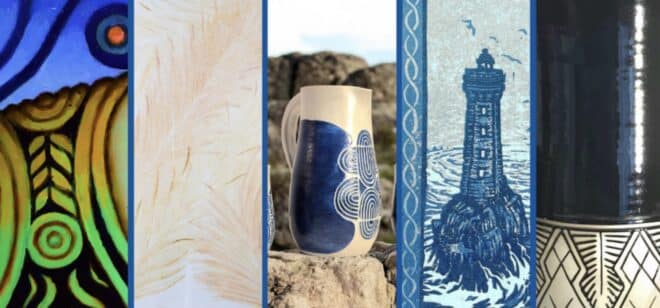
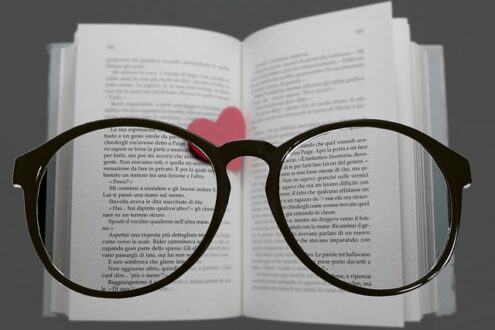



3 réponses à “Le buste de Lindbergh esquisse un sourire”
Merci de réhabiliter Lindbergh
Vous en faites trop dire à un unique article d’un jeune journaliste stagiaire noir dans un quotidien qui n’est pas réputé comme le phare de la pensée américaine. Son texte, qui bien sûr n’évoque pas Lindbergh, ne porte que sur l’évolution de l’opinion de certains jeunes républicains américains à l’égard d’Israël. Ce n’est qu’un « frémissement », comme vous le reconnaissez vous-mêmes un peu tard.
Dans le Musée national de l’air et de l’espace, à Washington, aucune mention des aviateurs français (Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumat), ni de l’industrie de l’aviation française (Latécoère, Hispano-Suiza, etc). Seule une minuscule mention de Jacques Closterman.