Il arrive qu’un texte, bien qu’écrit dans une langue étrangère, vous saisisse par sa justesse désabusée, son refus des slogans, sa lucidité à contre-courant. C’est le cas de cette conférence de Mark Weber, prononcée en mai dernier à Greenville, Caroline du Sud, et publiée dans plusieurs revues américaines dissidentes. Son titre en dit long : Our People or America? , « Notre peuple ou l’Amérique ? » Question brutale, qui, dans l’univers mental des Américains ordinaires, fleure l’hérésie. Car que serait l’Amérique si elle n’était ce corps mystique, ce rêve sans race ni racines, où chacun est libre de devenir tout ce qu’il veut, même ce qu’il n’est pas ?
Weber, vieux routier du dissidentisme anglo-saxon, ne s’en laisse pas conter. Son propos est simple, mais audacieux : le trumpisme, s’il a bien été un révélateur, parfois même salutaire, des maux de l’Amérique contemporaine, n’est en rien une solution. Il s’agit, pour Weber, d’un « mouvement protestataire réactionnaire », incapable de formuler un projet positif autre que le vague retour à un passé idéalisé, flou, où « l’Amérique gagnait » et où chacun se reconnaissait dans une bannière étoilée.
C’est là, selon lui, que réside la faiblesse structurelle du trumpisme : il identifie ses ennemis (les élites, les progressistes, les cosmopolites), mais ignore ce pour quoi il combat. Il peut dénoncer les bibliothèques remplies d’ouvrages inspirés par les théories raciales et sexuelles les plus délirantes, mais ne sait quels livres y substituer. Il rejette les politiques dites de diversité ou d’équité raciale, mais sans jamais oser affirmer positivement une identité nord-américaine, encore moins une identité européenne nord-américaine.
Weber va plus loin : « Le trumpisme, écrit-il, rejette les politiques anti-blanches, mais ne les remplace par aucune vision cohérente. Il agit comme si la race n’existait pas, ou comme si l’Amérique, par une sorte de magie constitutionnelle, était immunisée contre les lois biologiques, historiques, ou sociales. » Le lecteur européen, s’il est un tant soit peu pénétré de la pensée d’un Spengler, un Faye ou d’un Alain de Benoist, comprendra immédiatement : nous avons ici affaire à une critique du mythe américain, celui de l’exceptionnalisme, de la fusion heureuse, du progrès sans tragédie.
Dans ce texte très dense, Weber rappelle les faits que les conservateurs américains feignent d’ignorer : en 1945, les États-Unis étaient peuplés à plus de 90 % de Blancs européens. En 2025, ils sont sur le point de devenir une nation majoritairement non-blanche. Le trumpisme, qui promet le retour de la grandeur nationale sans remettre en cause ce bouleversement démographique, repose dès lors sur une illusion et, au fond, sur un mensonge. Il faut, écrit-il, avoir « le courage de regarder les choses telles qu’elles sont ». Ce courage, Trump ne l’a pas. Il remercie les électeurs afro-américains, hispaniques, asiatiques, mais tait le rôle décisif des électeurs blancs dans sa victoire. Il s’abstient toujours de nommer ceux dont il dépend le plus : les siens.
Ce refus de nommer est, selon Weber, la conséquence d’un conditionnement idéologique intense, vieux de plus de 80 ans, imposé par les universités, les médias, Hollywood, la publicité, les manuels scolaires. Une véritable opération de désarmement moral, où l’on a inculqué aux Blancs américains qu’ils n’ont ni droit à une mémoire propre, ni légitimité à défendre leurs intérêts collectifs.
« Il est possible d’ignorer la réalité, écrit-il, mais pas d’en ignorer les conséquences. » Cette phrase, qui résume à elle seule l’esprit du texte, devrait être gravée au fronton de toutes les écoles de sciences politiques. Car tout l’enjeu, pour Weber, est là : dans la prise de conscience par les Blancs américains de ce qu’ils sont devenus, une minorité bientôt marginale dans un pays qui fut le leur.
Et, avec une audace qui rappelle les grands moments de la revue Éléments ou certains écrits de Guillaume Faye, Weber trace une ligne claire : ce qui doit nous importer désormais, ce n’est plus de sauver l’Amérique, cette abstraction floue, multiculturaliste, pacifiée jusqu’à l’anémie, mais de préparer la renaissance d’un peuple. Il faut, dit-il, « réveiller la conscience ethnique latente » des Blancs américains, comme on réveillerait un vieux lion assoupi. Ce sursaut, poursuit-il, ne naîtra pas de la haine des autres, mais de « l’amour loyal et ferme de notre héritage, et du désir de garantir à nos enfants un avenir digne d’eux ».
L’analogie qu’il trace entre la prise de conscience des colons anglais de 1775 et celle, à venir, des Blancs contemporains est frappante. En 1775 encore, Washington lui-même se disait loyal au roi d’Angleterre. Un an plus tard, les mêmes hommes proclamaient l’indépendance. Il se pourrait bien, suggère Weber, que le même retournement se produise, non plus contre la Couronne britannique, mais contre le mythe fédéral américain lui-même.
Faut-il croire, pour autant, à l’émergence d’une conscience raciale blanche structurée, politique, militante, organisée ? Je n’en suis pas certain. Le peuple américain, même blanc, reste profondément marqué par un attachement sentimental à l’union, au drapeau, à l’idée, presque religieuse, de l’exceptionnalisme. Et tant que cette foi perdure, il est peu probable que les masses blanches acceptent de faire sécession, fût-ce mentalement.
Mais le texte de Weber, en posant cette alternative décisive, notre peuple ou l’Amérique, a le mérite de couper court aux illusions. Il dit ce que tant d’autres refusent de penser : qu’une nation n’est pas un programme, un drapeau ou un plan d’infrastructure, mais un peuple vivant, enraciné, différencié. Et que ce peuple, s’il veut survivre, doit rompre avec la fiction universaliste qui l’étouffe.
À mes yeux, ce texte marque une étape : celle où une partie de la droite américaine cesse de croire au retour d’un âge d’or perdu, pour envisager, avec une dureté nouvelle, une issue dissidente (comme l’a proposé pour l’Hexagone Yann Vallerie), identitaire, radicale. Il y a là quelque chose de spenglérien : non plus la nostalgie, mais la reconquête intérieure, le refus de mourir dans le rêve.
Balbino Katz — chroniqueur des vents et des marées —
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine




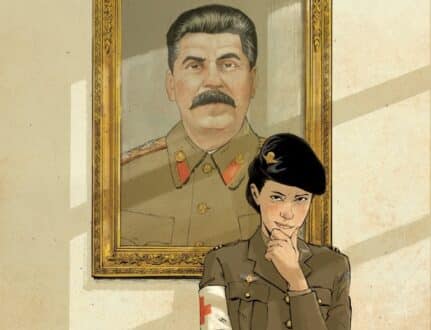




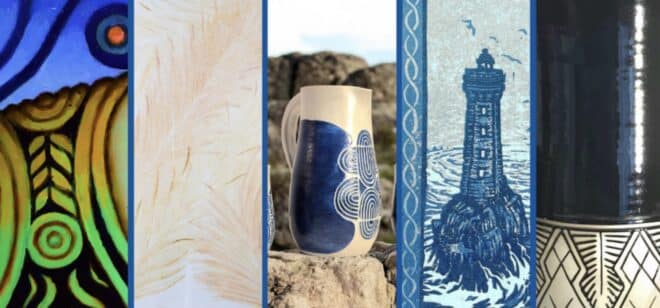
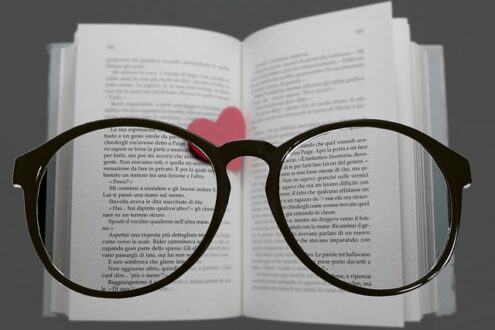



6 réponses à “Faut-il choisir notre peuple ou l’Amérique ? À propos d’un texte de Mark Weber”
Excellent article. Comme toujours. Merci.
1962 – Général Joseph Katz dit « le Boucher d’Oran » pour son rôle dans le massacre d’Oran le 5 juillet
2025 – Israel Katz, ministre de la défense israélien, le boucher de Gaza.
–> Bref, le pseudo Katz de ce Balbino n’est peut-être pas très heureux
@ Monsieur X: Doit-on juger une personne à son nom ? Dans ce cas d’espèce, en cherchant bien X est-il plus heureux ? Nous pourrions aussi y mettre autant de bouchers qu’on veut.
Monsieur X , si c’est la le fruit de votre réflexion concernant l’excellent article de Balbino Katz, vous auriez pu vous dispenser d ‘écrire ces quelques lignes qui ne sont en rien un commentaire
On trouve aussi des Katz médecins, scientifiques, artistes, mathématiciens, acteurs, et même un espion ! Critiquer quelqu’un pour son patronyme ou son pseudo se révèle très risqué, et même carrément hors-sujet.
La traduction en français de l’article de Mark Weber
https://www.theoccidentalobserver.net/2025/07/09/notre-peuple-ou-lamerique-la-race-ou-le-drapeau-voir-au-dela-de-trump/