C’était une arrivée comme on n’en fait plus, dans une époque où tout a pourtant été standardisé, nivelé, lissé. Une arrivée où la sueur ne brillait pas sous les spots d’un plateau télé, mais sur la peau d’une Française ébouriffée par la victoire, les nerfs, et peut-être un soupçon de mémoire historique. Le dimanche 3 août 2025, Pauline Ferrand-Prévot a conquis le Tour de France Femmes avec Zwift, et avec lui, une parcelle de ce territoire mythique qu’on appelle la grandeur.
C’est peu dire qu’elle n’a rien volé : prise dans une cassure dès les premiers lacets, privée du confort protecteur de ses coéquipières de Visma-Lease a Bike, elle a dû, seule, recoller au peloton, mater les ambitions adverses et dominer la montagne comme on dompte une bête hargneuse. À 33 ans, l’ex-déesse des sentiers en VTT a pulvérisé la logique d’un cyclisme compartimenté : championne de tout, elle est désormais la reine d’un Tour qu’elle ne connaissait qu’à travers Jeannie Longo et les légendes un peu défraîchies qu’on se raconte dans les familles de cyclistes.
Mais ce n’est pas tant la victoire — éclatante — qui marque, que la manière : Ferrand-Prévot, à Châtel, s’est envolée seule à 6,7 kilomètres du but. Et quand une Française s’élance en jaune, dans une ultime étape où les pièges abondent, le temps se suspend. On aurait pu jurer entendre le fantôme de Bernard Thévenet crier « vas-y ! » depuis une terrasse de bistrot, ou celui d’Hinault gronder dans les lacets : le dossard 51, celui des grands, brillait dans le soleil de Haute-Savoie.
La revanche d’une beauté brute
Elle n’a pas eu besoin de tresses arc-en-ciel, de slogans sponsorisés par des ministères, ni de conférences sur le genre. Elle a eu besoin de courage, de jambes, de stratégie. Et d’une volonté brute comme une dalle de granit. La France, qu’on disait morose et désunie, s’est trouvée une héroïne sans mantras ni pancartes, juste un maillot jaune bien serré et une rage de gagner.
En doublant les deux dernières étapes, Ferrand-Prévot rejoint les rares qui ont brillé en jaune jusqu’au bout. Et surtout, elle ressuscite une France qu’on croyait incapable de vibrer autrement que devant les plateaux télé du dimanche soir : celle des cols, des descentes, des attaques lointaines, des descentes en flèche et des montées pleines de souffle et d’orgueil.
Derrière, les habituées du podium ont fait leur numéro. Demi Vollering, la fidèle dauphine, s’accroche à sa 2e place comme une vieille aristocrate à son titre. Kasia Niewiadoma-Phinney, troisième, doit céder son titre acquis l’an passé.
Et Sarah Gigante, l’audacieuse Australienne, a tout tenté. Mais à force de tout donner dans la montée, elle s’est effondrée dans la descente, victime de sa générosité ou peut-être d’un destin qui préfère les drames aux comédies. La FDJ-Suez, piégée puis revenue, sauve l’honneur en raflant le classement par équipes — une première là encore.
2 victoires bretonnes avec Maëva Squiban et deux victoires françaises avec Pauline Ferrand-Prévot. Une vitesse moyenne record (39,065 km/h), des sommets avalés à la chaîne, et le maillot à pois d’Élise Chabbey porté du premier au dernier jour. Voilà de quoi redonner à l’hexagone du vélo ses lettres de noblesse, même quand elle est féminine.
Et puis il y a ce chiffre : 36 ans. Trente-six années sans victoire française sur le Tour de France féminin. La dernière s’appelait Jeannie Longo, elle était là, ce dimanche, pour saluer son héritière. La transmission n’est pas seulement symbolique. Elle est charnelle. Et presque politique.
Que faire après avoir tout gagné ? Souriant, épuisée, Pauline a levé les bras deux fois : pour l’étape, pour le général. Elle a réconcilié le Tour avec ses origines et son futur, prouvé que la victoire peut être belle, que le cyclisme n’est pas condamné à la fadeur. Le Tour de France Femmes 2025 se termine dans un souffle d’épopée. Il nous reste Pauline Ferrand-Prévot. Et cette question : quand revient-elle ?
YV
Crédit photo : ASO / PAuline Ballet
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine




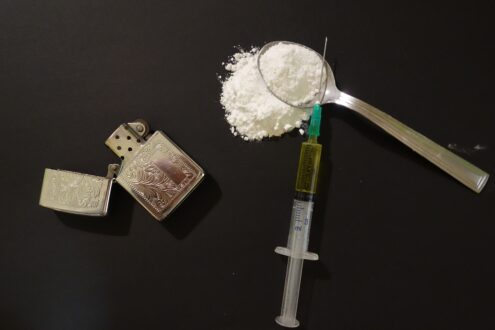









2 réponses à “Pauline Ferrand-Prévot, l’héritière dorée du Tour : l’été de la réconciliation française”
Demat ; toutes mes félicitations à Pauline de la part d’un cycliste senior amateur. Tu nous a fais toutes et tous vibrés. Quand je prendrai humblement mon vélo, je penserai à toi. Kenavo.
Pauline et Maeva… 2×2 fois ça fait 4 victoires… Une fin de semaine en or, c’est certain ! Pourvu que ça »doure » disait Madame Mère au sortir de Notre-Dame… Au moins une leçon à ces grosses feignasses de machos terrassées par le grand Slovène… tss Vive les filles !