Le professeur Grzegorz Piotr Kucharczyk est un éminent historien polonais spécialisé dans l’histoire de l’Allemagne et de la Prusse, ainsi que dans les relations polono-allemandes aux XIXe et XXe siècles. Il est également un intellectuel prolifique, commentateur et vulgarisateur de l’histoire. Notre confrère Artur Ciechanowicz (The European Conservative) l’a interviewé. Traduction par nos soins.
Peu de termes ont subi autant d’inflation sémantique au cours des 30 dernières années, par simple abus, que celui de « société civile ». Qu’est-ce que c’est vraiment ?
Piotr Kucharczyk : En termes simples, la société civile est une forme d’organisation sociale qui favorise les initiatives et les mouvements indépendants de l’État. Il s’agit d’un phénomène positif, l’expression d’une liberté tangible et ancrée dans la société. Une liberté à la fois individuelle et collective qui se manifeste dans de nombreux domaines : associations, organismes culturels, organisations professionnelles et religieuses. Plus ce type de société civile est dynamique et authentique, plus on peut parler de liberté réelle.
La société civile, dans le sens où je l’entends, enseigne une forme de liberté liée à la responsabilité. Il s’agit d’une liberté concrète, qui renvoie à la capacité des communautés réelles, qu’il s’agisse de familles ou d’associations, à poursuivre leurs objectifs et à répondre à leurs besoins. Ce n’est pas une liberté idéologisée, car elle est indissociable de la responsabilité. La véritable société civile est libre, mais elle assume également la responsabilité de ses actes. Elle est donc moralement saine, juste et digne d’être soutenue. Je tiens à souligner qu’il s’agit là d’un modèle idéal. Souvent, ce qui est présenté comme la société civile n’est qu’une façade ou, au mieux, une approximation de la réalité sociale authentique sanctionnée par l’État.
Une forme de société civile a-t-elle toujours existé ?
Piotr Kucharczyk : Cela dépend du contexte culturel. En Pologne, nous pouvons retracer une longue tradition qui remonte au républicanisme de la Première République polonaise. En Russie ou en Chine, en revanche, cette tradition est pratiquement inexistante.
Le concept de société civile a pris différentes formes au cours de l’histoire. Par exemple, la doctrine sociale catholique promeut le principe de subsidiarité, selon lequel ce qui peut être fait à un niveau inférieur de l’organisation sociale ne doit pas être pris en charge par l’État. Depuis 1989, nous assistons à une certaine inflation de l’utilisation du terme « société civile ». Il est généralement invoqué par ceux qui considèrent ses manifestations concrètes comme dangereuses.
Quel est le contraire de la société civile ? Quel type de structure sociale lui est naturellement opposé ?
Piotr Kucharczyk : Son contraire est une société dirigée, gérée par le haut.
Observe-t-on actuellement des tendances vers des sociétés dirigées ?
Piotr Kucharczyk : Sans aucun doute. Les moteurs de cette orientation, qu’il s’agisse de gouvernements nationaux ou d’organisations internationales, formelles ou informelles, invoquent l’idéologie pour justifier leur contrôle. Ce sont les propagateurs de nouveaux et moins nouveaux « resets ». Nous observons ces ambitions non seulement en Pologne, mais partout dans le monde.
Existe-t-il des exemples historiques de conflits entre sociétés civiles et sociétés dirigées ?
Piotr Kucharczyk : Les sociétés dirigées trouvent leur origine, dans la tradition européenne, dans la Révolution française. C’est en France que cette distinction est la plus évidente. Une société dirigée est généralement construite selon un plan prédéterminé. Après 1789, les révolutionnaires ont cherché à construire une « nouvelle France » et de « nouveaux Français » et n’ont toléré aucune initiative rivale. La guerre de Vendée en est un exemple typique : une révolte rurale en 1793 a été brutalement réprimée par le pouvoir républicain centralisé dans ce qui était en fait un acte de génocide.
Plus tard, en Prusse, puis dans l’Empire allemand après 1871, on observe le même schéma. Les libéraux allemands, soutenant Bismarck, ont contribué à imposer une société « moderne » descendante, à travers le Kulturkampf et la germanisation brutale des territoires polonais. Mais de l’autre côté, une véritable société civile a persisté, à travers le mouvement ouvrier organique polonais et la résistance des communautés catholiques en Bavière et en Rhénanie. Ces sociétés ont construit des réseaux d’associations indépendants de l’État et ont offert une véritable alternative à la vision centralisatrice de Berlin.
Existe-t-il des exemples contemporains de résistance de la société civile au contrôle centralisé ?
Piotr Kucharczyk : Oui. Il y a quelques années, en France, nous en avons été témoins sous la forme de manifestations massives en défense de la famille – La Manif pour tous – expression de la société civile. Dans le même temps, le pouvoir central poursuivait un projet d’ingénierie sociale descendante qui a abouti à l’inscription constitutionnelle de l’avortement, c’est-à-dire, en substance, à la légalisation de l’infanticide. Des tensions similaires existent en Pologne depuis 1989.
Le mouvement de défense des frontières en Pologne, qui cherche à bloquer le flux migratoire, est-il un exemple de société civile ?
Piotr Kucharczyk : En effet, et il est profondément détesté par les élites. C’est typique de notre époque : les exemples réels et vivants de la société civile sont méprisés par les establishments politiques et médiatiques, tandis que les contrefaçons sont généreusement soutenues. Je fais ici référence aux soi-disant ONG, dont beaucoup sont en fait financées par le gouvernement et ne servent pas la société civile, mais les intérêts de leurs protecteurs. En apparence, ce sont des « organisations non gouvernementales » ; en substance, elles ne sont guère plus que des extensions contractuelles du pouvoir étatique ou supranational. Comme le dit le vieil adage, celui qui paie les violons choisit la musique.
Rappelons-nous ce qui s’est passé lorsque l’administration Trump a coupé les fonds destinés à divers groupes de gauche à l’étranger : le volume d’argent qui avait été versé aux ONG en Pologne était stupéfiant.
À quoi servent ces façades à l’establishment libéral de gauche ? Ne peuvent-ils pas fonctionner sans elles ?
Piotr Kucharczyk : Ils fonctionnent dans les deux cas. On ne peut pas prétendre qu’ils dépendent exclusivement des ONG. D’un côté, nous avons la politique officielle mise en œuvre par des actes juridiques, bien sûr sous le couvert de la « liberté », censée évoquer toutes sortes d’associations positives. Prenons, par exemple, la législation dite « sur l’égalité » ou la campagne contre les « discours de haine ». Après tout, qui défendrait ouvertement la haine dans la vie publique ? Mieux vaut la combattre. Dans la pratique, cependant, il s’agit d’introduire une censure préventive.
Parallèlement, d’autres actions sont menées par d’autres canaux, à savoir les pseudo-ONG, imitations des institutions de la société civile, qui créent l’illusion que les initiatives politiques répondent à une véritable demande populaire. Les ONG jouissent d’une bonne image auprès du public, qui les associe à l’aide humanitaire en Afrique ou à l’aide aux victimes de tremblements de terre. Et pourtant, à l’approche des élections présidentielles en Pologne, il est apparu clairement qu’un certain nombre de ces organisations, aux noms et au vocabulaire flatteurs comme « démocratie », n’avaient rien à voir avec la démocratie et encore moins avec la société civile. Elles servaient de relais à des flux financiers provenant de sources étrangères, des fonds destinés à influencer – et qui ont effectivement influencé – la campagne électorale en violation flagrante de la loi.
Les ONG sont-elles des instruments permettant à des puissances étrangères d’influencer la politique intérieure d’autres États ?
Piotr Kucharczyk : Cette influence est considérable. Nous n’en voyons que la partie émergée de l’iceberg. Le réseau de liens entre les ONG polonaises et les acteurs étrangers est vaste. Et ne soyons pas naïfs : la Biélorussie, la Russie et la Chine financent sans aucun doute ces organisations soi-disant indépendantes. Je ne prétends pas en connaître toute l’ampleur, mais je pense que ce qui parvient à la connaissance du public n’en est qu’une infime partie. Bien sûr, toutes les ONG ne sont pas fausses. Mais voici le test : l’initiative s’autofinance-t-elle ou vit-elle de dons et de subventions externes, même lorsqu’ils sont ouvertement déclarés ? Si tel est le cas, on ne peut pas dire qu’elle soit indépendante.
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine







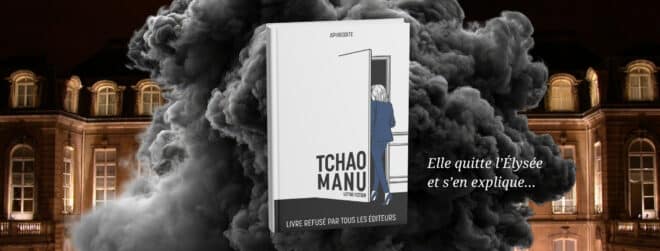



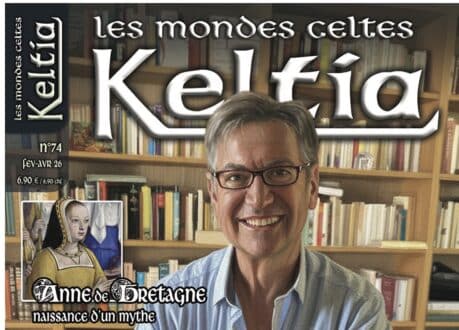


Une réponse à “Pologne, ONG…Une société civile ou une société contrôlée ? Entretien avec l’historien Grzegorz Kucharczyk”
Piotr Kucharczyk désigne clairement l’adversaire dans sa dernière réponse ! Son concept de « société civile » comporte une ambiguïté : il la définit comme une organisation sociale non contrôlée par l’Etat et affirme qu’elle « enseigne une forme de liberté liée à la responsabilité ». Il faudrait nuancer. La pratique de l’Eglise catholique, par exemple, a pu dans bien des cas être à la fois indépendante de l’Etat ET antagoniste de la liberté. La Mafia, les gangs, les clans locaux de dealers sont aussi des sociétés civiles.