J’ai lu le texte de François Soulard, « Le remodelage stratégique de l’Amérique latine », en ligne sur son site, dans la lumière dorée d’une fin d’été bretonne, le vent rabattant sur la vitre les effluves iodées du port. Ce chercheur français vivant en Argentine, dont l’acuité tranche avec le brouillard des lieux communs, s’attaque à ce qui demeure la grande cécité contemporaine : l’architecture stratégique qui a remodelé l’Amérique latine depuis plus d’un siècle, et que l’on ne peut comprendre qu’en se dégageant des cadres rassurants de la géopolitique traditionnelle. Son propos, exigeant, appelle à un véritable aggiornamento intellectuel, un dépoussiérage profond des grilles de lecture pour saisir la nature nouvelle des rapports de force.
Soulard rappelle, à juste titre, que la grammaire clausewitzienne, celle qui oppose clairement l’ami et l’ennemi, ne suffit plus pour interpréter un continent travaillé par des conflits triangulaires, où l’adversaire réel se tient hors scène, manipulant les antagonismes pour mieux les exploiter. Ce « matériel stratégique » hérité de l’Angleterre victorienne puis anglo-américaine repose sur une dialectique de la provocation et de la réaction, où l’ennemi est désigné pour mieux être fabriqué, et la guerre conduite par des moyens indirects : finance, idéologie, infiltration culturelle, intoxication médiatique.
L’analyse a l’avantage de dérouler une chronologie précise : 1898 et l’explosion du Maine qui livre Cuba aux États-Unis, 1948 et le Bogotazo, laboratoire de la Guerre froide tropicale, 1959 et le théâtre cubain, où Fidel Castro, loin d’être un franc-tireur, joue un rôle assigné, 1969-1990 et le ballet mortifère des guérillas, coups d’État et cartels, enfin, l’ère post-1990, où l’opposition est encadrée de part et d’autre, le castro-chavisme répondant à un libéralisme administré, tous deux intégrés dans une même enceinte cognitive verrouillée par l’establishment anglo-américain.
Toutefois, cette fresque, si suggestive, me semble privée de son premier acte. Soulard prend pour point de départ l’aube du XXe siècle, comme si le rideau s’était levé soudain sur ce duel triangulaire. Or, pour qui connaît les histoires familiales, locales ou nationales, la matrice est plus ancienne. Les guerres civiles qui accompagnèrent les émancipations, de Buenos Aires à Caracas, ne furent pas des accidents internes. L’Angleterre, maîtresse des mers et de la banque, y joua un rôle constant, tantôt encourageant les soulèvements, tantôt finançant les rebelles, tantôt accueillant et armant les rebelles espagnols à Londres ou dans les Caraïbes. Dans ce double jeu, la couronne britannique préparait déjà ce que Soulard décrit : une Amérique émancipée en apparence, mais arrimée de fait à ses circuits financiers, à ses flottes et à son commerce.
Le « remodelage » dont parle Soulard n’est donc pas seulement une mutation stratégique du XXe siècle : c’est l’achèvement d’un processus entamé dès la chute de l’empire espagnol, et dont la fallacieuse émancipation politique n’a été que la première étape. Ce qui change, avec l’ère anglo-américaine, c’est la sophistication de l’appareil : à la vieille balance des puissances succède un encerclement cognitif, une guerre conduite sans déclaration et sur tous les registres, universitaire, médiatique, culturel, économique, où l’ennemi ne se sait même pas en guerre.
Soulard pointe avec justesse que cette guerre est « post-clausewitzienne » et « post-schmittienne ». Le terme qu’il emploie, aggiornamento, n’est pas anodin : il évoque, comme dans le concile Vatican II, une mise à jour radicale des fondements, non pour les trahir, mais pour les rendre opérants dans un monde transformé. De même que l’Église dut repenser son langage, ses rites et sa pastorale pour affronter la modernité, l’analyse stratégique devrait, selon lui, abandonner certaines certitudes conceptuelles pour saisir un adversaire qui se dissimule et un champ de bataille qui a perdu ses frontières visibles.
J’ajouterai qu’elle est aussi, et peut-être d’abord, post-historique, en ce sens qu’elle efface de la mémoire collective les fils qui permettraient de remonter à sa source. Un continent qui ne se souvient plus que ses guerres d’émancipation furent, pour partie, un théâtre d’opérations londonien, aura du mal à comprendre pourquoi ses oppositions contemporaines, qu’elles se nomment Milei ou Petro, Bolsonaro ou Lula, se retrouvent finalement dans une même cage d’acier, réglée depuis l’extérieur.
Ce qui reste, à la lecture de Soulard, c’est l’image d’un adversaire qui avance masqué et d’un champ de bataille qui n’en a plus les contours. Ce qui manque, c’est le souvenir que ce masque et ce champ ont été façonnés de longue date, et que l’on ne dénouera pas l’étreinte actuelle sans remonter au geste originel qui l’a nouée.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées
Qu’est-ce que l’aggiornamento de Vatican II ?
Le terme aggiornamento, littéralement « mise à jour » en italien, a été popularisé par le pape Jean XXIII lors du concile Vatican II (1962-1965). Il désignait l’adaptation de l’Église catholique aux réalités du monde moderne : réforme liturgique, dialogue avec les autres religions, engagement social renouvelé. Il ne s’agissait pas de renier la doctrine, mais d’en réactualiser l’expression et les moyens. Par analogie, l’aggiornamento stratégique dont parle Soulard implique de conserver les acquis de la pensée géopolitique classique tout en les réinterprétant à la lumière des formes contemporaines de conflit.
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine












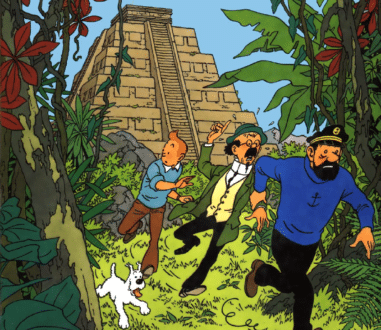

4 réponses à “Le piège triangulaire et l’ombre anglaise”
Comme d’habitude , excellente analyse , mais je regrette de ne pouvoir lire le document de F.Soulard écrit en espagnol
Dans la chronologie, on peut mentionner l’indépendance de la « Bolivie » (de Bolivar né au Vénézuela, d’origine basque) due aux manigances anglaises. L’Angleterre a été aussi partie prenante dans l’indépendance de l’Uruguay qui devait être fédérée à l’Argentine. Pour ne rien dire du « Panama ». Dans tous les cas il y a la même population des deux côtés de la frontière.
Et le coup d’état sanglant de 1954 au Guatemala pour les profits de United Fruit.
« L’aggiornamento » date de la création de l’Argentine maçonnique qui se vend à la découpe aux anglo -américains. Le livre de Domingo Faustino Sarmiento , « Facundo . Civilizacion y barbarie », donne une idée !
la première manifestation militaire de Peron est la répression des travailleurs sur le chantier d’une société anglaise (1919 ?)!
En août 1974 la revue jésuite du CIAS publie une étude : Valores Cristianos del Peronismo.
Le pape Bergoglio récupère les principes d’organisation du parti péroniste et en fait des principes sociaux pour l’Eglise catholique dans sa première encyclique (voir mon livre « François la conquête du pouvoir », chapitre IX). En 1974 quelques mois avant sa mort Peron propose une alliance à Fidel Castro ! En 2025 Jean-Baptiste NOE écrit : « François le dernier des péronistes !
Bonjour, grand merci à Breizh Info pour ces commentaires. Je signale que l’article source est aussi disponible en français: https://www.meer.com/fr/94859-pour-un-renouveau-strategique-de-lamerique-du-sud