Ce matin-là, au bar de l’Océan au Guilvinec, j’aperçus une vieille dame absorbée dans la lecture du Figaro Magazine. Elle tournait les pages lentement, s’arrêtant longuement sur un dossier consacré au pape Léon XIV. À deux pas de là, l’église Sainte-Anne somnolait dans la lumière saline. La dernière fois que j’y suis entré, il y a quelques semaines, c’était pour l’enterrement de mon cousin. Aucun prêtre n’était là. L’office, mené de bout en bout par un quarteron de chaisières, avait la ferveur des humbles et le chant faux des vieilles voix qui ne s’excusent pas de leur justesse incertaine. C’était, à sa manière, un résumé du catholicisme d’aujourd’hui, dépouillé, persévérant, et, malgré tout, fidèle.
À Paris ou à Chartres, dans l’ivresse des bannières et le claquement des tambours scouts, une partie des catholiques français se persuade que l’avenir de l’Église se joue là, et nulle part ailleurs. Les réseaux traditionalistes regorgent de photographies où l’on se veut l’avant-garde du renouveau, comme si les processions de Chartres dictaient la politique de Rome. C’est oublier qu’à Buenos Aires, à Kampala ou à Manille, la messe est celle que célèbre le curé, et qu’il ne viendrait à personne l’idée de demander une liturgie alternative.
Léon XIV, premier pape américain, connaît cette diversité. Il sait que le bruit du monde catholique ne vient pas seulement des bastions militants, mais aussi du murmure immense de communautés invisibles aux caméras. Il a hérité d’une Église éraillée par les tensions du pontificat précédent, où le progressisme pastoral de François, plus sociologue que théologien, s’était souvent heurté au rigorisme des traditionalistes. Et ses premiers gestes, qu’il s’agisse d’honorer la vieille pourpre condamnée par François à l’exil intérieur, de reprendre des signes liturgiques délaissés, ou de redonner au palais pontifical sa fonction d’habitation, tiennent moins de la revanche que de la diplomatie.
Il est frappant de voir combien ce pontificat, en trois mois, a déjà trouvé son équilibre entre fermeté doctrinale et souci d’apaisement. À Tor Vergata, devant un million de jeunes, Léon XIV a parlé du Christ et non des querelles internes. À Sainte-Anne-d’Auray, il a envoyé un cardinal africain dont le nom seul apaise les cœurs conservateurs. Dans une lettre aux évêques de France, il a cité Jean Eudes, le curé d’Ars et Thérèse de Lisieux, comme s’il savait que pour parler à ce pays fatigué, il fallait lui rappeler ce qu’il a de meilleur.
Ceux qui rêvent d’un Léon XIV restaurateur intégral risquent de connaître la même désillusion que sous François. Car si le pape connaît les sensibilités liturgiques européennes et nord-américaines, il sait aussi qu’elles ne concernent qu’une minorité sociologique. Pour l’immense majorité des fidèles, la question centrale n’est pas la forme ordinaire ou extraordinaire de la messe, mais la survie de la foi dans des sociétés qui lui sont devenues étrangères.
En réalité, sa méthode est celle d’un chirurgien prudent. Les traditionalistes bruyants, souvent surreprésentés dans la sphère médiatique catholique, reçoivent ici ou là un signe, un mot aimable à l’un de leurs cardinaux, un geste d’apparat liturgique, la suspension discrète d’une sanction, assez fort pour leur permettre de crier victoire, mais jamais assez décisif pour infléchir la trajectoire globale du pontificat. Les observateurs pressés y voient une ambiguïté, alors qu’il s’agit d’un calcul : donner à chaque camp de quoi se dire entendu, tout en maintenant l’autorité centrale au-dessus de la mêlée.
Léon XIV sait que l’énergie dépensée à gérer les susceptibilités des chapelles occidentales est une distraction par rapport aux urgences réelles : l’effondrement de la pratique en Europe, la concurrence religieuse en Afrique, la montée des Églises évangéliques en Amérique latine. Il n’a pas l’intention de se laisser enfermer dans un duel avec les ultras de part et d’autre. Son horizon est plus vaste : maintenir le lien entre des catholiques dont les réalités culturelles et économiques n’ont parfois plus rien en commun, sinon le nom du Christ.
Les catholiques français feraient bien de se souvenir qu’ils ne sont pas l’axe du monde. Leur nombrilisme liturgique, entretenu par des pèlerinages spectaculaires, mais circonscrits, finit par les isoler dans une bulle et nourrit des attentes irréalistes envers Rome. Léon XIV, lui, raisonne en pasteur universel. Sa tâche n’est pas de sauver l’exception française, mais de maintenir à flot un navire immense, aux cales pleines de peuples qui n’ont jamais entendu parler de Chartres.
En cela, il se situe à mi-chemin entre ses deux prédécesseurs immédiats. De Benoît XVI, il retient la clarté doctrinale et le sens de la continuité liturgique, mais sans s’y enfermer comme dans un manifeste. De François, il reprend l’attention aux périphéries et l’idée d’un pape voyageur, tout en évitant les ruptures provocatrices. C’est un pontificat de couture fine, qui ne coud ni tout à fait blanc ni tout à fait noir, mais qui tente de recoudre les pans déchirés d’un vêtement que personne, à Rome, ne croit pouvoir restaurer dans son état originel.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées








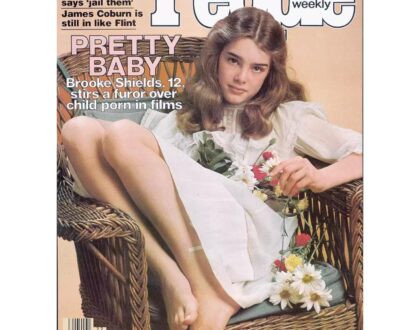
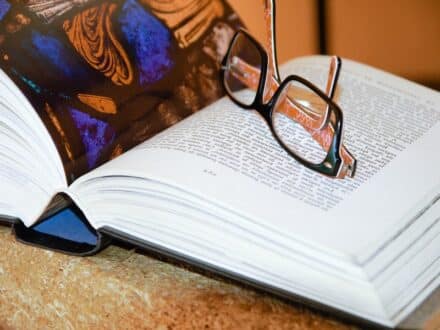

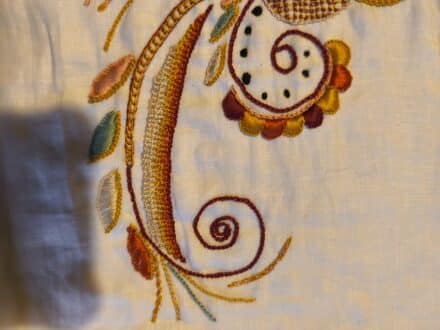
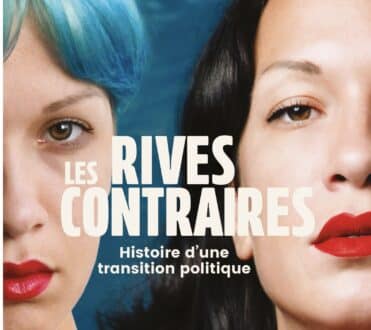

12 réponses à “Léon XIV et le nombrilisme hexagonal”
Excellente et rare analyse, merci !
Bonjour,
Un seul saint français peut changer le monde.
Cdt.
M.D
Et une Église gallicane ? Pourquoi pas ?
Pas très sympa pour les tradis français qui ne nombrilisent pas mais demandent simplement qu’on les laisse pratiquer la messe extraordinaire comme l’avait sagement permis Benoît XVI. Marginal devant les gros problèmes de lEglise dans le monde ? Voire ..
Erreurs :
Au Pèlerinage de Chartres, il y avait des drapeaux du monde entier.
Et la FSSPX s’étend sur le Monde entier
https://fsspx.org/fr/centres-messe
J’espère que le café servi à l’Océan n’était pas tiède…j’ai connu l’abbé Jim Sévelec originaire de Douarnenez, ancien marin pêcheur, teint rougeaud, grande gueule, voix tonitruante en chaire qui vidait ses 25 cl de Sidi Brahim et bis et re bis…qui embringuait les communistes, les faisait chanter pour les obsèques d’un camarade, et ça vibrait dans cette église! Quoi le rigorisme des Tradi/s mais il est avec le Ciel certains accommodements! Retenons Jean Eudes loin des tarés!A défaut des vieux curés du type bonhomme, jovial, distribuant des encouragements!
Oui, excellent article, un peu jésuite tout de même en essayant à chaque ligne de ménager la chèvre et de rassurer le choux. A vue humaine, la survie du catholicisme ne dépend pas seulement de telle ou telle forme liturgique (même si pour moi la traditionnelle est inégalable). Elle dépend surtout du fait de savoir si l’Eglise assumera toujours contre vents et marées d’être le socle de la vérité enseignée par le Christ. Si l’Eglise n’est plus le temple de la vérité, elle est foutue. J’espère vivement que Léon XIV porte ce feu de Dieu en lui.
Article aussi subtil que SS Léon XIV. Mais je vois pas les « périphéries » comme zones d’avenir pour notre catholicisme, ceux de Chartres me titillant plus l’Esprit.. Et le million de « jeunes » du Jubilé me fait penser à une discussion organisée par mon brave recteur dans les années 90 avec des « jeunes » enthousiastes de la paroisse dont il ressortait une profonde ignorance des fondamentaux de la Foi. Et arrêtez de citer le Figaro. Genoh aveid Bzh ha Fé.
les querelles liturgiques ne sont que l’arbre qui cache la forêt :Nostra Aetate – ou le dialogue interreligieux et l’interdiction de dire que le catholicisme est la seule religion voulue par Notre Seigneur, et qui nous amène à des aberrations comme le changement de la prière traditionnelle pour la conversion des Juifs pour l’incoherent « Qu’ils
soient respectés dans leur foi et reconnus partenaires de la nécessaire rencontre entre les religions, au
service de la paix »
Bonjour. L’auteur, dont j’apprécie en général les articles, écrit : « Pour l’immense majorité des fidèles, la question centrale n’est pas la forme ordinaire ou extraordinaire de la messe, mais la survie de la foi dans des sociétés qui lui sont devenues étrangères. »
Encore faudrait-il que la « messe selon la forme ordinaire » instaurée en 1969 nourrisse la foi catholique, alors qu’elle n’est plus le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ sur la croix, pour l’expiation de nos péchés, mais, selon les « nouveaux standards », un repas mémoriel. Ce qui est une conception protestante.
Encore faudrait-il que le « pape », ses « évêques » et ses « prêtres » professent aujourd’hui la foi catholique enseignée par le Christ, transmise par les Apôtres et les pontifes successifs de l’Histoire. Or ce n’est pas le cas. Ils en enseignent une version falsifiée, où quelques vérités encore présentes se mélangent à des hérésies et des actes scandaleux, comme le baiser sur le Coran de « Jean-Paul II » (1999), ou plus récemment la vénération de l’idole Pachamama et la bénédiction des couples homosexuels.
L’auteur considère probablement le refus de Vatican II ou l’attachement à la messe traditionnelle comme secondaires. Ils sont pourtant l’expression de la fidélité à la foi catholique de toujours, aux vérités immuables sur Dieu, la nature humaine blessée par le péché originel, et les moyens d’atteindre le salut. Que ces fidèles (le mot n’est pas anodin) soient très peu nombreux n’a pas d’importance, le Créateur n’attend pas que nous fassions nombre, mais que nous vivions en faisant Sa volonté.
Le magistère de l’Église enseigne clairement que le pape ne peut pas errer en matière de foi et de mœurs. Si c’était le cas, comment les dogmes catholiques seraient parvenus jusqu’à nous ? Il a fallu une autorité infaillible pour qu’ils soient crus et transmis à travers les siècles. C’est le sens de la parole de Jésus disant à Pierre (et à ses successeurs) « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle ». Les portes de l’enfer, ce sont les hérésies, les idées qui mènent à la damnation.
Or depuis « Jean XXIII » en 1958, ceux qui se présentent comme papes ont multiplié les erreurs théologiques, en contradiction avec l’enseignement antérieur. Ce ne peut être l’œuvre de l’Église fondée divinement et de son chef, si l’on en croit l’Acte de Foi :
« Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées, et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper »
L’Église subsiste dans les clercs et les fidèles qui professent et vivent la foi catholique, sans compromission avec l’erreur. Le Vatican est malheureusement devenu un lupanar hérétique et pédérastique qu’il convient de combattre. L’habit ne fait pas le moine. Je terminerai par cet extrait de l’Épître de saint Paul aux Galates :
« Si nous-mêmes ou un ange du ciel vous évangélisait autrement que nous vous avons évangélisés, qu’il soit anathème. »
Cet article est complètement à côté de la plaque ! Il tait l’essentiel, à savoir que Léon XIV est le continuateur de papes modernistes et que le modernisme est un fléau, une hérésie qui prône des philosophies condamnées par l’Eglise. Ainsi, quand l’auteur se réjouit du fait que Léon XIV parle enfin de Jésus-Christ, il omet de dire que, selon le principe moderniste d’immanence, il parle d’un Christ qui n’est qu’un homme habité plus qu’un autre du sentiment de foi.
« les catholiques français » ne sont certe pas » axe du monde » mais la France est un pays étrangement aimé dans le plan de Dieu (les apparitions si nombreuses et ses saints et saintes si merveilleux le font comprendre
) même si elle est en ce moment si étrangement étrangère à sa mission .
C’est sous cet angle qu’on peut deviner l’enjeu , pour certains , des querelles liturgiques , et ne pas trop le réduire à un nombrilisme .