Le traditionnel clivage entre la Droite et la Gauche a longtemps fait partie de notre histoire politique pratiquement depuis la Révolution. Assez arbitraire dans ses débuts, il ne faisait que reprendre la composition et la répartition de l’assemblée du 28 août 1789.
Sans refaire toute l’histoire de l’évolution de la pensée de la gauche, on peut noter qu’elle s’est écartée au fil du temps de ses fondamentaux et particulièrement ces dernières décennies. L’un de ces changements les plus marquants réside dans son attitude par rapport à la nation.
La gauche est à l’origine de la nation française
A l’origine de la nation se trouve un peuple. Certains disent « un peuple qui devient le Peuple » Le peuple est donc indissociable de la nation et cela suffit pour démontrer que cette idée de nation est, au départ, une idée de gauche, mais d’une gauche voulant préserver et agir dans l’intérêt du peuple, donc de la nation. Jean Jaurès, brillant normalien, entre en politique comme « républicain » à l’Assemblée Nationale en 1885. Ce n’est qu’en 1890 qu’il se rapprochera du socialisme. Il sera élu député «socialiste indépendant» en 1893. La grande grève des mineurs de Carmaux puis « l’affaire Dreyfus » lui donneront l’occasion d’avoir une influence marquante sur un parti socialiste jusque là assez partagé entre deux tendances. Le POF (parti Ouvrier Français) refuse de défendre Dreyfus en tant que militaire « à la solde de l’État bourgeois »
Jaurès veut accélérer l’unification des socialistes et profite de la seconde « internationale socialiste » d’avril 1905 pour créer la SFIO (Section Française de l’Internationale Socialiste)
Mais Jaurès est avant tout un pacifiste, ce qui le fait haïr par les nationalistes qui, eux veulent défendre la nation française.
Une évolution lente mais continue vers le mondialisme
On confond souvent le mondialisme avec la mondialisation. Pourtant, il existe une différence essentielle; le mondialisme veut imposer un gouvernement mondial unique pour tous les habitants de la planète alors que la mondialisation est un phénomène lié à la multiplicité des échanges entre les différents pays et ce qu’on appelle le libéralisme l’a accéléré après la seconde guerre mondiale.
Le libéralisme ne portait pas -à priori- atteinte aux souverainetés nationales alors que le mondialisme doit les faire disparaître. C’est sur cette ambiguïté volontairement entretenue qu’a pu se développer le mondialisme en se camouflant derrière le mondial-libéralisme qui devait conduire à la « mondialisation heureuse »
Il se peut que certains socialistes aient été eux-mêmes victimes de cette manipulation des esprits, mais la plupart d’entre-eux s’en sont, au fil du temps, accommodés.
Le nationalisme, ennemi déclaré des mondialistes
Ce qu’on appelle le « nationalisme » est devenu, par la force des éléments de langage, une sorte d’épouvantail quasi synonyme du fascisme et parfois du nazisme. C’est très réducteur car à l’origine de la nation, on trouvait justement des nationalistes persuadés que la nation était la meilleure protection qu’on puisse offrir au Peuple. C’est pour défendre ce qu’ils considéraient comme un bienfait que les sans-culotte de Valmy ont crié « Vive la nation », marquant, d’après Goethe, « une nouvelle ère dans l’histoire du monde ». Et le plus fort est que ce cri anticipe de deux jours seulement la proclamation de la République…
A la fin de la seconde guerre mondiale, les empires avaient disparu de la surface de la planète et seules subsistaient encore les nations, mais pour combien de temps ? La première attaque des mondialistes ango-saxons eut pour théâtre l’Europe et plus particulièrement l’Europe occidentale.
Toute la construction européenne s’est effectuée suivant ce paradigme. De Gaulle, qui avait parfaitement vu le piège tendu, a voulu s’y opposer en proposant une conception différente, celle d’une Europe des nations et des États. Ne disait-il pas que « les seules réalités internationales, ce sont les nations ! » Le bon sens élémentaire aurait voulu qu’on demande aux peuples de trancher, mais, probablement parce que leurs aspirations étaient évidentes, on s’est bien gardé de leur poser la question. Alors, en bons internationalistes, les Socialistes ont toujours soutenu une Europe « supranationale ». Rien d’étonnant à ce que, juste avant son départ de l’Elysée, François Mitterrand, faisant le bilan de ses deux septennats, s’écrie devant le parlement européen « le nationalisme, c’est la guerre » car on sentait déjà poindre le courant de contestation qui, de proche en proche, allait gagner les peuples européens. Le peuple français exprima clairement son choix en répondant « non » au référendum du 29 mai 2005.
La fracture du parti socialiste
En 2005, le premier secrétaire du parti socialiste était François Hollande, dont les sentiments européistes ne laissaient guère de doute, demanda leur avis aux militants, qui répondirent « oui » à près de 60 %. Pourtant, certaines figures de ce parti essayèrent d’infléchir ce choix. Ce fut le cas d’Henri Emmanuelli, Jean-Luc Mélenchon et même, avec un peu de retard, Laurent Fabius…
De fait, ce référendum est le point de départ d’un changement de clivage dans la société française.
Le vieux clivage « Droite – Gauche » n’a pas survécu à ce référendum, même si, par ce qui présente « un vague cousinage » (comme aurait dit Michel Audiart) avec une forfaiture, Nicolas Sarkozy l’a fait ratifier par le Congrès sous la forme du traité de Lisbonne.
Un autre clivage l’a remplacé, celui des mondialistes face aux souverainistes. Et ce clivage est « trans-partisans ». Les remous qu’il a fait naître ont entraîné une désaffection des adhérents des partis dits « de gouvernement » (PS et UMP puis LR) et ceux-ci ne s’en sont pas remis.
Afin de tenter d’inverser cette hémorragie, ils ont essayé d’imposer la rémanence du clivage droite/gauche en inventant deux nouveaux vocables : le populisme et le progressisme pour susciter l’idée que la droite (voir l’extrême-droite) était populiste et la gauche, progressiste.
Tout ceci a conduit notre pays dans une impasse gouvernementale et constitutionnelle dont il doit à tout prix se sortir. Le courant souverainiste, déjà majoritaire en 2005, n’a cessé de croître et devient aujourd’hui incontournable. Celui ou celle qui sera élu lors de la prochaine élection présidentielle ne le sera que s’il réussit à rassembler tous les souverainistes. Alors les paroles prophétiques de de Gaulle prendront tout leur sens :
« Le jour va venir où, rejetant les jeux stériles et réformant le cadre mal bâti où s’égare la nation et se disqualifie l’Etat, la masse immense des Français se rassemblera sur la France » ( C. de Gaulle Bruneval 1947 )
Jean Goychman
Illustration : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine..



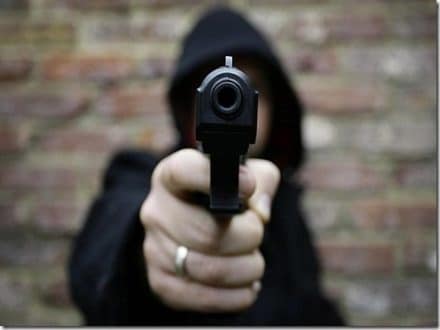

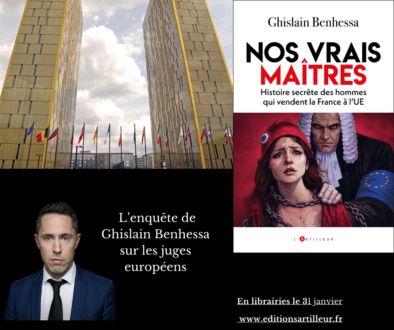








5 réponses à “La gauche progressiste, nouvel habit du mondialisme”
Partout où la gauche est passée ce ne sont que des appauvrissements des populations, des catastrophes économiques, des dictatures sanglantes ( Cuba, Staline, Kmers Rouges etc..) leur idéologie empêche toute réussite économique et condamne le pays à un totalitarisme terrifiant.
Le mensonge de base est déjà dans le fait de dire qu’il y a un peuple français… Lorsque Louis XIV s’est addressé au pays, il s’est adressé auX peupleS de France « L’espérance d’une paix prochaine était si généralement répandue dans mon royaume que je crois devoir à la fidélité que mes peuples m’ont témoignée pendant le cours de mon règne, la consolation de les informer des raisons qui empêchent encore qu’ils ne jouissent du repos que j’avais dessein de leur procurer. » https://carnet-dhistoire.fr/anecdotes/lappel-du-12-juin-1709-dernier-coup-politique-de-louis-xiv/
Le coup d’ingénierie sociale mis au point par les ennemis des peuples, ceux qui veulent les réduire à l’esclavage (économique et idéologique), est le principe de redéfinition des termes à travers des slogans, et en l’occurrence, de la formule qui équipare (https://cnrtl.fr/definition/dmf/%C3%A9quiparer) les mots « nation » et « peuple ».
Voici les définitions de ces deux mots d’avant 1789:
Nation: « Terme collectif. Tous les habitans d’un même État, d’un même pays, qui vivent sous les mêmes lois, parlent le même langage, &c. Nation puissante. Nation belliqueuse, guerrière. Nation civilisée. Nation policée. Nation grossière. Nation barbare, féroce, cruelle. Méchante nation. Chaque nation a ses coutumes, ses mœurs. Il n’a aucun des défauts de sa nation. La nation Françoise. La nation Espagnole. La nation Allemande. La nation Angloise. L’humeur, l’esprit, le génie d’une nation. Toutes les nations de la terre. Les nations Septentrionales. Les nations Méridionales. Un Prince qui commande à diverses nations. Il est Espagnol de nation, Italien de nation. »
https://cnrtl.fr/definition/academie4/nation
Peuple: « Terme collectif. Multitude d’hommes d’un même pays, qui vivent sous les mêmes lois. Le peuple Hébreu. Le peuple Juif. Le peuple d’Israël. Le peuple Hébreu a été appelé le peuple de Dieu. Le peuple Romain. Les peuples Septentrionaux. Les peuples d’Orient. Les peuples Asiatiques. Les peuples du Nord. Les peuples de Provence, de Dauphiné, &c. Tous les peuples de la terre. »
https://cnrtl.fr/definition/academie4/peuple
Équiparer les deux notions, c’est imposer du coup que tous les habitants du pays aient les mêmes lois: par conséquent les conditions de vies différentes ne sont plus prise en considération pour l’application des principes législatifs à leur mise en œuvre par des lois. Donc les habitants du Doubs ont l’obligation de se chauffer de la même manière que les Parisiens! Ce principe est tellement ridicule que même les tyrans qui nous gouvernent ont été obligés de tenir compte des particularités des ultra-marins et que donc « l’universalité de la loi » ne s’applique pas de manière si universelle que cela…
Comme les différences de langues et de culture sont fortement liées aux différences de condition de vie et servent donc de support à la justification des particularités législatives de chacun des peuples d’une nation donnée, ces différences de langues sont honnies par les tyrans…
»La Gauche » n’est pas »progressiste » et »la droite » n’est pas »conservatrice »!…Ce n’est pas faire preuve de progrès de relâcher les délinquants qui ont attaqué des policiers…mais la »Justice » est de »gauche » …Monsieur Retailleau(qui est »de droite ») a raison de punir les délinquants afin d’assurer la sécurité des Français…ceci n’est pas »être conservateur »!..
les mondialistes sont criminels, aller voir comment l’herbe est plus verte ailleurs puis rentrer chez soi est tellement formatrice. je ne me lasse pas d’aller à l’étranger (jusqu’à aujourd’hui 58 pays visités
Pierre: »Le mensonge de base est déjà dans le fait de dire qu’il y a un peuple français… »
Bigre! Vous n’allez pas faciliter le travail des constitutionnalistes, ni celui des juges supposés rendre la justice « Au nom du peuple français »
Le problème de fond que vous posez revient à accepter ou non la « souveraineté populaire » qui est concédée au peuple tout entier. Ce peuple se définit uniquement par l’appartenance à la nation française d’où la notion de « nationalité ». Si vous contestez, et c’est votre droit, la réalité d’un peuple français, c’est toute la nation que vous faites disparaître, mais vous la remplacez par quoi?