Il y a des réquisitions qui laissent pantois. À Saint-Brieuc, le parquet a requis six mois de prison avec sursis contre un gendarme du PSIG de Guingamp, ainsi qu’une interdiction de port d’arme pendant trois ans et même une interdiction définitive d’exercer toute fonction publique.
Son crime ? Une tape, oui, une simple tape à l’arrière du crâne d’un individu en pleine crise, ivre, violent, et menaçant, lors d’une intervention particulièrement tendue.
Les faits remontent à mars 2024. Ce soir-là, les militaires sont appelés en renfort par les pompiers – ce qui est déjà la preuve d’une situation potentiellement dangereuse pour les pompiers surtout lorsque le PSIG est appelé – pour un homme suicidaire prêt à se défenestrer. L’opération, déjà délicate, vire rapidement au chaos.
Les gendarmes, après avoir amené le suicidaire à l’ambulance des pompiers – se retrouvent face à plusieurs individus agités, alcoolisés, et probablement sous l’emprise d’autres substances, qui s’en prennent verbalement puis physiquement aux forces de l’ordre et aux pompiers. Des insultes fusent, des projectiles sont lancés depuis le balcon.
Face à cette tension extrême, les gendarmes remontent à l’appartement avec l’accord du locataire pour maîtriser les fauteurs de trouble. L’un d’eux, hystérique, se débat violemment, refuse d’être menotté malgré la présence de plusieurs militaires. Le taser est utilisé, sans effet, c’est dire l’état de l’individu. C’est alors que le gendarme en question porte une tape derrière la tête de l’individu pour tenter de détourner son attention et finaliser l’interpellation. Le geste, purement défensif et de désescalade, a suffi à apaiser la situation.
Et pourtant, c’est lui qui se retrouve aujourd’hui dans le box des prévenus.
Une réquisition disproportionnée et inquiétante
Que le parquet puisse requérir, pour un tel acte, une peine qui signerait la mort sociale et professionnelle d’un militaire, interroge profondément. D’autant que les images des caméras-piétons, exploitées dans l’enquête, confirment qu’il ne s’agit pas d’une violence gratuite, mais bien d’un geste isolé dans un climat d’extrême tension.
Son avocat, Me Fabian Lahaie, a dénoncé une “chasse aux sorcières”, rappelant que son client avait, quelques mois plus tôt, signalé à sa hiérarchie des comportements inappropriés de son supérieur, depuis muté et visé par une enquête. Une “coïncidence” troublante. Mais rien n’y fait : le ministère public veut une tête. Celle d’un gendarme qui, en dix ans de service, n’a jamais failli, et qui ce soir-là a simplement fait ce que n’importe quel collègue aurait fait pour éviter que la situation ne dégénère.
L’affaire illustre jusqu’à la caricature le fossé abyssal entre ceux qui interviennent et ceux qui jugent.
Comment des magistrats peuvent-ils mesurer la tension d’un face-à-face nocturne, dans un appartement exigu, avec plusieurs individus alcoolisés et agressifs ? Peut-être faudrait-il, comme le suggèrent certains militaires ou policiers, qu’un jour un magistrat accompagne une patrouille du PSIG en intervention réelle, pour comprendre ce qu’est un KO opérationnel, cette zone grise où chaque geste peut faire la différence entre la maîtrise et le drame.
Un signal désastreux envoyé aux forces de l’ordre
Si le tribunal devait suivre ces réquisitions, il enverrait un message clair : mieux vaut ne rien faire, ne pas intervenir, ne pas risquer d’être accusé. Dans un contexte où les agressions contre les gendarmes et policiers explosent, où les interventions dégénèrent de plus en plus souvent, ce type de décision ne fera qu’alimenter le découragement des forces de l’ordre.
Le jugement est attendu le 27 novembre. Un gendarme risque sa carrière pour une tape donnée dans le feu de l’action, tandis que tant d’agresseurs, multirécidivistes, sont remis en liberté le lendemain. Un pays qui juge ses protecteurs plus durement que ses fauteurs de trouble est un pays malade de sa justice.
Illustration : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



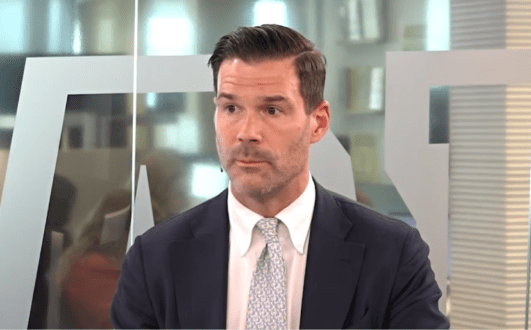
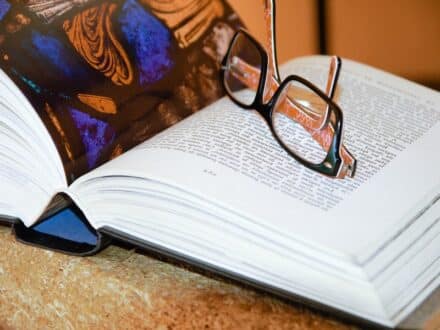

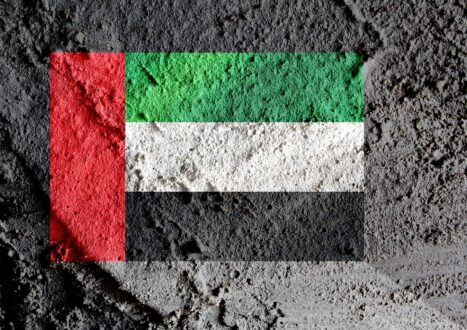


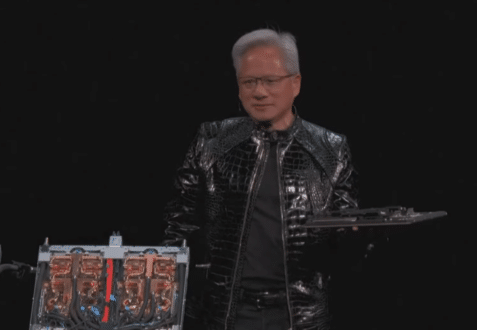




7 réponses à “Guingamp. Six mois de prison avec sursis requis pour une tape derrière la nuque en intervention : la justice veut-t-elle la tête d’un gendarme ?”
Mais où allons nous ?
nous somme vraiment dans un pays de Me…ou allons nous ce sont ces juges qu’ils faut interdire à ces emploies
Là où Macron a été élu pour mener la France, au CHAOS.
Bravo les juge rouges !!!
La France à la dérive… Jusqu’à quand, jusqu’où ?
Comment aider et défendre ce gendarme?
« Méfiez vous des juges. Ils ont tué la Monarchie, ils tueront la République » Mitterrand 1995
Je ne pense pas que ce soit « Un signal désastreux envoyé aux forces de l’ordre » car ça leur donnera des occasions pour se rebeller, occasions du style « la caméra ne marche plus », systématiquement, ou bien un de ces magistrats appelle la police… qui lambine (à faire sous faux drapeau :)) ) : « on était occupé, nous ne sommes pas assez nombreux », etc.