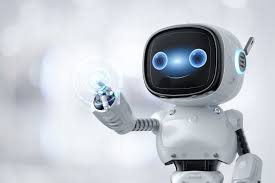Avec Terre d’Empire, Patrice Mongondry signe un essai ambitieux qui entend sortir le Maine de l’ombre où l’ont relégué deux siècles de centralisme français. Loin du simple régionalisme nostalgique, son ouvrage plonge aux racines profondes de la Neustrie — cet ancien royaume mérovingien entre Loire et Manche — pour y déceler l’âme d’une Europe du Nord-Ouest unie par la culture, le sang et l’histoire.
À rebours du récit national jacobin, Mongondry défend l’idée d’un espace celto-germanique cohérent, traversé par le souffle des Francs, des Bretons et des Vikings.
Dans cet entretien accordé à Breizh-info.com, il revient sur la genèse de son livre, sur la permanence de l’esprit septentrional, et sur la vocation du Maine comme Terre du Milieu entre mondes celtiques et germaniques — une réflexion historique, mais aussi profondément identitaire et civilisationnelle.
Breizh-info.com : Quelle a été la genèse de Terre d’Empire ? Qu’est-ce qui vous a poussé à revisiter l’histoire du Maine et de la Neustrie sous cet angle ?
Patrick Mongondry : Je crois que la motivation première qui a présidé à l’écriture de ce livre est la volonté de sortir de l’ornière du « régionalisme » restrictif et infantilisant. Loin d’être une rêverie lumineuse, l’appartenance du Maine au Nord-Ouest européen est une réalité historique, culturelle et ethnique. Cette filiation charnelle transcende le cadre national étroit dans lequel on a trop tendance à l’enfermer. Terre de brume et Terre du Milieu, d’entre Bretagne et Normandie, le Maine a toujours porté son regard vers le Nord depuis les temps immémoriaux de l’âge du bronze. Espace pivot, le Maine a connu à de nombreuses reprises au cours de son histoire tumultueuse le souffle du norrois, vagues successives de peuples divers venus du Nord, qui a profondément imprégné notre terre ancestrale. Celtes, Saxons, Francs, Bretons, Viking, Normands, Anglais, tout un monde germanique et scandinave s’est abattu sur le Maine laissant après le ressac un apport ethno-culturel qui a marqué au fer rouge les pays Mainiois. Cet héritage est norrois, c’est à dire commun à toute l’Europe du Nord-Ouest, moteur de notre vieux continent. C’est le vieux monde celto-germanique. Le monde franc de la Neustrie mérovingienne puis carolingienne a fait du Maine la pierre angulaire des terres d’Outre-Loire.
Dès l’Antiquité, la Loire apparaît comme une frontière ethnique aux yeux de tous. Phénomène corroboré aujourd’hui par les études paléo-génétiques. Au Sud, l’Aquitaine, le pays des eaux, est alors un pays distinct des peuples celtes par ses origines et par sa langue. Une division ethnographique qui ne sera jamais démentie. A contrario, à l’Est, le Rhin n’a jamais constitué une séparation entre des peuples frères. De part et d’autre du fleuve, Germains de l’Ouest et Germains de l’Est, aux tempéraments identiques, partageaient la même langue. Seule l’Antiquité romaine avec le Limes Germanix et le traité de Westphalie de 1648 marquent une limite franche. Le sentiment d’appartenance à la nation et à la langue française ne sera imposé que par le jacobinisme centralisateur de la Révolution. De sorte que, de la Loire à la Frise, s’étire un même espace norrois, composé d’anciens royaumes francs et germaniques parfois héritiers du monde celte comme la Bretagne ou le Maine.
Vous décrivez la formation de la France comme une construction « volontariste » et non naturelle. Peut-on dire que votre livre remet en cause le roman national traditionnel ? Votre texte évoque une « France du Nord » oubliée. Pourquoi cette Neustrie vous semble-t-elle essentielle à redécouvrir aujourd’hui ?
Patrick Mongondry : Je ne suis certes pas le premier à revendiquer l’unité du Nord-ouest européen comme ensemble géopolitique cohérent et historique. Il faut relire à cet effet Olier Mordrel et son indépassable Mythe de l’hexagone. Pour l’homme moderne de notre temps, il est difficilement concevable que la France telle qu’elle nous apparaît aujourd’hui ait pu être complètement différente si le contexte historique l’avait imposé. En effet, chacun s’accorde désormais à définir la formation territoriale de la France comme une construction purement volontariste. Rien ne prédisposait le territoire national à devenir ce qu’il est de nos jours, et les trop fameuses frontières naturelles dont on nous rabâche les oreilles à longueur de temps ne sont bien souvent que des artifices destinés à consolider l’idée du roman national. Tant il est vrai que divers scénarios auraient pu bouleverser radicalement le schéma traditionnel. Parmi d’autres, la Bretagne de Nominoé au IXe siècle, comme le rêve bourguignon du XVe siècle, possédaient toutes les chances de pérennisation d’états viables et durables, modifiant de fond en comble les limites du territoire français.
Plus important que la Neustrie elle-même, c’est le véritable continium qui anime cet espace du Nord-ouest européen qui doit nous interroger. Depuis presque 5000 ans, l’histoire nous révèle qu’il existe une entité géographique, climatique et ethnique aux contours immuables née dans le bassin des mers du Nord. Cette société homogène, possédant les mêmes codes, les mêmes valeurs et une histoire commune couvre l’espace allant de la Loire à la Frise et englobe les îles britanniques. Dès l’âge du bronze moyen (-1500/-1150), ces régions appartiennent à un même réseau économique et partagent une même identité culturelle, nous disent les archéologues. C’est ce qu’ils désignent comme le complexe techno-culturel Manche-Mer-du-Nord. Sous les romains, l’Armorique englobe les peuples répartis entre Loire et l’Escaut. Au Ve siècle, cet espace ethnique, géographique et culturel devient le Royaume de Syagrius, Romanorum rex gallo-romain luttant contre les grandes invasions en Gaule du Nord. Puis, sous l’effet de l’expansion franque, ce sont les royaumes mérovingiens d’avant la bataille de Vouillé (507) qui occupent cet espace septentrional. Le massif des Ardennes, la vaste silva carbonaria, la forêt charbonnière, constitue un tel obstacle que la loi salique dans sa version la plus ancienne y reconnaît la limite orientale du monde Franc, la frontière méridionale étant formée par la Loire.
Dans sa plus grande extension, la Neustrie s’étendait de la Loire à la Frise affichant tout naturellement un particularisme du nord-ouest qui épouse admirablement les limites continentales du complexe techno-culturel Manche-Mer-du-Nord. Conformément à la tradition germanique, Charlemagne désira avant sa mort organiser le partage de son empire entre ses trois fils chargés de prendre sa succession. Lors de la diète de Thionville en 806, l’Empereur divisa donc le royaume en trois parts délimitant une Francie au Nord, Neustrie et Austrasie, (Charles) et une Aquitaine au sud (Louis) dans la continuité de l’espace romain Wisigoth de Toulouse. Pépin devait hérité quant à lui d’une grande Italie débordant largement de son cadre étroit. Charlemagne consacrait ainsi la frontière de la Loire et maintenait les réalités ethniques de son territoire depuis la naissance de l’espace Franc. C’était le cadre idéal pour que fleurissent trois civilisations en gestation, l’une germanique, l’autre occitane, la troisième latine. Mais ce projet respectueux des identités devint caduc après la mort prématurée de Pépin (810) et de Charles (811).
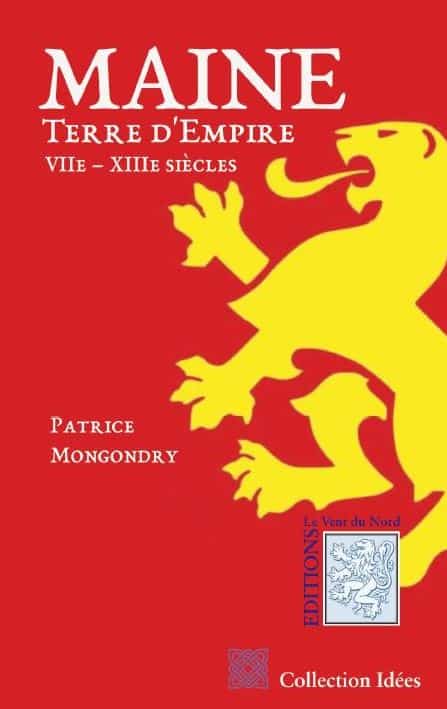
Vous parlez des Rorgonides comme d’une « aristocratie d’Empire ». Peut-on voir en eux les fondateurs d’une civilisation du Nord distincte du modèle latin ?
Patrick Mongondry : J’emprunte ici les termes de l’historien François Doumerc auteur d’une thèse remarquable sur ce sujet.
Le destin des Rorgonides (600-878) se joue entre Seine et Loire, au cœur de cette seconde Neustrie organisée autour du Maine, l’un des plus grands pagi de l’Empire carolingien. Le terme Rorgonide vient de Rorgon, comte du Maine décédé en 840 et personnage considérable. Austrasien d’origine scandinave, Rorgon est un descendant direct du Duc du Maine Roger nommé vers 700 par Pépin II. Donald Charles Jackman, médiéviste et linguiste américain d’origine australienne, a bien montré que Roger à toutes les chances d’être un parent du chef Viking danois Rorik, qui a régné sur certaines parties de la Frise entre 841 et 873. Fier de cette origine scandinave, le comte Rorgon eut plusieurs fils qui occupèrent de très importants postes (honores) au sein de l’Empire carolingien.
Dans un premier temps, les Rorgonides vont chercher à dominer la Neustrie (600 – fin IXe) puis après la mort du comte Gauzfrid en 878, ces grands Princes du Maine tenteront de trouver des solutions de repli au-delà de la Seine, plus au Nord, dans l’espace germanique. De manière hautement symbolique, chaque fois que les Rorgonides auront besoin de reconstituer leurs forces, ils trouveront refuge au-delà de la Loire perçue comme une frontière ethnique et culturelle, un au-delà différent. L’année 832 constitue l’apogée de la puissance personnelle de Rorgon. Il règne en effet sur un vaste espace englobant l’Anjou (avec l’achèvement de la restauration de l’abbaye de Glanfeuil), le Maine (il est comte à partir de 831), le Vannetais (en 832, le comte du Maine est également impliqué dans la fondation de l’abbaye de Redon), le Rennais (il débuta comme comte de Porhoët dont il continue de contrôler le secteur) et le Nantais. L’influence rorgonide s’exerce aussi plus au nord, dans l’Avranchin, soit par l’action directe de Rorgon, soit par le fait d’alliance familiales opportunes. Ainsi, c’est en réalité un territoire immense que Rorgon contrôle de manière officielle ou officieuse. Le Grand Maine grignote la Bretagne naissante, la première Normandie et exerce son emprise sur l’Anjou. Face à la Francia, Rorgon établit une domination solide de son territoire lui permettant désormais de lorgner vers le sud.
Quelle était la spécificité du Maine au sein du monde carolingien ? Était-ce déjà une marche entre mondes celtiques et germaniques ? Vous écrivez que la Neustrie « symbolise la sécession culturelle, politique et administrative des peuples du nord-ouest ». Peut-on parler d’un proto-particularisme breton et normand ?
Patrick Mongondry : Véritable pays en soi, la Neustrie symbolise ce particularisme fort des peuples du nord-ouest (Karl Ferdinand Werner parlera à ce propos d’un pays oublié) et leur sécession culturelle, politique et administrative, véritable permanence historique.
Un particularisme qui va s’accentuer davantage encore sous l’action des carolingiens austrasiens définissant la Francia comme l’espace reliant la Seine au Rhin. Pour les régions d’entre Seine et Loire, Ultrasequanenses ou Transsequani, une habitude se prend au VIIIe siècle de donner des responsabilités particulières dans ce pays au premier fils du roi (Charlemagne sous Pépin, Charles sous Charlemagne) et finira par prendre le caractère d’un Unterkönigtum qui sera renouvelé, au profit du fils cadet. A tel point qu’en 838, Charles le Chauve devient roi du Maine sur décision de son père, Louis le Pieux. Le duché du Maine (ducatus Cenomannicus) est alors assimilé à un royaume (regnum). En 880, à la mort de Louis le Bègue, la Neustrie et la marche de Bretagne, c’est à dire le duché du Maine, est une nation consacrée (KF Werner). Ainsi, durant plus de deux siècles (du VIIIe au IXe siècles), la primauté stratégique et politique du Maine va se traduire par l’homonymie des expressions Duché du Maine et Royaume de Neustrie. C’est l’âge d’Or de cette vieille terre d’Occident. Comme l’écrivait l’historien Jean-Christophe Cassard, le Maine est « un repaire d’opposants fiers du passé prestigieux de ce fragment de Neustrie. »
Vous décrivez avec force le rêve d’un empire transmanche reliant le Maine, la Normandie et l’Angleterre. Était-ce une préfiguration d’une Europe du Nord unie ? En quoi les Plantagenêt, et notamment Geoffroi le Bel ou Henri II, ont-ils incarné un idéal politique différent du centralisme capétien ?
Patrick Mongondry : Dans son ouvrage fondamental, David Bates a beaucoup insisté sur le contraste entre la prise du Maine en 1063 par Guillaume le Bâtard et sa conquête de l’Angleterre trois ans plus tard. Certes, « La présence d’habitants du Maine à la bataille d’Hastings et au cours des campagnes qui suivirent témoigne de leur participation active à la création du nouveau monde en 1066. » La prise de l’Angleterre en 1066 parachève la création d’un empire transmanche qui s’étend des marches écossaises au Maine et dont les trois parties, Normandie, Maine et Angleterre, gardent leurs caractères distinctifs malgré l’apparente unité. Un héritage qui sera relevé plus d’un demi-siècle plus tard par deux hommes d’exception. Refusant de s’enfermer dans les frontières du seul Maine, Geoffroi et Henri II Plantagenêt, nés au Mans, conçoivent leur espace dans un ensemble norrois qui implique de ne pas considérer comme étrangers les Bretons et les Normands, les Irlandais et les Anglais, les Gallois et les Écossais. Les Plantagenêt nous rattachent, dans un même espace géopolitique et ethnique, aux Îles britanniques. La Manche, comme la mer du Nord, rapproche au lieu de séparer. L’enracinement folklorique de la légende arthurienne dans le Maine, ce que Amaury Chauou nomme l’idéologie Plantagenêt, tisse d’indéfectibles liens de parenté mythologique et spirituelle entre notre pays et l’outre-Manche.
Mais l’empire n’était pas voué à perdurer. Depuis 1152, date du mariage d’Henri le Mainois avec Aliénor d’Aquitaine, fille du Grand Midi, l’ambition commune sera désormais d’unir la façade maritime armoricaine sur un axe Caen-Le Mans-Poitiers alors que la destinée de l’empire marquait le Nord. Or créer du lien à l’échelle d’un territoire englobant des communautés de cultures dissemblables se révélera impossible. Aucun mythe rassembleur ne s’avérera opérationnel entre le Nord des chevaliers et le Sud des troubadours, entre les pays de langue d’oil et ceux de langue d’oc. La légende arthurienne fonctionnera bien en Neustrie et dans les îles britanniques. Elle sera incompréhensible au Sud de la Loire. Avec l’avènement de Richard, le tropisme méditerranéen prend une nouvelle ampleur. Seules deux choses comptent pour le jeune roi : l’Aquitaine et la croisade. Il est révélateur que durant ses dix années de règne, Richard ne passera que six mois en Angleterre. Très proche du limousin et du monde culturel de sa mère, Coeur de Lion a passé son enfance à Poitiers, au milieu des troubadours et des danseuses arabes du monde ibérique. Son univers mental est radicalement tourné vers le Sud.
Pourquoi, selon vous, le Maine a-t-il résisté davantage à la centralisation française que d’autres régions ?
Patrick Mongondry : Cette notion de Marche, de Confins des terres occidentales est la pierre angulaire de notre identité. Elle occupe une place dominante dans notre mémoire collective. L’isolement dû aux barrières forestières et au bocage environnant a créé un type d’homme fier, farouchement indépendant et maître chez lui. Jusqu’au cataclysme de la Révolution, les Mainois sont d’une foi douteuse, mêlant anarchiquement catholicisme et néo-paganisme. Pour ce peuple dont le folklore et les anciennes traditions celtes rythment la vie, le village constitue un pôle solide dont le prêtre est le repaire. Le prêtre de village succède ainsi au druide de l’oppida. Le paysan Mainois reste en effet fondamentalement attaché à sa terre. Il est celui qui habite, celui qui défend les mœurs des générations précédentes et qui protège cette proximité humaine à travers les liens qui obligent chaque homme envers sa famille, ses proches, sa communauté. Née dans le Maine, la chouannerie, véritable guerre de paysans, exprime la persistance d’une culture profondément enracinée et héritée du monde ancien, une forme d’autodéfense communautaire. C’est la résurgence de cette nation rude et indomptée qui refuse la soumission, d’où qu’elle vienne, et se montre attachée à une tradition. Une communauté de destin vieille de deux mille ans qui fait naître une contestation radicale. C’est ce que Paul Bois appelle de son côté l’existence de personnalité collectives populaires et la persistance de l’idéologie qui les symbolise. Le Maine est la figure centrale de ce qu’Olier Mordrel appelait la ceinture réticente au jacobinisme parisien.
Votre texte fait écho à Sylvain Tesson, que vous citez. Vous reconnaissez-vous dans son idée d’un arc celtique ?
Patrick Mongondry : Aussi séduisante que puisse paraître cette idée (contrepoids utile à l’idée lotharingienne), je ne suis pas favorable à cette notion d’arc atlantique dans la mesure où elle me paraît à la fois artificielle et incohérente pour les raisons déjà évoquées. La cassure s’opère sur la Loire. Ne pas tenir compte de cette frontière historique et ethno-culturelle me semble inopérant.
A cette notion d’arc atlantique j’oppose l’idée du Nord-ouest. La terre Mainioise se rattache culturellement au monde celto-germanique, notre identité de destin. Je refuse de me laisser enfermer dans les frontières du seul Maine. Il ne s’agit pas de défendre un pays sclérosé et replié sur lui-même mais résolument tourné vers son monde naturel, son espace culturel, l’Europe du Nord-Ouest : ouverture vers les mondes normand, flamand, frison, et breton, vers les espaces britannique et germanique.
Notre Monde annonce un grand projet ethno-culturel Manche-Mer-du-Nord. Une politique basée sur le principe géopolitique d’une levensruimte, selon l’appellation thioise, exclusivement Nord-Ouest européenne. Bretagne, Maine, Normandie, Irlande, Royaume-Uni, Dietschland (Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Frise Orientale), Norvège, Dannemark, Suède, Islande, Faroës expriment la solidarité celto-germanique du Nord-Ouest de l’Europe. Une voûte nordique existe depuis les temps reculés du néolithique dont la base occidentale est l’Irlande et la base orientale la Norvège. Elle regroupe les peuples issus du complexe techno-culturel Manche-Mer-du-Nord, de la céramique cordée et du Campaniforme. Le Nord-Ouest se caractérise ainsi par des critères géographiques comme ethnographiques.
Rapprocher, réunir des peuples administrativement et nationalement distincts mais qui organiquement sont les mêmes. Renouer avec la Tradition impériale. Empire de la brume glacée et du vent cinglant, du chêne et du granit, du roi Arthur, et de Siegfried, des Nibelungen et des Eddas. Œuvrer au renouveau culturel du Maine et de notre monde norrois. Nous voulons être Mainiois afin de devenir Européens. Dans une vision futuriste bio-régionale, il s’agit en somme de faire coïncider un organisme politique avec son socle ethnique et culturel. Et faire de cet espace du Nord-Ouest européen une entité géopolitique à part entière.
Le Maine est le pays Axial, la fameuse Terre du Milieu imaginée par J.R Tolkien, passerelle entre les mondes celtiques et germaniques. Nation carrefour, pivot de l’espace Nord-Ouest européen, sa vocation culturelle est d’unir ces pôles complémentaires.
Outre Olier Mordrel, une multitude d’écrivains ou de philosophes ont réfléchi sur la question. Jean Mabire bien sûr, que le rêve nordique animait. Mais aussi Pierre Drieu La Rochelle, ou plus surprenant, Jean-Edern Hallier qui se définissait lui-même comme un Breton tourné vers l’Irlande et le sud de l’Angleterre. Relisons à cet égard les excellents numéros de la revue Artus qui défendait l’unité des pays celtiques et du monde nordique.
Je suis convaincu que l’espace géopolitique de la communauté des peuples de la Manche et de la Mer du Nord peut constituer un mythe mobilisateur cohérent pour le XXIe siècle.
Peut-on dire que Terre d’Empire est aussi une réflexion sur la permanence de l’esprit septentrional — breton, normand, anglo-saxon — face à l’uniformisation culturelle ?
Patrick Mongondry : Absolument. Sinon, à quoi doit-on de subir ce tropisme doucereux pour les bords de mer bretons battus par les flots et les embruns, les pérégrinations au milieu des chemins creux normands, le charme douillet des cottages anglais ? A quoi doit-on de se sentir chez nous au cœur des paysages arides et brumeux d’Écosse, des canaux mélancoliques des Flandres, de la chaleur conviviale des pubs irlandais et des estaminets du Nord ou des châteaux en ruine du Pays de Galles ? A quoi cela tient-il que nous soyons émus aux larmes par le son torturé d’une cornemuse qu’accompagne le chant mélodieux d’une jeune femme un soir d’automne sans lune ? Pourquoi s’abandonne-t-on rêveusement à la lecture de Xavier Grall, Barbey d’Aurevilly, Liam O’Flaherty, James Joyce, William Butler Yeats, Robert Louis Stevenson, Alexander Cordell, Daphné du Maurier, Emile Verhaeren, Stijn Streuvels et tant d’autres encore qui sont en eux même l’expression la plus criante de leur patrie ? Cette carte sentimentale dessine pour nous les contours de l’Europe du Nord-Ouest, notre Monde, notre respiration lente et quotidienne. Ces tracés nets qui sortent des guirlandes de brouillard, des ombres et des brumes, sont notre lien, notre cordée invisible avec nos racines les plus lointaines. Cet espace est notre communauté de culture, notre géographie sacrée.
Patrice MONGONDRY, MAINE Terre d’Empire, 18€ disponible sur commande en librairie ou directement sur le site des Éditions Le Vent du Nord : https://editionsleventdunord.com/
Propos recueillis par YV
Crédit photo : PIxabay ()cc)
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine