Revenu de ma promenade à la pointe de la digue de Lechiagat, j’écris ces lignes depuis le bar des Brisants, là où la mer se retire dans un chuintement d’écume, laissant sur le sable la trace oblique des barques. Le vent d’ouest s’engouffre par la porte vitrée, les journaux traînent sur le comptoir, encore humides de pluie. Le Figaro, grave et compact, consacre deux pleines pages à l’attentat d’Oléron: les faits, l’enquête, deux éditoriaux puissants, lucides, qui nomment l’ennemi. À côté, Libération : une mince colonne, un ton de commisération polie, comme si tout cela ne regardait pas le monde qu’il décrit.
Le contraste est saisissant. Dans Le Figaro, on apprend qu’un homme de trente-cinq ans, Français converti à l’islam, a percuté volontairement des passants sur l’île d’Oléron, blessant grièvement plusieurs d’entre eux, avant de crier Allah Akbar et de mettre le feu à sa voiture remplie de bonbonnes de gaz. Dans Libération, il n’est question que d’un marginal, un « gars du coin », pas religieux, « un peu allumé », qui aurait prononcé ces mots par provocation. Tout est là : le refus obstiné de voir ce qui se passe, de dire ce qui est, de nommer le mal.
Ce n’est plus une question d’idéologie, c’est une question d’anthropologie. Depuis des décennies, une partie de la gauche médiatique vit dans la croyance que la violence islamiste est un épiphénomène, une excroissance du malheur social ou de la maladie mentale. Elle refuse d’admettre qu’il s’agit d’un phénomène religieux, donc civilisationnel. Or la religion n’est pas un habit que l’on retire à volonté, c’est un monde intérieur, une source d’énergie. Le converti d’Oléron ne vient pas d’ailleurs : il vient de nous. Il est un Européen vidé de sens, qui trouve dans l’islam la verticalité qu’il ne trouve plus dans son propre monde.
Ce drame n’est pas isolé. Il s’inscrit dans une longue suite d’événements où l’Europe se découvre vulnérable non par faiblesse militaire, mais par épuisement spirituel. Quand les sociétés ne croient plus à ce qu’elles sont, elles deviennent disponibles à tout ce qui croit encore. Le christianisme primitif fit jadis le même chemin au sein de Rome. Louis Rougier, dans Le Conflit entre le christianisme primitif et la civilisation antique, a montré comment, dans un Empire sûr de ses lois et de sa raison, la foi nouvelle se répandit d’abord dans les marges : les esclaves, les femmes, les exclus. L’Empire, tolérant, ne vit pas le danger. Ce n’est pas la force des chrétiens qui fit tomber Rome, c’est la fatigue des Romains.
L’Europe vit la même lassitude. Elle ne croit plus à son histoire, ni à sa mission, ni à sa singularité. Elle se contemple dans les vitrines, elle se justifie au lieu de se défendre. Elle parle de valeurs, non de vérités. Elle confond la charité avec le renoncement. Dans ce vide moral, l’islam n’est pas seulement un intrus : il est la contre-proposition d’une foi encore intacte, d’une certitude qui tranche avec notre relativisme. Comme jadis les dieux orientaux dans Rome décadente, il s’installe dans les failles de la cité.
Pourtant, tout n’est pas perdu. Il y a dans ce désordre des résistances tenaces, encore modestes, mais réelles. Des hommes comme le docteur Alain de Peretti, à travers Vigilance Halal, rappellent que la nourriture, les gestes, les rites du quotidien sont déjà des marqueurs civilisationnels. Les filles de Némésis affrontent sans peur les tenants de la soumission, et rappellent que l’Europe fut d’abord le continent de la femme libre. Des écrivains, des penseurs, Michel Onfray, Renaud Camus, Philippe de Villiers, Alain de Benoist, maintiennent le cap dans le brouillard intellectuel et affirment qu’une civilisation qui se renie n’a plus de raison d’être.
Sur le plan politique, la fracture est visible. Marine Le Pen, dans sa quête d’acceptabilité, répète que « l’islam est compatible avec la République », phrase molle, conçue pour rassurer ceux qui ne croient plus à rien. Éric Zemmour, lui, perçoit la profondeur du drame. Il comprend que le conflit n’est pas sociologique, mais métaphysique. Ce n’est pas la République qu’il faut sauver, c’est l’Europe, dans sa chair, dans son âme, dans ses peuples.
Son dernier livre, Le Premier homme, en porte le témoignage. Ce n’est plus un pamphlet, mais une méditation, presque religieuse, sur l’identité européenne et la nécessité d’un sursaut spirituel. Zemmour y abandonne la posture du polémiste pour celle, plus grave, du témoin. Il décrit une Europe sans transcendance, errant entre les ruines du christianisme et les mirages du progrès, et appelle à une « conversion » non pas politique, mais intérieure. Son propos, quoi qu’on pense du personnage, rejoint celui des grands critiques de la modernité, de Spengler à Jünger, pour qui la survie d’un peuple ne tient pas à ses institutions, mais à sa foi dans le destin.
Et pourtant, j’ose croire que quelque chose se lève. À mesure que s’éteint la vieille foi dans le progrès, d’autres foyers s’allument. Je pense à Victor Aubert et à Academia Christiana, cette pépinière d’esprits jeunes qui cherchent à réconcilier catholicisme et identité, foi et appartenance. Je pense au cardinal Bustillo, en Corse, qui soutient les Palatins, ce groupe d’insulaires voulant rendre au christianisme sa dimension incarnée. Je pense aussi à ces quelques poignées de jeunes Européens qui, dans les forêts, les clairières ou les montagnes, redécouvrent les rites de la religion native de l’Europe, sans haine ni reniement, mais avec le désir de renouer avec la source.
Ce sont des signes faibles, dirait-on, mais ils sont les premiers frémissements d’un printemps. Le renouveau spirituel ne viendra pas d’un décret ni d’un parti, mais du lent éveil des consciences, de la redécouverte d’un sens du sacré que ni les écrans ni les slogans n’ont pu abolir.
Oléron, île de lumière, a vu la mort frapper au nom d’un dieu étranger. Mais dans la stupeur, quelque chose s’est aussi réveillé : la conscience d’un peuple qui ne veut plus s’endormir. Et si la douleur précède la renaissance, alors peut-être, oui, le renouveau européen a déjà commencé.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées
Illustration : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



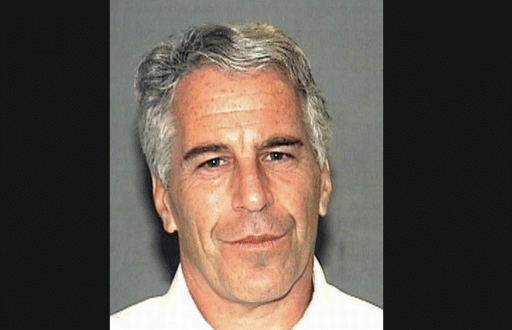


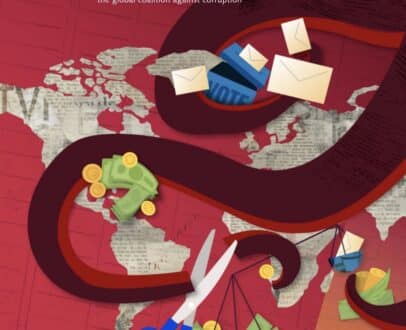





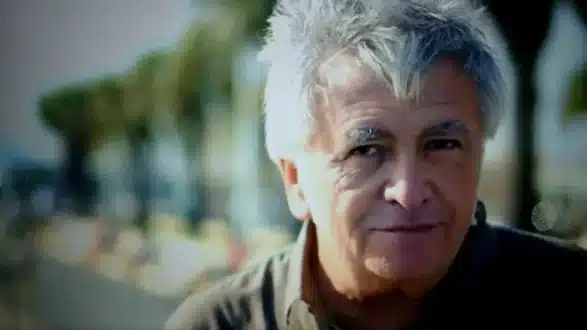

5 réponses à “À Oléron, le choc d’une Europe désarmée face à l’islamisme [L’Agora]”
Merci M. Balbino Katz pour vos réflexions bien pertinentes tous azimut et sans frontières, politiques, sociales et religieuses …. réfléchies contre vents et marées dans les brumes bretonnes. L’Espérance y est toujours, en finale, bien présente. Que le « Bon Dieu » vous écoute.
Encore un musulman »né en France » qui veut tuer des civils innocents en criant »Allahou Akbar »…Je pense qu’il ne faut pas donner la »nationalité française » aux musulmans! Nos médias et »La Gauche française » ne parlent que des Palestiniens de la bande de Gaza tués par les bombes israéliennes mais elles passent sous silence les 150.000 morts du Soudan et les 16 millions de déplacés de ce pays à cause des »Emirats Arabes Unis qui arment le bras des tueurs » comme l’a signalé le député Christian Marion…c’est encore le silence de nos médias et des chancelleries européennes concernant les tortures, les viols »RACISTES » effectués sur des migrants venant de Guinée et du Soudan par les Tunisiens…comme l’a signalé l’ONG Amnesty International dans son rapport du 6 novembre 2025!…
Remarquable analyse, comme toujours…
Tant qu’on attribuera tous les attentats à l’islamisme et non à l’islam, tout cela continuera !
D’ailleurs breizh-info continue…
Dans mon quotidien, je tente de nombreux signaux faibles.
Monsieur Balbino Kratz nous fait là un signal bien balancé !
Merci monsieur!