Devant le bar des Brisants à la Pointe de Lechiagat, pas très loin de la maison où était née ma mère, la mer était d’huile. Sur le plan d’eau, la vedette des sauveteurs oscillait doucement, dorée par les reflets du couchant. Je regardais ce balancement régulier, comme un cœur qui bat au rythme des marées, en lisant sur l’écran de mon téléphone la transcription d’un entretien singulier : Tucker Carlson face à Nick Fuentes. Le premier, figure tutélaire du journalisme conservateur américain, homme de rhétorique et de tempérance ; le second, jeune activiste incandescent, banni des réseaux, honni des universités, mais soudain sorti du purgatoire numérique pour parler, librement, à des millions d’Américains.
On les croyait séparés par deux générations, mais c’est surtout un monde qui les distingue. Tucker Carlson incarne l’Amérique MAGA, celle qui veut encore croire à la Constitution, à la propriété, au drapeau et à Dieu. Nick Fuentes, lui, appartient à la génération née après les attentats du 11 septembre : celle qui n’a jamais vu l’Amérique triompher, mais seulement décliner. À vingt-sept ans, il ne parle plus la langue des think tanks, ni celle des prédicateurs. Il ne cherche pas à convaincre, mais à sauver. Il ne veut pas tant restaurer l’Amérique qu’en préserver le peuple.
L’entretien, d’une longueur inhabituelle, m’a frappé par sa gravité. Fuentes ne parle pas comme un agitateur, mais comme un homme qui croit que la civilisation s’effondre sous ses yeux. Il y a chez lui une forme d’angoisse religieuse, une idée que le politique n’est plus qu’un masque, que la vraie bataille se joue dans les âmes. Quand Tucker Carlson évoque la liberté d’expression, Fuentes répond par la survie ethnique. Quand l’un cite Jefferson, l’autre pense à Spengler. C’est le choc du classicisme américain contre la vision tragique européenne, importée par un garçon né à Chicago, d’ascendance mexicaine par son père, qui rêve d’une Amérique blanche et chrétienne.
Ce contraste dit tout du moment que traverse la droite américaine. Depuis dix ans, le mouvement MAGA de Donald Trump a rassemblé les conservateurs autour du slogan de la grandeur retrouvée : économie libérée, patriotisme assumé, soutien indéfectible à Israël, rejet du wokisme. Fuentes, lui, rompt avec tout cela. Il ne parle pas de croissance, mais de déclin spirituel ; non de marchés, mais de métissage. Là où le trumpisme exaltait la puissance économique, il annonce la guerre culturelle totale.
Ses mots sont crus, souvent brutaux. Il évoque la décadence morale, la perte du contrôle démographique, la dissolution du christianisme. Dans sa bouche, la République n’est plus un cadre, mais une coquille vide. Carlson, visiblement mal à l’aise, tente de ramener le débat sur la liberté : Fuentes lui rétorque que la liberté sans identité n’est qu’un leurre.
Ce renversement idéologique est peut-être le plus grave défi que la droite américaine ait connu depuis cinquante ans. Le conservatisme des années Reagan puis Trump reposait sur l’alliance entre le marché et la foi, entre l’esprit d’entreprise et le patriotisme, sur le refus de l’identité au profit d’une appartenance par l’adhésion au projet politique américain. Fuentes, lui, rejette les deux. Il ne croit plus au libéralisme, ni au capitalisme, ni à l’universalisme américain. Il incarne le retour du sang contre l’idée.
Les commentateurs le traitent de fasciste ou de suprémaciste, mais c’est un mot devenu paresseux. Il me fait plutôt penser à ces jeunes Européens des années 1920, hantés par la décadence de leur continent et qui cherchaient une pureté dans le sacrifice. Il a la voix sèche et le regard fixe d’un homme qui s’attend à la chute. Derrière ses provocations, il y a la nostalgie d’un ordre perdu.
Je refermai mon téléphone, et la vedette des sauveteurs continuait de tanguer doucement. De ce balancement naissait une métaphore : l’Amérique flotte encore, mais son ancrage se détend. Le vieux monde de Carlson résiste, poli et légaliste. Mais, sous la surface, monte une houle jeune, impatiente, identitaire, qui ne croit plus aux promesses de la démocratie.
Le grand débat de demain n’opposera peut-être plus la gauche et la droite, mais deux droites : l’une encore fidèle à l’idée de liberté, l’autre déjà vouée à celle d’appartenance.
Le schisme américain
Quelques jours plus tard, la tempête avait éclaté. Dans la presse américaine, on parlait désormais d’une guerre civile conservatrice.
Ben Shapiro, le moraliste hyperactif du monde républicain, avait ouvert son émission sur ces mots : “No to the groypers !” [ surnom des partisans de Nick Fuentes] Il accusait Tucker Carlson, son ancien compagnon de route, de « laver » un fasciste, de « normaliser » la haine. Durant une heure entière, il fulmina, diffusa des extraits où Fuentes, en effet, glorifiait Hitler, se moquait des femmes et raillait l’Holocauste. Carlson, disait-il, avait trahi le mouvement, trahi l’Amérique, trahi même la mémoire de Charlie Kirk, le jeune agitateur conservateur assassiné quelques semaines plus tôt.
Shapiro, conscience juive de la droite américaine, dénonçait non seulement Fuentes, mais aussi la Fondation Heritage, ce vieux pilier du conservatisme reaganien, coupable de n’avoir pas rompu avec Carlson. Son président, Kevin Roberts, avait déclaré que « le peuple américain attend de nous que nous combattions la gauche, non nos amis ». Il ajouta qu’il « abhorrait certaines croyances de Fuentes », mais refusa de condamner l’entretien, estimant qu’il valait mieux « guider la conversation ». Ces phrases, jugées tièdes par les uns et courageuses par les autres, suffirent à déclencher une crise interne : démissions, insultes, campagnes d’opinion. Le Wall Street Journal accusa Roberts d’être devenu « l’apologiste d’un antisémite » ; des parlementaires juifs exigèrent sa tête. La vieille droite institutionnelle se couvrit de honte et de peur.
Ainsi, à partir d’une simple interview, toute une architecture politique s’effondre. C’est que l’Amérique conservatrice ne sait plus qui elle est. Le trumpisme avait réuni, tant bien que mal, les individualistes et les populistes, les capitalistes et les croyants. Aujourd’hui, cette alliance se brise. D’un côté, les moralistes civiques, défenseurs d’un ordre républicain fondé sur la libre entreprise, la Constitution et le soutien à Israël ; de l’autre, une jeunesse radicalisée, persuadée que le pays a perdu son âme, son sang et son Dieu.
Entre Ben Shapiro et Nick Fuentes, il n’y a plus de terrain commun.
La scène est saisissante : à la même table, l’un parle de morale, l’autre de survie. Shapiro défend une Amérique d’idées, abstraite, légale, et continue de raisonner dans le cadre de la démocratie libérale. Fuentes, lui, parle comme un théologien en guerre, persuadé que le combat politique n’a plus de solution civique. Quand l’un cite Madison, l’autre invoque la Providence. Carlson, en offrant à ce dernier une tribune, n’a pas seulement tendu un micro : il a ouvert la faille.
Depuis, les institutions de la droite américaine vacillent. La Fondation Heritage, naguère colonne vertébrale du conservatisme, chancelle. Les intellectuels, jadis unis par la peur de la gauche, se déchirent entre eux. Le mouvement America First, d’abord marginal, se retrouve soudain au centre du débat, comme un cancer qui devient organe. Fuentes s’en vante ouvertement : “Je ne suis plus le radical de l’extérieur, je suis le leader de l’intérieur.”
Et les chiffres lui donnent raison : ses abonnés explosent sur Rumble, X, et dans les réseaux de jeunes républicains. L’ironie veut que ce garçon banni d’Internet il y a cinq ans soit devenu, par l’entremise de ses ennemis, l’étendard d’une rébellion générationnelle.
Cette fracture dépasse la politique. Elle signe la fin d’un monde. Car le conservatisme américain, depuis un siècle, repose sur une équation : foi protestante, capitalisme national, et confiance dans l’ordre constitutionnel. Or ces trois piliers s’effritent. La foi s’est changée en morale ; le capitalisme, en prédation ; la Constitution, en ruine de papier.
Dans ce vide, surgissent des jeunes gens sans emploi fixe, sans famille stable, nourris de colère et de solitude, qui cherchent dans l’idéologie ce que la société leur refuse : l’appartenance. C’est le ferment de tous les totalitarismes.
Je songeais à ces mots de Guillaume Faye, dans L’Archéofuturisme, que je cite de mémoire : « Les sociétés ne se relèvent pas par les réformes, mais par les révoltes. » Le phénomène Fuentes n’est pas une mode : c’est un symptôme. Celui de la fin du compromis américain entre liberté et identité. Les États-Unis se redécouvrent comme civilisation, donc comme peuple. Et qui dit peuple dit exclusion, frontières, hiérarchie, autant de mots devenus impies dans les salons de Washington.
Il y a cent ans, l’Europe connut ce même vertige : la jeunesse d’après-guerre, trouvant les démocraties épuisées, se tourna vers des idéologies de fer et de foi. Aujourd’hui, c’est au tour de l’Amérique d’éprouver cette tentation. L’entretien de Tucker Carlson avec Nick Fuentes n’est pas un événement médiatique, c’est un avertissement métaphysique.
Il annonce la rupture entre le monde de l’économie et celui de l’histoire, entre l’homme du contrat et l’homme du destin.
La contagion identitaire
Ce qui se joue là-bas, au-delà de la querelle entre Carlson et Shapiro, c’est le retour du sol, du sang et de la mémoire dans la pensée politique. Cette « contagion identitaire », comme disent les universitaires, n’est pas née aux États-Unis. Elle vient d’Europe. Plus précisément, de cette Europe intellectuelle des années 1970 qu’incarna la Nouvelle Droite française. Les jeunes Américains qui citent aujourd’hui Spengler, Heidegger ou Julius Evola, ne savent pas toujours que c’est à travers des traductions de Guillaume Faye, d’Alain de Benoist, ou même de Jean Thiriart qu’ils les ont découverts. Faye, avec son Archéofuturisme, a posé dès 1998 le diagnostic qu’ils reprennent aujourd’hui : la civilisation technologique occidentale s’est coupée de ses racines charnelles, et l’avenir ne peut venir que d’une synthèse entre la science et l’identité.
Ce livre, longtemps introuvable hors de France, circule désormais sur les campus américains, annoté, commenté, brandi comme un manifeste par ceux qu’on appelle les post-MAGA kids.
Cette traduction discrète de la pensée européenne vers l’Amérique a changé la jeune droite américaine plus profondément que Trump lui-même. Là où les conservateurs traditionnels citaient Jefferson, les jeunes nationalistes invoquent désormais les cycles de Spengler, les Types d’hommes de Jünger, ou les mythes faustiens de la technique. Ils n’opposent plus la foi au progrès, mais l’enracinement à l’errance. Pour eux, la question n’est plus « comment défendre la liberté », mais « pour qui la liberté doit-elle exister ».
Là réside la véritable rupture : entre l’universalisme moral hérité du protestantisme et la vision organique de la civilisation. L’Amérique, autrefois messianique, découvre la tragédie. Elle cesse de croire à son élection pour se penser comme peuple menacé. C’est un basculement métaphysique.
On aurait tort de le voir comme une simple dérive extrémiste. Derrière les outrances de Nick Fuentes, derrière le cynisme d’Internet et les délires du complot, il y a un phénomène plus large : le réveil du sentiment d’appartenance, cette pulsation immémoriale que la modernité croyait avoir abolie. L’homme contemporain, saturé d’écrans, d’abstractions, de normes morales, redécouvre qu’il appartient à quelque chose de plus ancien que lui. Ce retour du collectif, après un demi-siècle d’individualisme, est la grande vague du siècle à venir.
Déjà, en Europe, on en perçoit les échos. Les mots de Faye ou de de Benoist, traduits dans des podcasts américains, reviennent, transformés, dans les discours de certains jeunes conservateurs français. Ils y entendent l’appel d’un Occident réconcilié avec sa nature, non plus honteux de lui-même, mais conscient de sa finitude.
Le paradoxe est cruel : la France, qui produisit ces idées, les a marginalisées ; l’Amérique, qui les méprisait, les redécouvre avec ferveur.
L’identité, elle aussi, avance ainsi : non comme un programme, mais comme un reflux du réel. Elle gagne les consciences par fatigue du mensonge. Quand plus rien ne relie les hommes entre eux, ils cherchent dans la race, la foi ou le sol ce que la société leur refuse : un lien, une continuité, un sens.
Ce mouvement n’est pas un vain discours politique : il est organique. Et ceux qui le méprisent au nom de la morale en seront bientôt submergés. Ce que l’Amérique appelle the new right n’est que le nom neuf d’une vieille pulsion européenne : celle qui, de Moeller van den Bruck à Faye, voit dans le déclin non une honte, mais une chance de recommencement.
L’histoire, toujours, se venge de ceux qui doutent d’elle. Le monde américain s’enflamme pour un débat sur l’identité ; le monde français s’interdit d’en prononcer le mot. Et pourtant, les deux finiront par se rejoindre, car la question de qui nous sommes reviendra, comme la marée, balayer toutes les certitudes.
La contagion identitaire n’est pas un péril, c’est un réveil. Un peuple qui redécouvre son visage après des décennies de sommeil idéologique ne commet pas un crime : il se ressaisit. Et dans ce sursaut, fût-il confus, je veux encore voir un signe de vie.
L’avenir appartient à ceux qui auront osé redevenir eux-mêmes.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées




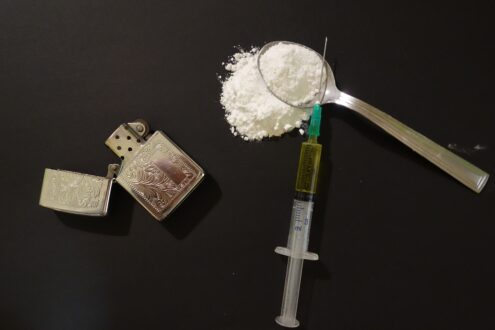









Une réponse à “Tucker Carlson, Nick Fuentes…Le jeune loup, le vieux renard et la contagion identitaire”
Devant le tsunami migratoire et le mondialisme qui submergent le continent européen, l’identité accompagnée de la souveraineté sont les bouées de sauvetage auxquelles il faut s’accrocher si l’on veut survivre.