Sous le slogan « Une nation, une Pologne forte », la capitale polonaise a célébré sa souveraineté dans une atmosphère pacifique, rassemblant plusieurs centaines de milliers de citoyens autour du drapeau et de l’identité nationale.
La Pologne a célébré ce mardi le 107e anniversaire de son indépendance retrouvée, après 123 ans d’occupation russe, prussienne et autrichienne. Et comme chaque année depuis plus d’une décennie, le grand défilé de l’Independence March a rassemblé une foule immense dans les rues de la capitale.
Parti du rond-point Roman Dmowski – du nom du père du nationalisme polonais moderne – le cortège s’est étendu sur plusieurs kilomètres en direction du Stade national, dans une mer de drapeaux rouges et blancs, de torches et de chants patriotiques.
Selon les estimations, la participation oscillait entre 120 000 et 160 000 personnes selon les médias, jusqu’à 250 000 selon les organisateurs.










Une fête du patriotisme populaire
Le mot d’ordre de cette année : « Une nation, une Pologne forte ».
Dans une ambiance à la fois fervente et disciplinée, les participants ont scandé des slogans en faveur de la souveraineté, de la famille, de la foi et de l’unité nationale.
Des banderoles proclamaient :
« Stop Immigration – Time for Deportation »
« Poland for the Poles, Europe for the Europeans »
Des messages clairs, fidèles à la ligne national-conservatrice qui inspire le mouvement depuis ses débuts en 2010.
Certains militants de la Młodzież Wszechpolska (Jeunesse de toute la Pologne) ont symboliquement brûlé un drapeau de l’Union européenne, geste interprété comme un refus du centralisme bruxellois et de la dilution des souverainetés nationales.
Les forces de l’ordre ont salué un déroulement pacifique, preuve que le patriotisme polonais peut s’exprimer avec fierté et discipline.
Un président nationaliste au cœur du peuple
Fait marquant : pour la première fois depuis des années, le président de la République, Karol Nawrocki, a lui-même participé à la marche.
Élu cet été avec le soutien du parti national-conservateur Droit et Justice (PiS), il s’est affiché drapeau en main au milieu des participants, saluant la foule et appelant à l’unité autour de la patrie.
Dans son discours officiel prononcé quelques heures plus tôt à Varsovie, Nawrocki a averti :
« Certains politiciens polonais sont prêts à céder notre liberté et notre souveraineté, morceau par morceau, à des institutions étrangères. Je ne laisserai jamais la Pologne devenir un perroquet répétant passivement ce qui vient de l’Ouest. »
Il a promis de toujours défendre « la Pologne d’abord, et les Polonais d’abord » — un écho direct au slogan souverainiste qui anime de nombreux mouvements identitaires européens.
Les libéraux absents, Tusk plaide la “diversité”
Pendant que Varsovie vibrait au rythme des hymnes patriotiques, le Premier ministre libéral Donald Tusk choisissait de célébrer l’indépendance à Gdańsk, sa ville d’origine.
Là-bas, il a déclaré que « personne n’a le monopole du patriotisme » et que « la diversité est une source de force », des propos interprétés comme une réponse aux manifestants de la capitale.
Son gouvernement, composé d’une coalition allant du centre-droit à la gauche, s’est tenu à distance du grand défilé, préférant organiser des commémorations plus institutionnelles.
Une fracture symbolique, qui reflète la division politique et culturelle entre la Pologne enracinée, catholique et conservatrice, et l’élite libérale tournée vers Bruxelles.
Le 11 novembre marque la renaissance d’une nation après plus d’un siècle de partitions.
Mais pour beaucoup de participants, cette date n’est pas seulement un souvenir historique : c’est aussi un acte de résistance contemporaine face à la globalisation, à l’immigration massive et à la perte des repères européens.
« Nous ne permettrons pas que notre terre soit colonisée par des peuples étrangers », a déclaré Krzysztof Bosak, leader du Mouvement national (RN) et vice-président du Parlement.
« C’est aux Polonais de décider qui entre et qui reste. C’est notre devoir de défendre notre indépendance dans toutes ses dimensions : culturelle, économique et spirituelle. »
Un discours qui trouve un écho grandissant, non seulement en Pologne, mais dans une grande partie de l’Europe centrale, attachée à ses racines et rétive à la dissolution culturelle promue par Bruxelles et Berlin.
A noter également la présence de Tommy Robinson cette année, ainsi que de nombreux Européens, Irlandais, Espagnols, Français, Bretons, Hollandais…
L’Europe des nations contre l’Europe des commissaires
La marche de Varsovie n’était pas qu’un événement polonais : elle a aussi résonné comme un symbole européen.
Sous les bannières rouge et blanche, beaucoup de manifestants affirmaient leur solidarité avec d’autres peuples européens désireux de reprendre le contrôle de leur destin.
Alors que la Commission européenne multiplie les projets de centralisation – qu’il s’agisse d’un service européen du renseignement ou d’un budget commun de défense – la Pologne rappelle, à travers cette démonstration populaire, que la liberté des nations reste la base de l’Europe.
Pour ses organisateurs, cette édition 2025 restera comme la plus apaisée et la plus massive depuis dix ans.
Le message, lui, est clair : la Pologne entend rester catholique, souveraine et européenne par civilisation, non par bureaucratie.
Et dans un contexte de crises migratoires, économiques et géopolitiques, elle montre la voie à une Europe des peuples, debout face à la dilution.
Crédit photo : Breizh-info.com Paul The_stone_edge https://www.instagram.com/the_stone_edge/ (TDR)
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine









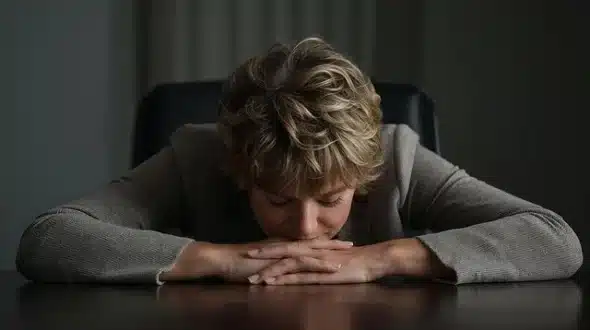




3 réponses à “Pologne : une marée blanche et rouge pour l’indépendance – 150 000 patriotes défilent à Varsovie [Reportage]”
Ahhh ouiii c’est sont des racistes et des fachistes n’est pas.
Merci Mohamed pour votre humour.
TUSK…appartient à l’ancienne « minorité » allemande , son père a été Feldwebel dans la Wehrmacht, avant de changer son fusil d’épaule en désertant et rejoignant la résistance POLONAISE….il suffit de voir sa tete ,ce sont des gens qui sont en POLOGNE depuis 3siècles , au moins , et dont la langue , en famille est toujours le teuton !