Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne relance les tensions entre les États membres et Bruxelles sur la question des compétences nationales
Le 25 novembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt controversé dans l’affaire C-713/23, enjoignant la Pologne à reconnaître les « mariages » entre personnes de même sexe contractés dans d’autres États membres de l’UE. Une décision qui suscite une vive inquiétude à Varsovie et ailleurs sur les velléités de Bruxelles d’imposer une vision uniformisée du droit de la famille à l’ensemble des pays de l’Union.
Une affaire emblématique des tensions croissantes entre droit national et droit européen
L’affaire débute avec la demande de transcription, à l’état civil polonais, d’un acte de mariage contracté en 2018 à Berlin entre deux ressortissants polonais. Le mariage étant conforme au droit allemand, les deux hommes entendaient obtenir la reconnaissance officielle de leur union sur le territoire polonais. Mais en Pologne, l’article 18 de la Constitution de 1997 définit explicitement le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, excluant de fait la reconnaissance de toute forme de « mariage homosexuel ».
Face au refus du bureau de l’état civil de Varsovie, confirmé par le Voïvode de Mazovie et par la justice administrative polonaise, les plaignants ont porté l’affaire jusqu’à la Cour suprême administrative, qui a sollicité une interprétation préjudicielle de la CJUE. Celle-ci a tranché en leur faveur, invoquant notamment les articles 7 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (respect de la vie privée, interdiction de la discrimination), ainsi que l’article 21 du TFUE, garantissant la libre circulation des citoyens européens.
La CJUE dépasse-t-elle ses compétences ?
Dans sa décision, la Cour estime que le refus d’un État membre de reconnaître un mariage conclu dans un autre État membre entrave le droit des citoyens de l’UE à circuler et à s’établir librement, en créant des « difficultés sérieuses dans l’organisation de la vie familiale ». Elle en conclut qu’une telle situation constitue une entrave injustifiée à la liberté de circulation.
Mais pour de nombreux juristes, dont ceux de l’Institut Ordo Iuris à l’origine du commentaire juridique de cette affaire, cette lecture expansive du droit communautaire outrepasse les compétences attribuées par les traités européens. En effet, le droit de la famille, et en particulier la définition du mariage, relève des prérogatives souveraines de chaque État membre. L’article 9 de la Charte européenne des droits fondamentaux laisse expressément aux législations nationales le soin de définir les conditions du mariage.
Un précédent dangereux pour la souveraineté nationale
L’arrêt de la CJUE ouvre la voie à une reconnaissance indirecte des unions homosexuelles dans des pays qui, comme la Pologne ou la Hongrie, refusent d’instaurer le « mariage » pour tous. Ordo Iuris souligne à juste titre que la directive sur la libre circulation des personnes, adoptée avant l’adhésion de la Pologne à l’UE, n’avait jamais été interprétée en ce sens. Cette interprétation extensive apparaît comme une tentative de contourner les textes fondamentaux polonais par la pression juridique et judiciaire.
En 2013 déjà, un projet de loi visant à institutionnaliser les unions homosexuelles avait été rejeté par le Parlement polonais, au motif que cela violerait l’article 18 de la Constitution. Cet article, qui érige le mariage entre un homme et une femme en pilier de l’ordre juridique polonais, constitue désormais un point de friction majeur entre Varsovie et Bruxelles.
Une étape de plus dans la centralisation idéologique de l’Union
Ce jugement s’inscrit dans une tendance plus large de la part des institutions européennes à imposer une lecture unifiée et progressiste des valeurs sociales, souvent en contradiction avec les traditions et volontés populaires des nations membres. Le cas polonais pourrait faire jurisprudence et entraîner à terme une série de contentieux entre États et CJUE, dans un domaine aussi fondamental que la définition de la cellule familiale.
Pour les défenseurs de la souveraineté nationale, il ne s’agit pas ici d’un débat sur le fond du « mariage pour tous », mais d’une alerte sérieuse sur le respect des compétences attribuées par les traités européens. À vouloir uniformiser le droit familial sans base juridique claire, la CJUE sape un peu plus la légitimité de l’Union aux yeux des peuples.
Crédit photo : DR
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine












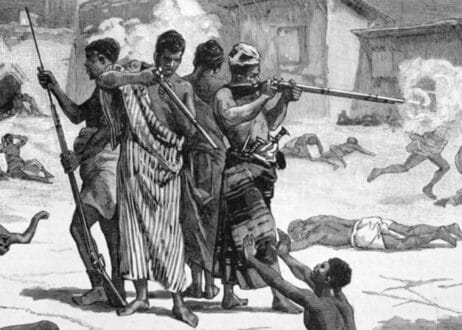

3 réponses à “Bruxelles impose une nouvelle entorse à la souveraineté : la Pologne sommée de reconnaître les « mariages » homosexuels contractés à l’étranger”
Et dire que la population française trouve encore le moyen de glorifier cette engeance qui nous ruine financièrement en piétinant nos libertés !
FREXIT
Je crois que c’est d’Ormesson qui a dit que cela ne forme pas un couple mais une paire.
Malheureusement en russe cela donne un seul mot et je pense qu’en polonais aussi.
En l’eau cul rance mon cher Michel en regard de la photo qui illustre le propos je dirais deux paires !