par Balbino Katz
Il est une coutume des plus enracinées, dans ce qu’on appelle encore la presse d’information générale, que de traiter les grandes affaires spirituelles avec la légèreté compassée des salons mondains. À l’approche d’un conclave, cet événement d’une portée universelle pour les catholiques et d’un retentissement discret mais réel dans les chancelleries du monde, les journaux hexagonaux, à commencer par Le Figaro, s’autorisent un genre d’exercice tout à la fois révérencieux et creux : la liste des papabili.
On y lit, sous la plume pourtant savante de Jean-Marie Guénois, un florilège de profils cardinalices, classés par habileté diplomatique, aptitude à l’écoute, enracinement local, capacités gestionnaires et sensibilité aux enjeux climatiques. L’éminent chroniqueur prend soin de ne heurter aucune susceptibilité, ni de Rome ni d’ailleurs, en se gardant bien d’approcher les sujets qui fâchent. Le souci de théologie, ce vieux mot qu’on croit encore réservé aux cloîtres, ne traverse jamais l’esprit du gazetier. Rien, pas même une allusion, sur la question brûlante de la liturgie traditionnelle, pourtant objet de passions ardentes au sein du troupeau des fidèles.
On évalue les candidats comme on parlerait d’un prétendant à l’Académie : selon ses réseaux, ses fidélités, ses engagements humanitaires ou son sens du compromis. Les saints mystères ? Fort bien, mais cela ne regarde, semble-t-il, que les chantres de sacristie. On cherche un homme d’équilibre, de gouvernance, un médiateur interreligieux ou, selon l’expression désormais consacrée, unhomme de dialogue. Mais de quel dialogue s’agit-il, lorsque le cœur de la foi, c’est-à-dire la transmission des vérités révélées et la célébration des sacrements, est passé sous silence ?
Depuis la publication du motu proprio Traditionis Custodes en 2021, qui limita sévèrement l’usage du missel tridentin, une ligne de fracture, profonde et douloureuse, traverse le monde catholique. On ne saurait s’en étonner : on a touché là à la liturgie, c’est-à-dire non à un caprice de forme, mais à l’expression visible et tangible de la foi. Pour nombre de fidèles, souvent jeunes et ardents, la messe ancienne, chantée en latin, tournée vers Dieu, incarne une continuité, une gravité, une beauté que les expériences liturgiques improvisées ne sauraient leur restituer. Et pourtant, dans l’article duFigaro, ce thème — qui divise bien davantage que les considérations climatiques — est purement et simplement éludé.
L’on croirait entendre un chroniqueur mondain du Gaulois, relatant dans un dîner mondain les chances de l’un ou l’autre cardinal à la manière dont on jaugerait un préfet : est-il affable, parle-t-il plusieurs langues, plaît-il aux Allemands, rassure-t-il les Brésiliens ? Tout se passe comme si la foi catholique, dans ce qu’elle a de plus organique, de plus mystérieux, n’était plus qu’un arrière-fond décoratif. Le rite ? Une préférence esthétique. La doctrine ? Une habitude de langage. Les sacrements ? Un folklore utile pour les missions.
Pourtant, la question liturgique est, de Rome à Cracovie, de Lyon à Lagos, au centre des débats entre catholiques engagés. Non pas ceux que l’on interroge à la sortie de la messe de minuit, mais ceux qui vivent la vie de l’Église de l’intérieur, par la prière, la formation, la lecture des Pères, le compagnonnage discret avec la Tradition. Ces catholiques — que le journaliste parisien ne fréquente guère — savent que la manière dont on prie façonne ce que l’on croit. Et que de la forme du culte dépend, in fine, la vie de l’âme.
Qu’on me pardonne cette digression peut-être intempestive, mais il me semble que l’on juge trop souvent la vitalité d’une religion à ses engagements mondains. L’on admire un cardinal qui parle d’écologie, on s’enthousiasme pour celui qui accueille les migrants, on se félicite d’une déclaration sur la paix en Ukraine ou d’un déplacement au Soudan. On oublie que la mission première de Pierre est de confirmer ses frères dans la foi. Cela suppose qu’il en ait une, claire, charpentée, articulée. Et qu’il sache la défendre non point contre vents et marées — on ne lui demande pas de rudoyer les infidèles — mais dans le silence du sanctuaire, là où l’Église devient ce qu’elle est : une arche de salut, non une ONG compatissante.
Il faut peut-être n’être pas tout à fait français pour percevoir l’incongruité d’un conclave traité comme un sommet du G20. Né ailleurs, ayant grandi sous d’autres cieux, et vivant à présent sur la terre âpre et belle de Bretagne, j’observe avec un recul que nos voisins, les fils de Marianne, ne s’accordent pas toujours. On ne parle plus de Dieu. On parle de l’Église, mais non dans l’Église. On parle du pape, mais non du pontife romain comme successeur de l’Apôtre. Et l’on oublie que ce que le peuple fidèle attend d’un nouveau pape, ce n’est pas d’abord un leader géopolitique, mais un serviteur des mystères divins, gardien de la Tradition, et défenseur de la dignité du culte.
La théologie, dira-t-on, c’est pour les spécialistes. Mais en omettant d’en parler, on trahit ce que l’on prétend éclairer. Car un conclave sans théologie, c’est un conclave vidé de son âme. Et ce silence-là, hélas, ne fait pas de bruit.
Balbino Katz
— chroniqueur des vents et des marées —
Note pour anticiper les courrier des lecteurs irrités
On va probablement critiquer mon emploi de l’expression « fils de Marianne » pour désigner les Français. Elle me paraît pourtant juste, et même rigoureuse, si l’on veut bien considérer l’histoire réelle, non celle des manuels. Car depuis la chute du Second Empire en 1871, la République s’est imposée non seulement comme régime politique, mais comme matrice spirituelle d’un certain type d’homme français. Le Vatican, d’abord réservé, dut reconnaître de fait ce nouvel état de choses dès les premières années du pontificat de Léon XIII, sans jamais bénir la République, mais en l’acceptant comme forme stable de gouvernement. La condamnation, en 1926, par Pie XI, de l’Action française — dernier bastion intellectuel d’un royalisme catholique assumé — marqua le point de non-retour : désormais, être catholique en France, c’était,nolens volens, se faire à l’idée que la République ne passerait pas. Les Français, même les plus pieux, furent dès lors appelés à vivre non plus en enfants de Saint Louis, mais en fils de Marianne, héritiers d’une République rationaliste qu’ils ne purent plus, sans désobéissance, contester frontalement. Ce glissement n’est pas anodin : il explique en partie pourquoi la théologie s’efface aujourd’hui derrière le consensus, et pourquoi les questions d’autel s’examinent à travers les prismes de la politique ou du vivre-ensemble
Crédit photos : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine







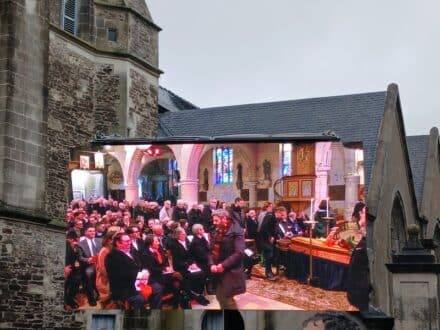






6 réponses à “Papabili. L’art délicat d’ignorer l’essentiel”
Oui, les Dakotés ont pour mère fille de la gueuse.
Tandis que être Bretons, nous qui sommes écartés de l’Histoire depuis 500 ans, c’est assumer notre vocation de rendre gloire à Dieu sur cette presqu’île avec toute la richesse de notre héritage que la République issue des coupeurs de têtes nous a confisquée, et premièrement notre langue, et tout l’esprit breton.
Brillant. Bravo.
S’il vous plaît, ne confondons pas la France et la république !
La France est une nation avec sa culture, ses traditions et ses valeurs qui sont celles du christianisme.
La république, elle, est un système de gouvernement dont la principale qualité est d’être le moins mauvais de tous et la seule « valeur » est la démocratie… lorsqu’elle est appliquée !
Balbino Katz vous avez effectivement un problème avec votre nationalité… d’un article à l’autre il se fait un peu plus jour.
« Fils de Marianne », oui, vous, Balbino Katz, peut-être… mais certainement pas moi cher Balbino, en effet !
La Gueuse a toujours été honnie, et j’observe que le relais s’est bien transmis, de génération en génération, en particulier depuis que mon aïeul a été guillotiné.
Après, vos habiles orchestrations d’idées, votre côté joueur qui cherche à trouver des lecteurs irrités, je m’en fiche royalement. Il ne m’intéresse pas, j’ai d’autres chats à fouetter.
Bambino a des idées sur tout, c’est formidable – ou terrifique !
Le cardinal Sarah a dit que le nouveau Pape ne sera pas le successeur de François, mais le successeur de Pierre…