L’Américain Robert Francis Prevost, 69 ans, est devenu ce jeudi 8 mai le premier pape originaire des États-Unis de l’histoire. La cheminée vaticane, cette bouche sacrée qui souffle le mystère dans le théâtre du monde, a exhalé sa fumée blanche. Signe que les princes de l’Église se sont rapidement accordés. On sait que le trône de Pierre attire les convoitises médiatiques comme un chandelier renversé attire les papillons de nuit. À chaque conclave, une dramaturgie s’installe, dans un mélange de ferveur et de spectacle, de piété et de tapage. Il convient pourtant de s’interroger avec un peu de recul — celui que donne l’histoire, celui que commande la raison — sur l’évolution du rôle du Souverain Pontife dans l’économie de l’Église et de la foi.
Le décès d’un pape autrefois plongeait la chrétienté dans un silence recueilli, mêlé parfois de résignation paysanne. Il ne bouleversait guère la chronique, sauf peut-être à Rome même. Le Saint-Père n’était pas un personnage de premier plan dans la conscience populaire. Il était au loin, vicaire du Christ dans son lointain Latran, lointain comme le Jugement dernier, comme le paradis ou l’enfer, qui faisaient partie du mobilier mental sans pour autant s’inviter au quotidien. Le très touchant conte d’Alphonse Daudet,Le Pape est mort, dans ses Contes du lundi, donne à voir cette distance : un enfant invente la mort du pape, sans mentionner son nom car il l’ignore probablement, pour échapper à une punition, et sa mère, saisie d’effroi, cesse aussitôt de le corriger. Cela nous renseigne sur la solennité de la figure pontificale autant que sur son abstraction auprès de la majorité des fidèles.
Or, nous avons basculé. De nos jours, l’évêque de Rome est devenu une figure planétaire, un chef d’État sans armée, une conscience morale de substitution pour un monde en perte de repères. Chaque geste, chaque intonation, chaque silence du pape est disséqué, commenté, amplifié par les médias. Il a des comptes Twitter, ses homélies sont relayées en temps réel, sa manière de saluer ou de se taire devient elle-même un signe, un message, un quasi-dogme.
Cette transformation du rôle pontifical s’est faite dans une étrange continuité : plus le pouvoir temporel du Saint-Siège s’effaçait — avec la perte des États pontificaux en 1870 — plus son autorité symbolique et médiatique s’épanouissait dans une démesure nouvelle. Le concile Vatican I, dans la foulée de cette mutation, définissait l’infaillibilité pontificale ex cathedra, c’est-à-dire dans des conditions bien précises : lorsque le pape proclame une doctrine de foi ou de mœurs, en vertu de son autorité apostolique, et en union avec la tradition. Or, le fidèle contemporain, abreuvé par un flot continu de paroles papales, ne fait plus cette distinction. La voix du pape, fut-elle une digression sur la météo ou sur la finance verte, devient aussitôt matière à foi, ou à controverse.
C’est ce que dénonce, avec une ironie cinglante, le père Jaime Mercant Simó : « Si le pape avait un charisme permanent d’infaillibilité, il ne se tromperait même pas sur les prévisions météorologiques. » Le bon sens parle ici dans la langue de la scolastique. Nous ne sommes pas face à une critique irrévérencieuse, mais à un rappel salutaire des principes. Le pape n’est pas l’Église, il ne la précède pas, il ne la remplace pas : il la sert. Il est l’héritier d’une fonction, non son inventeur. Et il est tenu, lui aussi, à l’obéissance envers la révélation divine, la tradition, le droit naturel. Ce sont là des propos que ne désavouerait point un Carl Schmitt, qui, dans Römischer Katholizismus und politische Form, analysait le caractère institutionnel, donc limité, de la figure pontificale comme facteur de stabilité dans la modernité liquide.
Le père Javier Olivera Ravasi, dans la même veine, moque cette tendance à voir dans chaque pape une sorte de quatrième personne de la Sainte Trinité. L’hyper-personnalisation du pontificat, que certains n’hésitent pas à nommer papolâtrie, découle selon lui d’un infantilisme théologique aussi bien que d’une maladie médiatique. « On pouvait vivre tout le Moyen Âge sans savoir qui était le pape », rappelle-t-il. Et cela n’empêchait ni de prier, ni d’être sauvé. L’Église n’est pas née avec les caméras.
Cette idolâtrie nouvelle s’enracine dans le XIXe siècle, époque de grandes pertes et de grandes reconstructions. Alors que le monde catholique perd ses repères traditionnels, il se raccroche à une figure visible, rassurante, investie de toutes les vertus, comme l’enfant s’attache au regard du père. La centralisation du pouvoir doctrinal autour du pontife, tout en étant historiquement compréhensible face aux périls du modernisme, a produit un effet collatéral redoutable : celui de transformer le pape en objet de vénération quasi mystique, éclipsant la vie sacramentelle et les médiations ordinaires de la grâce.
C’est dans ce contexte que le dernier pontificat, celui du pape François, a suscité des remous. Loin de se cantonner au rôle d’arbitre entre les tendances de l’Église — conservateurs, réformateurs, traditionalistes, progressistes — il a paru, pour certains, s’ériger en militant. Son insistance sur la synodalité, ses ouvertures symboliques aux homosexuels ou aux divorcés remariés, ses critiques répétées du cléricalisme ou du capitalisme, ont pu être perçues non comme des exhortations évangéliques, mais comme des manifestes sociétaux.
D’où l’émergence d’une parole critique, parfois rude mais souvent argumentée, venue des marges de la catholicité — de France, d’Argentine, d’Espagne ou d’ailleurs — mais ancrée dans un souci de fidélité. Fidélité à la tradition, fidélité à la vérité, fidélité au rôle réel, non rêvé, du Souverain Pontife. Comme le résume le père Mercant Simó, « le pape doit servir l’Église », non l’inverse. C’est là un rappel d’un ordre fondamental, que le philosophe allemand Martin Heidegger aurait peut-être désigné comme le Seinlassen— laisser être ce qui doit être, et ne point surinvestir ce qui n’est que fonction.
Rappelons, cette évidence élémentaire qu’on tend à oublier à l’heure des conclaves scénarisés : la foi catholique repose sur le Christ, non sur celui qui siège temporairement en son nom. Celui que la rumeur appelle pape n’est, dans la liturgie romaine, qu’un ervus servorum Dei— serviteur des serviteurs de Dieu. Puissent les cardinaux qui entrent en conclave s’en souvenir. Puissent-ils élire non pas un chef de file pour les caméras, mais un gardien du dépôt.
Un ministère renversé : aux origines de la « papolâtrie »
À mesure que s’étiole le souvenir d’une Église enracinée dans le mystère, à mesure que s’accroît le vacarme de la modernité et son exigence d’immédiateté, le regard catholique s’est comme replié sur une figure visible, unique, centrale : celle du pape. Or cette centralité ne fut pas toujours telle. Elle est le fruit d’une histoire, d’une lente montée en puissance, qui a vu le Souverain Pontife passer du rôle d’ultime recours théologique à celui, parfois insidieusement intrusif, de figure tutélaire du siècle. C’est cette dérive que dénoncent aujourd’hui, dans une voix grave, les pères Jaime Mercant Simó et Javier Olivera Ravasi. Encore faut-il comprendre d’où ils parlent.
Ces deux prêtres catholiques, tous deux hispanophones, incarnent une mouvance intellectuelle qu’il serait trop simple de qualifier de « conservatrice ». Il s’agit d’une sensibilité qui, tout en s’inscrivant dans la fidélité au magistère romain, refuse l’effacement progressif de la distinction entre pouvoir doctrinal et autorité médiatique. Leur critique de la papolâtrie– terme volontairement provocateur – ne s’insurge point contre la papauté en soi, mais contre l’hypertrophie de la personne pontificale, fruit d’une histoire aussi bien théologique que politique.
Ce basculement remonte à la fin de l’Ancien Régime, lorsque la Révolution française, en s’attaquant aux institutions de l’Église, détruisit aussi son écosystème politique et symbolique. L’Église perdit non seulement ses privilèges mais son enracinement dans la vie organique des peuples. Le pape, jusque-là chef spirituel et souverain temporel, vit son pouvoir réduit, ses États annexés, sa voix défiée. La centralisation romaine fut une réaction stratégique à cette perte. Rome, assiégée par le monde moderne, se referma sur elle-même comme un fortin encerclé. Le Syllabusde Pie IX (1864) fut une réponse de combat à la modernité libérale, à son hédonisme, à son subjectivisme. Et Vatican I (1870) proclama le dogme de l’infaillibilité pontificale, non par orgueil, mais pour préserver une autorité menacée.
Ce n’était pas là le commencement de la papolâtrie, mais sa condition de possibilité. Comme toujours, ce que l’on proclame pour défendre finit parfois par devenir ce que l’on idolâtre. Le père Mercant Simó, en bon lecteur de la tradition, ne conteste pas le dogme ; il en rappelle seulement les bornes. Et il dénonce le glissement contemporain : une assimilation tacite entre toutes les paroles d’un pape — tweet, sermon ou improvisation d’avion — et une autorité doctrinale intouchable. « C’est un cancer dans l’Église », dit-il, non par animosité, mais par clarté théologique. Le pape, ajoute-t-il, n’est pas l’Église, il est tenu d’y obéir.
Le père Olivera Ravasi va plus loin encore, et son accent argentin ne masque pas la lucidité de son propos :« Certains pensent que les papes sont pratiquement la quatrième personne de la Trinité. »Cette formule, provocatrice sans être outrancière, pointe l’écueil d’une centralisation excessive : croire que l’Église est le pape, que toute nouveauté de parole ou d’attitude est une innovation doctrinale, et que la foi doit s’y conformer sans délai. Or l’Église n’a pas été fondée par le pape : elle l’a précédé. Elle est l’Épouse du Christ, non du pape de turno.
Le XIXe siècle, en cherchant un refuge dans une figure visible, a donc créé une nouvelle forme de dévotion. Non plus celle, ancienne, envers les sacrements, les saints et les mystères, mais une vénération de la figure pontificale elle-même. On allait à Rome non plus pour toucher les tombeaux des apôtres, mais pourvoir le pape. Cette inversion des fins est le noyau de la critique de Mercant Simó : l’autorité ne se légitime pas par la visibilité, elle se mesure à sa fidélité. Et la fidélité du pape se mesure à son respect de la tradition, non à sa capacité à séduire le monde.
Or la modernité médiatique a exacerbé cette dérive. L’image a remplacé le dogme. Le geste, la posture, la phrase prise hors contexte deviennent l’événement. Et le pape devient, bon gré mal gré, une figure publique soumise aux logiques de l’instant. Il est vendu par les médias comme un produit culturel, et l’on attend de lui des prises de position sociétales, des gestes symboliques, des ruptures ou des mots qui plaisent. Cette pression, que n’avaient pas connus les pontifes d’avant Pie XII, a modifié en profondeur l’exercice du pontificat. Le pape, naguère silencieux ou lointain, est devenu présent, commenté, disputé.
Les critiques des deux prêtres ne visent pas l’homme — fût-il Jorge Mario Bergoglio — mais la fonction, ou plutôt sa déformation. En parlant de papolâtrie, ils s’en prennent à une tendance collective, à une sorte d’illusion ecclésiale qui confond le charisme avec l’onction, le marketing avec le magistère. Ils appellent à un retour à l’équilibre : celui d’une papauté modeste, fidèle, enracinée, consciente de ses limites, refusant le vedettariat et la séduction du monde.
Dans les colonnes d’Éléments, Guillaume Faye rappelait, en des termes très différents, que toute civilisation se défait par excès de centralisation : lorsqu’un seul organe absorbe tous les autres, il les stérilise. Il en va de même pour l’Église. Le pape, figure de l’unité, ne saurait absorber la catholicité tout entière. Il lui faut des contrepoids : les évêques, les conciles, la tradition, la liturgie, le sensus fidelium. Faute de quoi, la verticalité devient autocratie, puis spectacle.
La critique de la papolâtrie n’est donc pas un caprice de théologiens ulcérés. Elle est le cri d’alarme de ceux qui croient encore que l’Église n’est pas un talk-show ni une marque mondiale, mais une barque fragile, confiée par Dieu à des pêcheurs souvent hésitants. Un appel à remettre le pape à sa place : ni moins qu’un successeur de Pierre, ni plus qu’un serviteur du serviteur. Il n’est pas le Soleil, il est une lanterne. Et c’est à cette lumière, vacillante mais vraie, que les fidèles peuvent espérer marcher encore.
Balbino Katz
— chroniqueur des vents et des marées —
Crédit photo : Wikimedia (cc)
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine







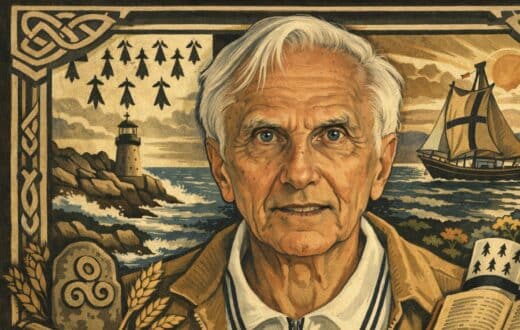


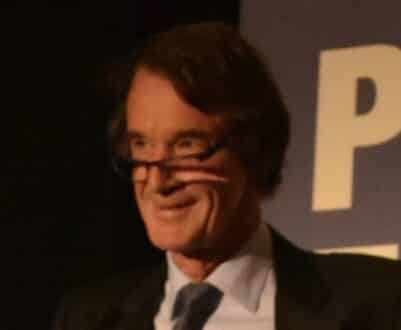

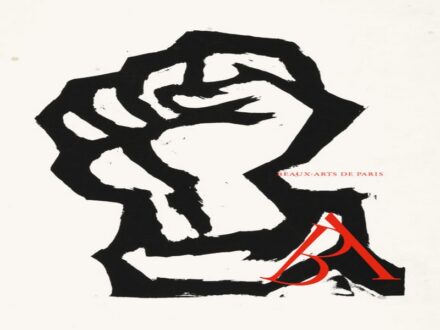

4 réponses à “Après l’élection du pape Léon XIV. Et si on causait de la papolâtrie ?”
Cet article long (et lourd) peut se résumer simplement:
– il existe une foule de papes, simples vedettes de spectacle… l’auteur aurait pu citer la phrase de « Voltaire » sur ces papes de show-business : » L’idole qu’on adore au Vatican »
– et puis de loin en loin – de façon tellement espacée qu’on n’en rencontre même pas un tous les siècles -, il existe un très grand pape : Innocent III (et l’irruption des Frères-prêcheurs et des Tiers-Ordres) ; Pie V qui normalisa les rites pour un demi-millénaire (jusqu’à ce que les guignols de Vatican-II confondent les expressions : dépoussiérer et tout casser)…
À l’époque moderne, il y eut un très grand pape : Léon XIII dont la plus connue des encycliques, Rerum Novarum du 15 mai 1891, restera comme étant le plus grand texte social depuis le Sermon sur la Montagne – Léon XIII y définissait les rapports idéaux entre employeurs et employés & proposait la participation de tous les travailleurs aux bénéfices de leur entreprise
La haine des marxistes et des socialistes de salon en fit une grande rencontre ratée de l’histoire humaine.
On peut espérer que le nouveau pape osera poursuivre l’oeuvre du grandiose Léon XIII… qui effraya tant ses successeurs (fort portés sur la constitution d’un Trésor pour des raisons d’établissement et d’entretien d’un potentiel immobilier gigantesque), à l’exception de Pie XII, autre géant qui parvint à sauver des centaines de milliers de « recherchés » durant les années 1941-47… singulièrement tant de Juifs (dont les congénères crachent en permanence sur sa mémoire) et tenta de faire comprendre que la charité exige de protéger tous les proscrits (les communistes en 1941-44 aussi bien que les ex-nazis et associés en 1945-47)
L’histoire doit s’écrire avec honnêteté… Léon XIII et Pie XII ont réconcilié une foule d’athées avec le catholicisme
Léon XIV en fera peut-être de même
Je connais rien à ces papes ; à part Pie X;
Wait and see! pour paraphraser Wellington ancien cadet de l’Académie Royale Militaire d’Angers alors que Lord Cornwallis avait fréquenté Autun, du temps de l’excellence française, c’est bien loin! Dans la ligne de Léon XIII c’est prometteur! Voyons la suite à défaut d’être un nouveau Jules II en armure.
Pie X c’est une église de Vannes où on collecte des vêtements pour les Ukrainiens, collecte organisée par les Frères de Ploërmel. Jadis en terres diverses de France la mort d’un Pape était connue au moins 30 jours pus tard! Lorsque le terrible Frédéric II s’en est allé le courrier de l’ambassade de France a mis 5 jours à francs étriers pour faire parvenir à Versailles la bonne nouvelle…la Bête terrible s’en était allée!