À l’heure où l’Europe doute d’elle-même et où ses élites semblent parfois honteuses de son histoire, il est utile de rappeler ce qui a fait sa force : une capacité unique au monde à s’auto-critiquer et à s’ouvrir aux autres civilisations, non pas pour s’y soumettre, mais pour apprendre et transformer ce savoir en innovations durables. Un excellent article signé Steven Farron, dans American Renaissance, datant de 2009, revenait sur cette domination du monde et ses raisons essentielles. Nous vous en proposons une synthèse en français ci-dessous.
L’expérience de Matteo Ricci : la rencontre de deux mondes
À la fin du XVIᵉ siècle, le missionnaire jésuite italien Matteo Ricci fut l’un des premiers Européens à vivre durablement en Chine. Ses récits, rédigés entre 1583 et 1610, décrivent un empire replié sur lui-même, convaincu de détenir seul le monopole du savoir. Les Chinois, écrit Ricci, considéraient les étrangers comme des « bêtes », incapables d’apporter une quelconque connaissance.
Pourtant, lorsqu’il présenta ses cartes du monde, ses globes et ses instruments scientifiques, il fut reçu avec les plus grands honneurs jusqu’à la Cité interdite. L’empereur fit même reproduire ses cartes en soie pour les distribuer à sa famille. Car la Chine, alors grande puissance démographique et culturelle, ignorait encore que la terre était ronde, que le soleil était plus grand que notre planète, ou encore que la logique mathématique pouvait démontrer les vérités les plus simples.
Ricci, formé par l’un des plus brillants mathématiciens européens, introduisit en Chine la géométrie d’Euclide, la logique aristotélicienne, et des innovations techniques comme l’horloge mécanique ou le quadrant. Le contraste était saisissant : la Chine avait inventé le papier, la poudre et la boussole, mais elle n’avait jamais su transformer ces inventions en outils de puissance mondiale. L’Europe, elle, s’en était emparée pour remodeler la planète.
L’Europe, seule civilisation tournée vers l’extérieur
Cette curiosité insatiable n’était pas nouvelle. Depuis l’Antiquité, les Grecs et les Romains avaient cultivé une fascination pour les peuples étrangers. Hérodote, souvent considéré comme le « père de l’histoire », écrivait déjà sur les coutumes des Égyptiens, des Perses ou des Scythes, avec un regard à la fois critique et empathique. Tacite, à Rome, décrivait les vertus supposées des Germains pour mieux souligner les vices des Romains.
Ce goût pour l’ethnographie et pour la remise en question de soi est une singularité occidentale. Les civilisations non-européennes, qu’elles soient arabe, turque ou chinoise, se contentaient de mépriser les « barbares » et refusaient d’apprendre leurs langues ou leurs savoirs. Les Ottomans, qui régnaient sur une partie de l’Europe, utilisèrent des convertis pour traduire les textes occidentaux, mais n’ouvrirent jamais de chaires de latin ou de grec.
À l’inverse, l’Europe créa très tôt des chaires d’arabe à Oxford, Cambridge ou au Collège de France, traduisit le Coran et des textes persans, et chercha à comprendre ses rivaux. Cette volonté d’apprendre, même de ses ennemis, explique pourquoi les Européens finirent par les dépasser.
Innovation, imprimerie et révolution scientifique
Les exemples abondent. La Chine avait inventé le papier, mais l’Europe inventa l’imprimerie moderne. En moins d’un siècle, près de 200 millions de livres circulaient sur le continent, favorisant une diffusion des savoirs sans équivalent. Le monde musulman, pourtant si proche, ne s’équipa d’imprimeries que tardivement, et encore sous l’impulsion d’étrangers.
De la même manière, les Européens perfectionnèrent la boussole pour explorer les océans, transformèrent la poudre en artillerie moderne, et appliquèrent la logique mathématique pour révolutionner l’astronomie, de Copernic à Newton. Cette soif de comprendre l’ordre du monde – ce que Stephen Hawking qualifiait de « désir universel » – fut en réalité un trait distinctif de la culture européenne.
Mais cette force a un revers. L’autocritique permanente, utile tant qu’elle restait une incitation à progresser, est devenue au XXIᵉ siècle une pathologie de la haine de soi. Les Grecs avaient déjà dénoncé leurs propres excès dans les tragédies ; les Romains accusaient leur empire d’être corrompu et cruel. Les Européens modernes, eux, vont jusqu’à célébrer les « vertus » supposées des sociétés primitives – quitte à idéaliser les sacrifices humains des Aztèques ou à inventer de toutes pièces des discours écologiques attribués à des chefs amérindiens.
Aujourd’hui, cette inclination à se flageller est exploitée par des élites mondialisées qui enseignent aux jeunes Européens que leur histoire n’est que colonisation, esclavage et crimes. L’ouverture et la curiosité, jadis sources de progrès, se transforment en armes de déconstruction et de culpabilisation.
L’Occident a dominé le monde parce qu’il a su critiquer ses propres travers et s’inspirer des autres civilisations pour bâtir mieux. Mais ces qualités, portées à l’excès, deviennent suicidaires si elles conduisent à nier toute légitimité à nos peuples et à nos cultures.
L’Europe doit retrouver l’équilibre : apprendre, oui ; s’améliorer, toujours ; mais sans oublier ce qui la distingue et ce qui l’a rendue grande. À défaut, les inventions nées en Occident pourraient, demain, être utilisées par d’autres civilisations plus sûres d’elles-mêmes, tandis que nous resterons paralysés par la honte et l’oubli.
Crédit photo : Institut Iliade
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine












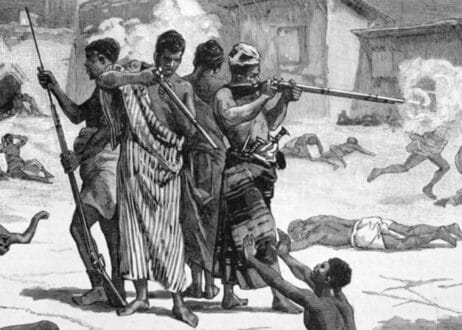

6 réponses à “Pourquoi l’Occident a dominé le monde : le génie européen entre curiosité et autocritique”
La pathologie de la haine de soi s’intensifie dans la jeunesse d’aujourd’hui. Pour exemple la traduction du message de Ben Laden adressé aux USA fait un carton sur les réseaux sociaux ou beaucoup de cervelles influençables se prennent à justifier les 3000 morts occidentaux des attentats du 11 septembre 2001.Difficile d’avoir foi en l’avenir quand une partie de la jeunesse renie ses racines et sa culture.
Ce n’est pas « l’Occident » qui a dominé le monde, c’est l’Europe !
C’est bien dommage en effet de voir dans cet article, au demeurant très intéressant, une utilisation apparemment indifférenciée des termes « Europe » et « Occident », ce qui est source d’une grande confusion. Je ne peux m’empêcher à cet égard de citer une phrase extraite d’une tribune publiée il y a quelques années par Raphaël Chauvancy: » L’Occident n’existe pas. Il n’est d’ailleurs qu’une création sémantique des Etats-Unis pour surévaluer la communauté d’intérêts transatlantique, justifier leur leadership en Europe, et assimiler toute dissonance au mieux à une compromission douteuse, au pire à une trahison. »
Prenons l’habitude de rendre à l’Europe ce qui est à l’Europe, et n’utilisons qu’avec une extrême parcimonie ce terme « d’Occident », dont l’usage ne fait que renforcer l’hégémonisme états-unien.
Confiteor de l’Occident: « C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très grande faute… » d’être travailleur, inventif voire intelligent, d’avoir créé le monde moderne dont profite toute l’humanité: la médecine qui a réduit drastiquement les morts naturelles en Afrique, la technologie qui réduit la peine de l’Homme dans son labeur lui permettant de disposer de plus de temps pour ses loisirs voire du « Droit à la paresse » comme dit Sandrine, d’avoir civilisé les rapports humains avec la Démocratie et les Droits de l’Homme;
Moi, Occident je me repends, certes de l’esclavage (largement aussi pratiqué par le monde musulman) mais aussi de mon sentiment de supériorité voire d’orgueil envers tous les Peuples auxquels j’ai infligé tous mes bienfaits.
Pour tout celà, je fais ma contrition et récite 10 pater et 20 Ave…Amen.
Texte un peu schématique mais intéressant, bien dans la ligne de Louis Rougier (le Génie de l’Occident) et d’Arnold Toynbee (l’Histoire). Juste un bémol (sans doute y en a-t-il d’autres) : « les premiers essais de typographie en Corée remontent sans doute au XIIe s. Mais l’apogée se situe au XVe s., précisément au moment de la naissance de l’imprimerie en Europe », bref Japon et Chine auraient à leur tour découvert l’imprimerie, avec ou sans l’Europe. Mais ce qui est frappant, c’est qu’en Europe l’imprimerie naissante est, en quelques maigres décennies, parvenue à sa maturité technique et esthétique !
Joli texte hélas l’Europe est dirigée par des mercenaires de la politique financière économique avec beaucoup trop de sang sur les bras. Elle a fait se remémorer toutes ces outrances, cette suffisance envers le sud global ou les BRICS désireux de changer cette suprématie l’on clairement défini. L’occident s’est purement et simplement suicidé sur son orgueil en ignorant la convergence simultanée des pays en voie d’évolution qui l’on dépassée.
Alors oui bien sûr, il a des revirements et le chef de l’occident les Etats Unis tentent de négocier leur effondrement pour essayer de sauver quelques meubles de la suprématie, avec leur monnaie dollars. Hélas pour le dollars submergé et subventionné par les dettes, elle mêmes subventionnées alimentées par les souscripteurs, ont compris le subterfuge. Créer de la monnaie dollars sur le dos du monde. C’est comme si une personne sur endettée demande un énième crédit en jurant qu’il va rembourser. Plus aucune banque ne le croit. Depuis 2008 l’occident à multiplié sa dette 4 fois plus sans rembourser et même en payant les intérêts avec de nouvelles dettes. Un système PONZI roi de l’inflation et du galvaudage de la monnaie papier qui ne vaut plus rien.
Faire une guerre pour cela, l’UE et ses gouvernants incapables de compter jusqu’à 10, personne n’en veut. Même la Russie cela ne l’intéresse absolument pas, elle a bien d’autres sujets plus intelligents avec la Chine l’Eurasie et les BRICS et surtout n’a pas de dettes, c’est incroyable et complètement ubuesque. On se demande ou sont passées les rentrées fiscales et les rendements de l’occident. Faire autant de dettes, c’est pire que de l’incompétence c’est de la pure folie. Il faut mettre nos dirigeants en prison pour usurpation, négligence, malversations, actes illicites, mensonges et incompétentes voulues.
Il va falloir vous y faire, la domination de l' »Occident » est terminée et l’hégémonie des USA va disparaître. Il ne sert à rien de larmoyer sur un passé révolu; nous allons devoir nous adapter à vivre dans un monde qui a profondément changé. Pour cela, il faut commencer par oublier les inepties concernant la supériorité absolue de l’Occident et de la « race blanche ».