À Ludwigshafen, ville industrielle de Rhénanie-Palatinat, les électeurs ont découvert un bulletin déjà expurgé : le candidat de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) avait été purement et simplement interdit de se présenter par le conseil municipal, à quelques semaines du scrutin. Résultat : une participation historiquement faible, à peine 29,3 %, du jamais-vu dans l’Allemagne moderne. Plus de 9 % des votants ont choisi de déposer un bulletin nul, parfois en y inscrivant le nom du candidat écarté. Le vainqueur de l’élection ne gouverne ainsi qu’avec l’aval effectif de 12 % de la population.
Cette expérience locale donne un avant-goût de ce que pourrait signifier une interdiction nationale de l’AfD. Mais loin d’inquiéter ses partisans, l’épisode a semblé galvaniser les défenseurs du bannissement, à commencer par le SPD, qui stagne aujourd’hui autour de 15 % d’intentions de vote, contre 24 % pour l’AfD selon les sondages.
L’argument de la « démocratie défensive »
Les promoteurs de l’interdiction invoquent la doctrine de la wehrhafte Demokratie – la démocratie qui se défend. Selon eux, un parti qui menacerait les institutions devrait être écarté avant qu’il ne puisse les renverser. Ils citent volontiers deux précédents historiques : la mise hors la loi du parti néonazi SRP en 1952 et celle du Parti communiste KPD en 1956.
Mais la comparaison peine à convaincre. Le SRP était dirigé par d’anciens cadres nazis. Sa brève percée électorale en Basse-Saxe n’a jamais représenté un projet démocratique crédible, mais bien la tentative désespérée d’une idéologie vaincue.
À l’inverse, l’AfD n’est pas née des ruines d’un régime totalitaire, mais du ressentiment d’une partie croissante de la population contre un consensus politique jugé étouffant. Union européenne, transition énergétique, immigration massive : sur ces sujets, de nombreux électeurs ont constaté que peu importait le parti au pouvoir, la ligne restait identique. L’AfD s’est construite sur cette frustration démocratique, et non sur la nostalgie d’un régime aboli.
Un contexte politique inversé
En 1952, Adenauer gouvernait en position de force, la CDU et le SPD représentant ensemble plus de 70 % des électeurs. L’interdiction du SRP, réclamée par les Alliés et utile à la réhabilitation internationale de la RFA, n’a pas ébranlé la confiance du peuple envers ses institutions.
En 2025, la situation est tout autre : les grands partis se maintiennent difficilement grâce à des coalitions fragiles et n’arrivent plus à rallier des majorités solides. Dans ce contexte d’affaiblissement, chercher à éliminer par décret le principal parti d’opposition ressemble moins à une défense de la démocratie qu’à une manœuvre de survie politique.
Ludwigshafen illustre ce danger : gouverner avec le soutien d’à peine un électeur sur dix ne relève plus de la démocratie représentative, mais d’une forme de gestion technocratique coupée du peuple.
En son temps, la CDU avait réussi à absorber une partie des électeurs du SRP en intégrant leurs préoccupations, dans un pays en pleine reconstruction et dopé par le miracle économique. Aujourd’hui, cette capacité d’intégration a disparu. Plutôt que de répondre aux inquiétudes liées à l’immigration, à l’insécurité ou à la souveraineté, les partis de gouvernement semblent vouloir criminaliser ceux qui les expriment.
Mais, contrairement aux nostalgiques du nazisme d’hier, les électeurs identitaires d’aujourd’hui ne disparaîtront pas avec un coup de crayon administratif. Refuser le débat démocratique ne fera qu’accentuer leur colère.
L’Allemagne se trouve donc face à un dilemme clair : soit redonner un véritable choix aux citoyens en réhabilitant la compétition démocratique, soit continuer sur la voie de l’interdiction et courir le risque d’un rejet massif des institutions..et d’une radicalisation. Une démocratie qui prétend se protéger en effaçant l’opposition finit toujours par se fragiliser elle-même.
Crédit photo : DR
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine












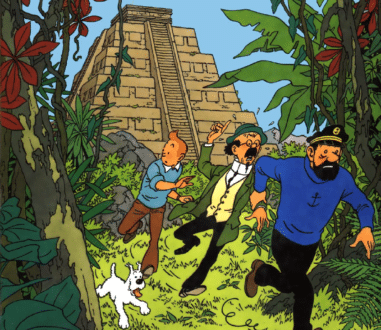

8 réponses à “Allemagne : l’ombre d’une interdiction de l’AfD fait planer le spectre d’une démocratie confisquée”
En France nous avons le barrage des 500 parrainages pour se présenter à l élection présidentielle.
C’est bizarre qu’aucun pays européen ne critique cette censure politique en Allemagne !
Ursula wo bist du ?
En fait , celà va bien au delà de la confiscation de la démocratie, c’est purement et simplement une suppression du droit de vote.et par des moyens divers , cette suppression se fait sous la « protection de l’UE :. en FRANCE , en ROUMANIE , en ALLEMAGNE….Les états ont perdu leur souveraineté, et leur indépendance !
Combien de « suicides » au sein de l’AfD ?
On retrouve l’Allemagne du III Reich dictature répression et faillite. Les dernière nouvelles de l’industrie Allemande c’est plus de 18’000 emplois supprimés comprenant tous les sociétés annexes. Une démocratie de dictature. Espérons que le peuple allemande saura se ressaisir sans entrevoir que sous le régime hitlérien le peuple fut méprisé et obligé de suivre les folies de Hitler, ce qui se passe en ce moment comme en France d’ailleurs. Ces 2 pays en faillite vont guerroyer contre la Russie en peine perdue. Car les alliés les BRICS dédollarisent au maximum en ne mettant plus en sous en occident. L’effondrement et les révoltes ne sont plus très loin.
roumanie, allemagne, l’ue-rss est en marche avant toute
@guillemot : LoL , parrainages sous contrainte venant des partis politiques qui ont ruiné la France et ne veulent surtout pas que l’on mettent le nez dans leurs combines financières.
@VORONINE: C’est surtout une interdiction de la liberté d’expression de plus en plus forte en Europe , toutes personnes , partis politique qui n’est pas dans la ligne politique de la commission et de d’Ursula est considérer a interdire .