En 2018, environ 191.000 personnes déclaraient parler gallo en Haute et Basse-Bretagne. Huit ans plus tard, en 2024, ils ne seraient plus que 132.000, selon la dernière enquête sociolinguistique. Soit 60.000 locuteurs en moins, une chute brutale qui interroge l’avenir de cette langue romane historique de l’Ouest breton.
Cette érosion rapide est d’abord liée au vieillissement des derniers locuteurs “de naissance” — ceux qui ont appris le gallo à la maison, souvent dans les campagnes d’Ille-et-Vilaine ou des Côtes-d’Armor. Mais derrière ce constat préoccupant, des acteurs locaux s’activent pour renouveler la transmission et donner au gallo une place nouvelle dans la société bretonne contemporaine.
Jerom Bouthier (Institut du Galo) : « Il faut former des enseignants et créer des outils pédagogiques »
Dans une récente émission de GaloWeb intitulée “4 minutes de temp”, réalisée à Montgermont près de Rennes, Jerom Bouthier, directeur de l’Institut du Galo, fait le point sur la situation et les projets à venir.
« Ces chiffres ne nous surprennent pas, explique-t-il. Beaucoup de locuteurs sont âgés, et disparaissent naturellement. Mais le travail mené depuis plusieurs années commence à poser les bases de la relance. »
L’Institut, fondé pour promouvoir, enseigner et documenter la langue gallèse, souhaite désormais franchir une étape : « Nous avons le projet de monter une filière bilingue à l’école, pour que le gallo y soit enseigné. Cela demande des professionnels, des formateurs et du temps », précise Bouthier.
Concrètement, l’Institut s’apprête à créer un service dédié à la formation des enseignants. Objectif : qu’ils puissent maîtriser la langue, la transmettre dans les écoles et produire de nouveaux outils pédagogiques adaptés aux élèves.
Une langue qui change, mais qui ne disparaît pas
Si le gallo est aujourd’hui moins visible dans la vie quotidienne, il conserve une vitalité chez les moins de 40 ans, notamment à travers les réseaux sociaux, la musique ou des initiatives culturelles locales.
Pour Jerom Bouthier, l’enjeu n’est pas seulement le nombre de locuteurs, mais l’usage social : « Ce qui compte, c’est que les gens continuent de parler gallo dans la vie de tous les jours, que ce soit à la maison, entre amis ou au travail. »
Selon lui, la langue évoluera forcément, mais elle survivra : « Le gallo de demain sera un peu différent de celui d’hier. Mais il y aura toujours du gallo. À nous de faire en sorte qu’il soit vivant. »
L’enquête révèle que près de 30 % des répondants pensent que le gallo pourrait disparaître d’ici dix ans. Un pessimisme qui contraste avec la dynamique portée par les associations, les communes et les départements engagés dans sa sauvegarde.
De nouveaux outils d’apprentissage, des formations et une meilleure visibilité médiatique pourraient permettre d’inverser la tendance dans les années à venir.
Pour l’Institut du Galo, l’avenir de la langue passera par une alliance entre formation, éducation et ancrage local. La transmission ne se décrète pas : elle se vit, au quotidien, dans les foyers, les communes, les écoles et les médias.
Son avenir dépendra de la capacité des Bretons du Pays Galo à le parler, le transmettre et le faire aimer aux générations futures.
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine












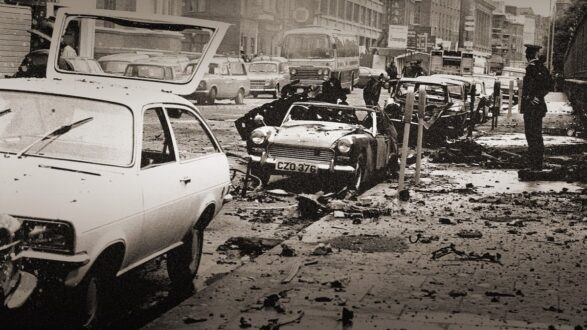


3 réponses à “Gallo : 60.000 locuteurs perdus en huit ans — quel avenir pour la langue gallèse ?”
Je suis tout à fait d’accord avec Jerom car j’estime qu’il est permis de rêver! Je retrouve à travers ses propos les conneries des crétins de la socialerie Diwan! Affirmations gratuites,phrases grandiloquentes…du Gallo sur les réseaux sociaux??? ah ben c’est nouveau!
Je comprends le gallo un peu comme je comprends les Québecois sans l’étudier particulièrement. Langue à part ou dialecte du français ?
Je vois pas de différence entre le normand , le mainiot et le gallo qui se parle en Mayenne d’ailleurs . C’est du vieux » françoué » à l’oreille .