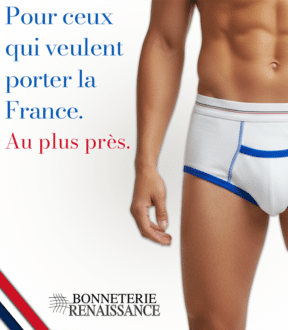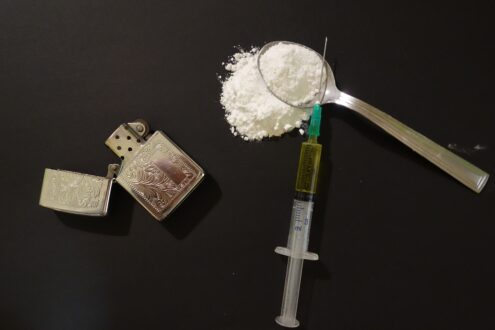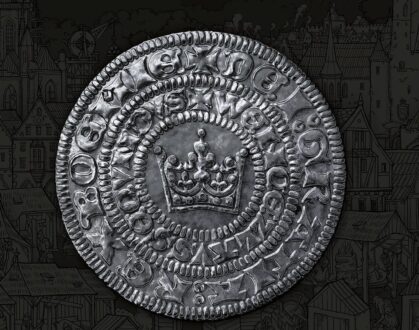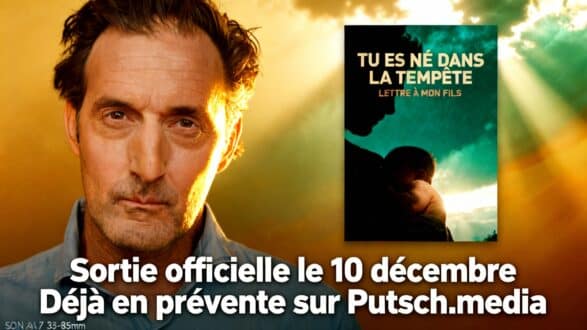Connu pour ses essais sur l’intelligence, la société américaine et le libertarianisme, le politologue américain Charles Murray, 82 ans, vient de surprendre son public : dans son nouveau livre Taking Religion Seriously, l’auteur de The Bell Curve et Coming Apart explique pourquoi, après une vie d’athéisme tranquille, il en est venu à croire en Dieu. Une évolution intellectuelle et spirituelle qui, selon lui, reflète un changement plus large chez une partie des intellectuels occidentaux.
De l’athéisme tranquille à la redécouverte du sacré
Invité du Michael Shermer Show, Murray, figure majeure du think tank libertarien American Enterprise Institute, raconte avoir longtemps vécu dans un monde intellectuel où « les gens intelligents ne croyaient plus à ces choses-là ».
Formé à Harvard et au MIT, il décrit la culture universitaire du XXe siècle comme « l’adolescence des intellectuels occidentaux » : une époque où la raison scientifique remplaçait la foi, où tout ce qui touchait au surnaturel était exclu du champ du pensable.
Aujourd’hui, il considère que cette ère touche à sa fin : « Nous avons jeté le bébé avec l’eau du bain de l’Enlightenment. Après un siècle d’arrogance rationaliste, beaucoup d’intellectuels redécouvrent que la religion joue un rôle irremplaçable : celui de relier les individus à quelque chose qui les dépasse. »
Une foi rationnelle, probabiliste
Murray insiste : il ne parle pas de conversion mystique, mais de croyances construites par raisonnement. « Je n’ai pas acquis la foi, j’ai acquis des croyances », explique-t-il. Sur la question de Dieu ou de l’au-delà, il dit simplement juger que « l’hypothèse d’un dessein est plus probable que celle du hasard ».
À la manière d’un statisticien, il affirme donner à l’idée d’une vie après la mort « plus de 50 % de probabilité ».
Ce virage n’est pas sans lien avec ses réflexions anciennes sur l’ordre moral et le rôle de la religion dans la cohésion sociale. Admirateur de C.S. Lewis, Murray voit dans la loi morale – ce sentiment inné du bien et du mal – la marque d’une transcendance.
« Je crois que Dieu s’est manifesté dans la conscience morale des hommes. Cette impulsion à faire le bien sans raison évolutive apparente est, à mes yeux, un signe du divin », confie-t-il.
Science, conscience et “moral law”
Dans son livre, Murray plaide pour une réconciliation entre science et spiritualité.
Il évoque l’anthropic principle – cette idée selon laquelle les constantes physiques de l’univers semblent réglées avec une précision impossible à expliquer par le hasard. « Soit nous vivons dans un univers intentionnel, soit nous avons gagné à la loterie cosmique », résume-t-il.
Cette intuition, combinée à son intérêt pour la moralité humaine, le pousse à considérer que la réalité matérielle ne suffit pas à tout expliquer.
Il s’intéresse aussi aux phénomènes aux frontières de la science : expériences de mort imminente et “terminal lucidity” (épisodes de lucidité chez des patients atteints de démence avant leur décès). Pour lui, ces événements plaident pour l’idée que la conscience n’est pas réductible à l’activité neuronale.
Un christianisme atypique et non dogmatique
S’il se définit désormais comme chrétien, Murray rejette les dogmes rigides.
Influencé par sa femme, proche du quakerisme, il adhère à une vision « contemplative et intérieure » de la foi : un christianisme sans rigidité doctrinale, centré sur l’amour et la recherche de sens.
« Je vois Jésus comme l’être humain ayant vécu le plus près de Dieu, autant que la condition humaine le permet », dit-il, citant une image d’enfance : « Jésus est autant de Dieu qu’on peut en faire entrer dans un être humain. »
Sur la question de la résurrection, il se dit « sur le fil du rasoir » : ni totalement convaincu, ni sceptique. Ce qu’il retient avant tout, c’est la dimension morale et spirituelle du message chrétien : l’idée d’une grâce capable de transcender la faute et la finitude.
Pour Charles Murray, sa redécouverte de la foi s’inscrit dans un contexte de désenchantement moderne : intelligence artificielle, isolement, effondrement des repères moraux.
« Nous vivons dans un monde pour lequel nous ne sommes pas préparés, où la technologie remplace la transcendance. »
À 82 ans, l’auteur dit ne plus craindre de se poser les questions que le rationalisme évacuait. Il conclut avec une sérénité désabusée : « Peut-être que le XXe siècle fut celui de la raison. Le XXIe sera celui où nous redécouvrirons qu’elle ne suffit pas. »
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine