La lumière de novembre entrait en biais dans ma petite cuisine bretonne. Sur la table de bois attendait une langue de bœuf que je venais de tirer du bouillon. Elle fumait encore, lourde et lustrée, prête à être épluchée, exercice de patience qui apaise les nerfs et rend les pensées plus claires. Les écouteurs enfoncés dans mes oreilles, j’écoutais un podcast américain dont la voix, compacte comme un grain de café broyé, commentait la querelle qui ravage aujourd’hui la droite américaine.
Entre la pointe d’un couteau et la membrane grisâtre de la langue, j’entendais les accents passionnés de l’animateur. Il décrivait la fracture qui divise l’Amérique conservatrice, fracture que les Européens engoncés dans leurs catégories d’hier peinent à saisir. D’un côté, les tenants de l’Amérique d’abord, héritiers d’une tradition ancienne, presque préchrétienne, qui plonge ses racines dans l’isolationnisme d’avant guerre, dans ce refus viscéral de voir la République devenir le gendarme du monde. De l’autre côté se trouvent ceux qui, depuis les années soixante, défendent un conservatisme plus doctrinal, né lorsque la droite républicaine cessa de se penser comme l’expression d’un peuple historique pour se reconstruire autour d’une idée volontariste de la nation. Pour eux, être américain ne relève plus d’une continuité ethnoculturelle issue de l’Europe du Nord, mais de l’adhésion à un pacte politique précis, la Constitution des Pères fondateurs. Selon cette vision héritée de l’ère reaganienne, n’importe qui peut devenir américain pourvu qu’il embrasse ce corpus juridique, ce catéchisme civique qui définit les droits et les devoirs du citoyen. Ce conservatisme civique a lié son destin à un soutien indéfectible à Israël, perçu comme un allié moral, stratégique et spirituel, pivot d’un Occident conçu comme un ensemble de principes plutôt que comme une filiation.

Le podcasteur appelait cela la première ligne rouge. Le soutien à Israël. Toute remise en cause de cette solidarité immédiate et sans conditions est aussitôt interprétée comme un acte de guerre théologique contre le vieil édifice conservateur. Carlson lui même a senti le sol trembler sous ses pieds lorsque Fuentes répondit à ses questions sans reprendre le langage consacré. Les vieux républicains ont crié à l’hérésie, les institutions se sont contractées comme un muscle blessé, et l’on a vu surgir chez certains dirigeants un tremblement étrange, mélange de peur, de honte et de certitude d’être dépossédés.
Le podcasteur en venait ensuite à ce qu’il appelait la seconde ligne rouge, plus profonde, plus ancienne, plus instable. La définition de l’américanité. Qu’est ce qu’un Américain? Est ce seulement l’adhésion à un texte, la Constitution, ou faut il reconnaître, comme le murmurent désormais bien des jeunes, que l’Amérique est une mosaïque de tribus historiques, Euro Américains, Afro Américains, Hispano Américains, Indigènes. Les uns y voient une évidence anthropologique, les autres un blasphème contre la religion civique. Cette ligne, disait il, n’a jamais cessé de vibrer. Aujourd’hui elle se fissure sous la pression d’une jeunesse qui ne croit plus aux abstractions du siècle passé.
L’animateur revenait longuement sur l’apparition récente de Fuentes et sur son étrange capacité à réveiller des zones sensibles du mouvement. Depuis qu’il est apparu aux côtés de Kanye West lors d’un dîner malheureux, où Trump aurait vu surgir ce jeune visage comme une ombre portée, tout le parti semble pris d’un vertige. Les vieux cadres parlent d’extrémisme. Les jeunes parlent d’avenir. Certains pensent que Trump s’est laissé entourer par des forces indomptables qui pourraient un jour le dépasser. D’autres affirment que ce sont ces forces là qui redonnent son souffle au mouvement, qu’elles l’arrachent aux pesanteurs de Washington.
En grattant soigneusement la langue encore brûlante, je songeais à mes propres années américaines. C’était en 1992, à Atlanta, lors de la première réunion d’American Renaissance. Jared Taylor n’avait pas encore la notoriété actuelle, mais déjà l’élégance froide d’un professeur d’ancienne Europe. Je suis ces milieux depuis ce jour là, et j’ai vu défiler les générations, les enthousiasmes, les mélancolies. Samuel Francis, dont je garde un souvenir vif, était alors l’une des voix les plus pénétrantes de la droite dissidente. Son analyse du système managérial américain m’avait bouleversé par sa lucidité. Je me rappelle sa voix, sa rondeur tranquille, son rire étouffé, ses colères glacées devant la trahison des conservateurs officiels. Mon seul regret est de n’avoir pu assister à ses funérailles. Je me trouvais en Europe, empêché de traverser l’Atlantique, et cette absence flotte encore sur mon cœur comme une dette mal réglée.
Le podcasteur notait d’ailleurs que Francis, longtemps relégué à la marge, revient aujourd’hui dans les conversations de cette jeunesse conservatrice qui ne croit plus ni aux institutions, ni aux sermons médiatiques, ni aux promesses du progrès. Les concepts jadis chuchotés dans des salles anonymes reviennent avec force sur les plateformes numériques. Les jeunes citent Francis sans parfois savoir qu’ils le font, comme les paysans citaient les vieux proverbes sans connaître les auteurs qui les avaient forgés.
La troisième ligne rouge pointe déjà sous la surface. C’est celle que les cercles d’American Renaissance explorent depuis quarante ans. La question raciale. Le statut des Noirs dans la société américaine. La place des Blancs. La critique de l’antiracisme devenu religion laïque. Ce sont là des sujets que les institutions considèrent comme interdits, mais que la jeunesse numérique attaque désormais frontalement. Le podcasteur le disait d’une voix presque affligée. Si cette ligne rouge cède un jour dans le débat public, plus rien ne ressemblera à ce que les conservateurs ont connu. Le vieil édifice de la droite s’écroulera comme une grange pourrie sous la pluie.
Il évoquait également Marjorie Taylor Greene qui reproche à Trump d’être trop tendre avec Israël et trop dur avec le peuple américain. Il notait le silence calculé de JD Vance, qui sent bien que la ligne civique recule mais n’ose pas la renverser. Il parlait de la mort de Charlie Kirk, d’un assassin que certains interprétèrent comme un fan de Fuentes. Il parlait aussi des jeunes de Washington, ces assistants républicains qui, selon lui, regardent les vidéos de Fuentes comme on regarde un brasero dans la nuit. Avec fascination, avec peur, avec l’impression que dans cette flamme quelque chose va se décider.
En face, l’aile civique du conservatisme s’accroche à sa théologie politique. Pour elle, l’Amérique n’est pas un peuple enraciné mais une idée vivante, universelle, offerte à tous ceux qui la désirent. Ses prêtres voient dans le moindre soupçon d’ethnicité un démon qu’il faut exorciser. Ils parlent au nom des ancêtres fondateurs comme on parle au nom des saints. Ils citent la Constitution comme une litanie. Et devant la montée de cette jeunesse identitaire, ils se sentent vieillir, comme un clergé qui perd ses ouailles.
Je retirai enfin la dernière pellicule de la langue et la déposai dans un plat profond. L’odeur chaude du bouillon envahissait la pièce, senteur charnelle qui rappelait les cuisines d’autrefois. Je débouchai un Rioja, vin rouge, solide et profond, dont la robe sombre accroche la lumière comme un vitrail inversé. J’en servis un verre. Le vin avait ce goût de fer et de soleil qui invite à la méditation.
Tout ce tumulte américain que je venais d’entendre semblait soudain lointain, comme les cris d’un port au petit matin. Pourtant, je savais qu’il annonçait les secousses de demain. Les fractures de l’Amérique sont les fractures de l’Occident. Le choc entre un conservatisme civique, abstrait, et un conservatisme enraciné, européen dans son âme, est une bataille qui nous concerne tous. La jeunesse américaine, avec ses incertitudes et ses désespoirs, ressemble à la jeunesse européenne. Elle doute des institutions, méprise les cléricatures médiatiques, cherche une vérité plus dense que les dogmes de l’égalitarisme. La tectonique civilisationnelle décrite par Spengler se lit dans les deux hémisphères. Les plaques bougent, elles grincent, elles se heurtent, et les peuples écoutent ces grondements avec un mélange d’effroi et de fascination.
Je repensai alors à une réflexion de Spengler que je cite de mémoire. Les civilisations ne se brisent jamais d’un coup. Elles se fendent de l’intérieur, lentement, inexorablement, jusqu’à ce que la fissure devienne gouffre. Nous en sommes là. Rien n’est encore tombé, mais tout s’ouvre déjà.
Je posai mon verre, écoutai encore un instant le podcasteur américain qui poursuivait sa litanie. Sa voix, lasse et obstinée, disait simplement ce que je pensais déjà. La question n’est pas de savoir qui aura raison. La question est de savoir ce qu’est encore une nation, ce qu’elle retient de son passé, ce qu’elle accepte de transmettre à ses fils.
Et dans le silence qui suivit, la langue de bœuf refroidissait lentement, gardienne immobile d’un vieux rituel, comme si la sagesse venait des choses simples et non des oracles qui prétendent guider les peuples.
Je restai là un moment, immobile, et il me sembla entendre, derrière le souffle arrêté de ma cuisine, ce que Jünger nommait les vibrations secrètes de l’Histoire. Non pas le vacarme des batailles visibles, mais la longue rumeur souterraine qui précède les grands renversements. Il pensait que les époques ne sont jamais renversées par les décisions des hommes, mais par des forces plus anciennes, plus impersonnelles, qui se frayent un chemin comme la sève d’un arbre noirci par la foudre. L’essentiel ne se déroule pas dans les parlements, ni dans les salles où l’on discute des choses publiques, mais dans les profondeurs telluriques de l’âme collective, là où les formes se défont avant de renaître sous un autre visage.
Je pensai alors que l’Amérique, avec ses colères, ses convulsions, ses lignes rouges qui cèdent l’une après l’autre, ressemble moins à une nation en crise qu’à une grande forêt en train de changer de saison. Les troncs se fendent, les écorces éclatent, et sous les feuilles mortes affleurent déjà d’autres pousses que personne n’avait prévues. On peut maudire ce changement ou s’en effrayer, mais il obéit à une loi plus ancienne que l’homme, une loi que Jünger avait pressentie, celle qui veut que toute civilisation, à l’heure où elle vacille, prépare en silence l’émergence de formes nouvelles.
Je coupai une fine tranche de langue pour la goûter. Elle avait ce goût profond et tranquille que l’on trouve dans les nourritures d’autrefois, et ce simple arôme fit jaillir en moi une réminiscence ancienne, presque effacée, comme un éclat de lumière au fond d’un puits. Je me revis à Atalaya, là où la pampa se mêle et se confond avec le Rio de la Plata, et ce jour lointain où j’accompagnais mon ami Alberto Buela rendre visite à son vieux mentor, l’homme qui lui avait tout appris sur les chevaux. Il vivait dans une cabane de tôle ondulée dont les murs vibraient au vent, et sous le haut vent qu’il avait construit pour se protéger du soleil et des averses trônait une antique cuisinière à bois. De cette cuisinière montait une odeur dense et chaude. Il me confia qu’il préparait des langues de bœuf pour une réunion de famille, six langues plongées dans une sauce tomate épaisse comme une terre fertile. Il me décrivit la préparation, la lenteur de la cuisson, l’art de l’épluchage, et il eut cette générosité que l’on rencontre parfois chez les hommes qui n’attendent plus rien de personne. Il ouvrit le four, sortit le plat, découpa une tranche et me l’offrit sur une assiette de faïence ébréchée. Ce fut là que naquit ma dévotion pour la langue de bœuf, dévotion que je poursuis encore aujourd’hui, refaisant dans ma cuisine bretonne, au gramme près, la recette transmise dans ce rancho au sol de terre battue. Je me dis que parfois, pour comprendre le monde, il suffit d’écouter la pluie sur les vitres et de sentir dans son vin, dans le grain du bois, dans la chair même des choses, ce que les siècles murmurent à voix basse. À cet instant, la vaisselle tiède, la vapeur qui s’évanouissait, le Rioja qui brillait dans son verre, tout semblait répondre à une même question silencieuse. Le monde change, mais l’homme demeure.
Balbino Katz
Chroniqueur des vents et des marées
Illustration : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine..



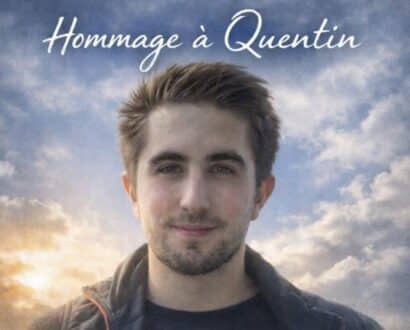
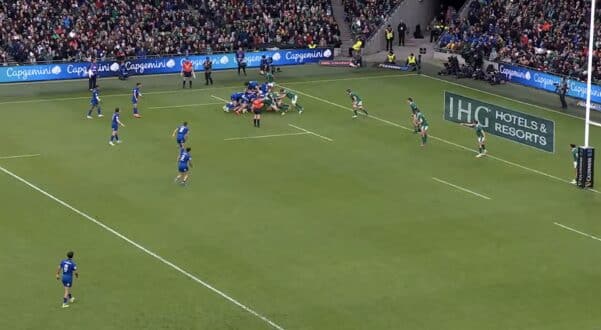

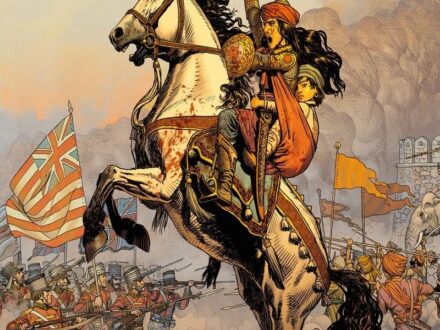



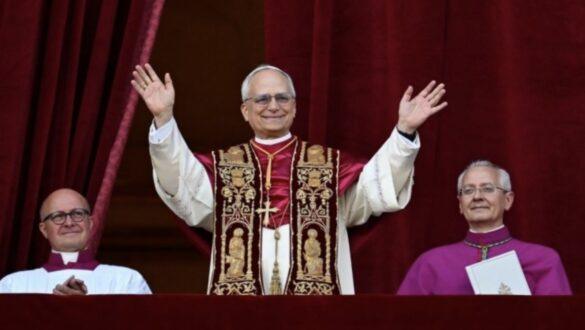


5 réponses à “Dans la vapeur d’une langue de bœuf, la droite américaine se déchire”
Sous l’auvent
Attendons le livre de recettes de Balbino pour juger !
Notre cher Balbino nous paraît être un fin cuisinier: encornets suivis d’une langue de boeuf au travers de laquelle il célèbre fort logiquement la nature organique de l’Homme, sa fragilité mais aussi sa résistance au travers des aléas de la civilisation.
oui.
Oui, auvent, au temps pour moi.