Il est des dates qui traversent les décennies comme ces longues houles d’ouest qui viennent mourir sur les récifs du pays bigouden, et qui vous rappellent qu’il existe un temps profond, antérieur aux passions du jour. Le 20 novembre est de celles-là. Anniversaire de la mort de Francisco Franco, il ramène chaque année vers la surface des souvenirs qui n’ont cessé de se recomposer, comme ces galets que la mer polit sans fin. Et voilà que, de nouveau, l’Espagne se divise autour d’un mort, révélant peut-être moins ce qu’elle fut que ce qu’elle est devenue.
Je me souviens pourtant, moi, de l’Espagne vivante. Celle que je découvris en 1969, garçon de treize ans débarquant de Buenos Aires, après une traversée sur un paquebot de la ligne Costa, l’Eugénio C peut-être, je revois encore ses cheminées massives. Pour un gamin du Río de la Plata, l’Espagne n’était pas un pays étranger : elle était une origine diffuse, un murmure dans la langue, un pli secret dans les gestes des miens. L’hispanité, telle que l’Argentin la ressent, n’est pas un héritage intellectuel, mais une respiration. Nous venions d’un monde façonné par l’Espagne, et retourner en Espagne, c’était presque avancer en arrière, comme dans ces songes où l’on retrouve une maison que l’on n’a jamais habitée et qui pourtant sent le linge de son enfance.
Barcelone m’apparut comme une ville étonnamment moderne. J’y découvris le flipper, cette machine cliquetante dont les lumières m’hypnotisaient et qui symbolisait pour moi la promesse d’un continent où la technique avançait sans arrogance. L’Espagne franquiste, telle que je la vis, n’avait rien de l’enfer caricatural dont nos journaux raffolent. C’était un pays propre, calme, discipliné, où les portiers de nuit ouvraient aux fêtards avec un sourire discret, où l’on n’entendait ni délinquance ni rumeur de violence. Cette paix avait quelque chose d’artificiel parfois, mais elle existait.
Alicante surtout fut pour moi une initiation. Dernière ville à avoir résisté aux troupes nationales, elle aurait pu nourrir un ressentiment ardent. Pourtant j’y trouvai une population pacifiée. Je revois encore cette manifestation d’octobre 1971 de soutien au régime, où je me mêlai avec l’imprudence d’un gamin. Les bras se levaient, les voix clamaient « Arriba España ! » non avec la brutalité de fanatiques, mais avec cette ferveur simple qui évoque l’« intrahistoria » chère à Unamuno, cette vie souterraine des peuples où se logent leurs vérités intimes. L’Espagne se montrait là comme un bloc spirituel, archaïque peut-être, mais vivant.
Franco, pourtant, n’était pas un homme de nuances. C’était un militaire convaincu qu’un pays se gouverne comme une caserne. Toute sa longue domination peut se résumer en deux mots : ordre et silence. Il méprisait la politique, qu’il jugeait dangereuse. Il n’aimait ni la confrontation d’idées ni la pluralité des doctrines. Il avait peur des phalangistes autant que des libéraux, et se débarrassa des uns comme des autres. Il rêvait d’un État minimal, presque ascétique, peu de police, peu d’impôts, pas de dette, peu d’institutions, une société disciplinée par l’Église et l’habitude. Le seul moment où il parut heureux fut lorsqu’il put confier l’économie aux technocrates de l’Opus Dei, qu’il considérait comme la garantie d’une modernisation sans tumulte.
Ortega y Gasset, s’il avait analysé ce régime, aurait dit que Franco avait « voulu la circonstance sans le moi », un ordre sans âme. Franco pensait que le pays pouvait se maintenir sans politique. Il oubliait que les hommes, qu’on le veuille ou non, sont des animaux politiques ; et que lorsqu’on supprime l’espace de la conflictualité civilisée, on prépare l’effondrement.
C’est exactement ce qui se produisit. La gauche espagnole, blessée mais intacte, conservant son imaginaire, sa colère, ses réseaux, son énergie, ses rancunes, attendit son heure. La droite, elle, fut rendue inapte à penser. Elle n’avait plus de doctrine, plus de langage, plus d’horizon. Lorsque Manuel Fraga fonda le Parti populaire avec Jorge Verstrynge, il le fit à la manière d’un fonctionnaire soucieux d’ordre administratif, et non selon une vision du monde. La droite espagnole abandonna tout ce qui ne relevait pas de la gestion : l’histoire, la culture, les symboles, l’imaginaire, la bataille des mots. Elle laissa à la gauche le monopole du récit. Et lorsqu’on laisse à son adversaire la définition du passé, il s’empare du présent, puis de l’avenir.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, un demi-siècle après la mort du Caudillo, l’Espagne officielle semble obsédée par la volonté de le tuer encore. On exhume, on réenterre, on débaptise, on « resignifie » des lieux, on cherche à purger l’espace public de la moindre pierre franquiste. On oublie que la mémoire n’obéit jamais à la volonté politique. Ce qui se passe aujourd’hui à Madrid n’est pas une épuration morale ; c’est la revanche d’un camp qui, pour avoir perdu la guerre, entend gagner l’histoire.
Je n’ai jamais partagé l’admiration béate que certains portent à Franco. Il a pacifié l’Espagne, certes, mais au prix d’une amputation. Il a modernisé sans émanciper. Il a discipliné sans élever. Il a confondu l’ordre avec la vertu. Il ne voyait pas que l’Espagne est un pays trop ancien, trop tragique, trop fier pour être administré comme un régiment. L’Espagne, comme le rappelait Unamuno, est une tension, une contradiction vivante. Elle n’obéit à personne. Elle se conquiert.
Lorsque la mort de Franco survint en 1975, je vivais en Bretagne, pauvre comme les goémoniers de jadis. Et c’est sur une vieille radio à galène que j’écoutai, des heures durant, les cérémonies retransmises depuis Madrid. Les foules défilaient devant le cercueil ouvert. Je revois encore ce visage cireux, figé, qui paraissait à peine humain. Ce qui m’a frappé alors, ce n’est pas l’hommage rendu à un dictateur, mais la solennité d’un peuple conscient qu’il basculait dans l’inconnu. Les Espagnols faisaient leurs adieux à un ordre, non à un homme.
Depuis, les mémoires se sont durcies. La gauche reste figée dans son antifranquisme, la droite honteuse de son passé. Les journaux français ajoutent leur couche d’incompréhension, Mediapart voyant partout du « révisionnisme », Le Figaro reconduisant, sous des habits plus sages, les interprétations de la gauche. Personne, ou presque, ne voit que l’essentiel n’est plus Franco, mais le vide qu’il a laissé.
Car au fond, Franco n’a pas perdu. Il n’a pas gagné non plus. Il s’est effacé, laissant derrière lui un pays qui, depuis cinquante ans, cherche un récit qu’il ne trouve pas.
Et pourtant, derrière ces querelles mesquines, demeure l’essentiel : l’hispanité. Cette force immense, transatlantique, qui unit l’Espagne à vingt nations du Nouveau Monde. L’Espagne est une porte, non un terminus. Elle est l’origine d’un monde. Sa langue, sa foi, ses couleurs, ses arts, ses douleurs mêmes font vivre un continent. L’Espagne, pour qui sait la regarder depuis l’Atlantique, n’est pas l’Europe périphérique que croient les Français ; elle est un foyer. Elle n’est pas un pays ; elle est une civilisation projetée.
Voilà ce que je médite, ici, sur la lande de Lechiagat, lorsque les vagues frappent Karreg Hir et que l’odeur d’algues blessées monte dans l’air. L’Espagne commémore un mort parce qu’elle n’a pas encore compris ce qu’elle est devenue. Ses adversaires d’hier en font un épouvantail, ses partisans un refuge. Mais Franco n’est plus. Ce qui demeure, c’est une nation qui hésite devant son propre reflet.
Et nous autres Européens, qui croyons vivre dans l’aplomb rassurant de nos certitudes modernes, ferions bien de regarder l’Espagne avec les yeux d’Ortega ou de Spengler. Non pour juger, mais pour comprendre. L’histoire n’est pas un tribunal. C’est une mer. Elle avance, elle recule, elle dépose et reprend. Les nations qui refusent la politique se noient. Celles qui acceptent leur tragique survivent.
L’Espagne, elle, vacille, mais elle vit. Et cela suffit à éveiller l’attention de qui aime encore les peuples.
Balbino Katz
Chroniqueur des vents et des marées
[email protected]
Illustration : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine






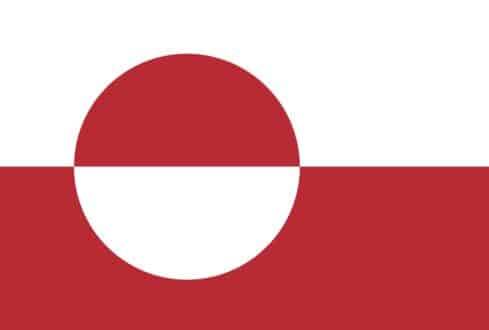







8 réponses à “Franco, la mémoire et le gouffre”
Comment en effet pardonner à ce général Franco, d’avoir empêché l’Espagne de devenir une vraie démocratie stalinienne comme la Bulgarie, la Pologne ou la République démocratique allemande avec ses Stasies et ses milices populaires.
Demat, allons y franco si vous le permettez Balbino : un bel article qui m’a permis de mieux connaitre l’Espagne de Franco ; De Gaulle l’ayant rencontré avant la fin de sa vie en 1970 lui a dit que lui a réussi à remettre la monarchie mais pas lui (le grand Charles qui nous manque tant) ; je ne sais pas ce que cela leur a apporté mais sûrement plus de souveraineté que nous actuellement ; à noter que j’ai appris la langue espagnole en deuxième langue à partir de la sixième et ai beaucoup de respect pour l peuple espagnol. Une chanson, une pépite ? c’est en cadeau pour vos articles quotidiens : The who » Pinball Wizard » puisque vous aimez comme moi le flipper : https://www.youtube.com/watch?v=hHc7bR6y06M. Kenavo
Merci ä Balbino Katz pour son excellent article !Arriba Espana ! Je conseille la lecture des ouvrages de Festivi et de Pio Moa.
Relire Pio Moa, tout est dit !
Bravo et merci à Balbino Katz pour cet excellent article sur Franco, l’Espagne et l’hispanité. Il nous permet d’entrer dans cet univers, sinon par la voie royale, du moins par la « Porte mordrelaise ».
Merci pour ce bel article, avec une pensée particulière pour le général Franco qui a sauvé des milliers de Français abandonnés par De Gaulle sur les quais d’Oran risquant d’être massacrés par le FLN.
« Le 30 juin, à 10 h du matin, malgré l’opposition de de Gaulle, le général Franco donna l’ordre à ses capitaines d’embarquer cette « misère humaine » qui attendait depuis des jours sous un soleil torride, sans la moindre assistance, un hypothétique embarquement vers la France.
Franco prévint de Gaulle qu’il était prêt à l’affrontement militaire pour sauver ces pauvres gens sans défense, abandonnés sur les quais d’Oran et menacés d’être exécutés à tout moment par le FLN. Joignant le geste à la parole, il ordonna à son aviation et sa marine de guerre de faire immédiatement route vers Oran.
Finalement, face à la détermination du général Franco et craignant un conflit armé, de Gaulle céda et le samedi 30 juin, à 13 h, deux ferrys espagnols accostèrent et embarquèrent 2 200 passagers hagards, 85 voitures et un camion. »
https://www.facebook.com/GoodmArmy/posts/il-y-a-63-ans30-juin-1962-franco-au-secours-des-pieds-noirs-oranaispour-accoster/1037891995192900/
Merci Balbino pour cet excellent article nuancé sur Franco. Mon premier voyage en Espagne date de 1971, à la fin de son règne. Mon père, comme beaucoup de pieds noirs d’Oranie, a fini ses jours à Alicante qui compta jusqu’à 30000 réfugiés de l’Algérie française.
Merci à Franco d’avoir sauvé des milliers de français Pieds-Noirs et harkis menacés de mort par le FLN alors que De Gaulle les avait abandonné.
Comme quoi, on pêut être un Président Grandissime et faire des C…ries.
A noter que les Républicains de la Guerre d’Espagne ont quand même massacré 7 000 prètres, religieuses et moines.