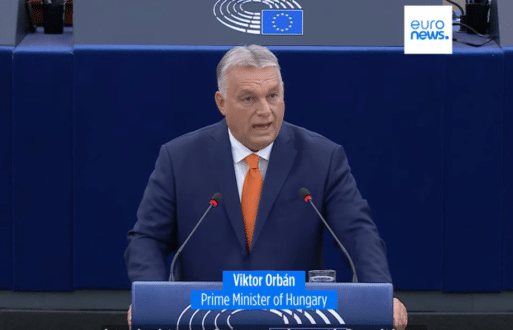La littérature bretonne, bien plus qu’un simple ensemble d’œuvres, incarne l’âme et la mémoire d’un peuple à l’identité forte. Depuis des siècles, elle est le reflet des luttes, des croyances et des rêves d’une Bretagne imprégnée d’histoire et de mythologie. Que ce soit en breton, en français, en gallo ou même en latin, cette littérature a su s’adapter aux époques tout en préservant son essence. Voici un panorama de son évolution, de ses origines à nos jours, à travers les figures majeures et les œuvres incontournables qui ont forgé la culture bretonne.
Les débuts : entre latin et breton (VIe – XIe siècles)
Les premières traces de la littérature bretonne remontent aux poètes de l’île de Bretagne, comme Aneirin et Taliesin au VIe siècle. Leurs œuvres, rédigées en vieux breton, reflètent la richesse de la tradition orale qui existait bien avant l’apparition des premiers manuscrits écrits. À la même époque, les moines bretons installés en Armorique écrivaient en latin, comme en témoigne le texte « De Excidio et Conquestu Britanniae » de Gildas, un moine historien.
La tradition littéraire bretonne s’est enrichie de récits hagiographiques, ou vies de saints, notamment celles de Saint Winwaloe et de Saint Pol, rédigées en latin dans les monastères armoricains au IXe siècle. Ces récits mêlent histoire et mythologie, posant les bases d’une littérature spirituelle et épique. Le manuscrit de Leyde, datant de la fin du VIIIe siècle, constitue l’un des plus anciens témoignages de la langue bretonne, comportant des fragments de textes médicaux.
Moyen Âge : l’influence arthurienne et l’essor du moyen breton (XIe – XVe siècles)
La littérature bretonne s’enrichit au XIe siècle avec la légende arthurienne, notamment popularisée par l’ouvrage « Historia Regum Britanniae » de Geoffroy de Monmouth. Les récits de la Table Ronde, de Tristan et Iseut, influenceront profondément les littératures française et anglaise, portés par des auteurs comme Chrétien de Troyes. Dans la même période, Étienne de Fougères, évêque de Rennes, compose en latin des vies de saints et en français un « Livre des Manières », intégrant la culture bretonne dans une littérature davantage tournée vers la France.
Le XIIIe siècle voit l’émergence de chansons de geste comme le « Roman d’Aiquin », rare témoignage épique breton. En parallèle, des historiens tels que Pierre Le Baud et Alain Bouchart s’attellent à écrire l’histoire de la Bretagne, chacun contribuant à l’identité bretonne à travers leurs chroniques.
Renaissance et littérature imprimée : le « Catholicon » (XVIe siècle)
L’un des événements majeurs pour la littérature bretonne est la publication en 1499 du « Catholicon », premier dictionnaire trilingue (breton, français, latin), qui témoigne de l’effort de codification de la langue bretonne. Ce dictionnaire marque un tournant vers la valorisation de la langue bretonne à l’écrit et inspire les traductions de textes religieux en breton. C’est également à cette époque que les premiers mystères religieux sont traduits du français au breton, posant les bases d’une littérature théâtrale bretonne.
XIXe siècle : le renouveau romantique et régionaliste
Le XIXe siècle est marqué par l’émergence de figures littéraires bretonnes de renom, influencées par le mouvement romantique. François-René de Chateaubriand, bien que souvent éloigné de sa Bretagne natale, en capture l’essence dans ses œuvres par des descriptions de paysages mélancoliques. Émile Souvestre, quant à lui, immortalise les coutumes et traditions bretonnes dans des œuvres comme Les Derniers Bretons et Le Foyer breton.
La publication du « Barzaz Breiz » de Théodore Hersart de La Villemarqué en 1839, recueil de chants populaires, suscite un engouement pour le folklore breton et contribue à la préservation des traditions orales. Parallèlement, des folkloristes comme François-Marie Luzel et Paul Sébillot collectent contes et légendes, contribuant ainsi à la documentation des traditions orales de la Bretagne.
XXe siècle : littérature bretonne et engagement
Le XXe siècle est marqué par un fort sentiment de renouveau régionaliste et nationaliste. Roparz Hemon, l’un des plus grands écrivains de langue bretonne, s’investit pleinement dans la défense de cette langue avec des œuvres telles que Ur Breizhad oc’h adkavout Breizh. Youenn Drezen, quant à lui, explore les thématiques bretonnes à travers des récits tels que An Dour en-dro d’an Inizi.
Des auteurs comme Louis Guilloux et Henri Queffélec explorent les réalités sociales et culturelles bretonnes, sans pour autant s’enfermer dans un régionalisme strict. Guilloux, avec Le Sang noir, dépeint une Bretagne ouvrière et contestataire, tandis que Queffélec célèbre la Bretagne maritime dans Un recteur de l’île de Sein.
Vers la fin du XXe siècle, Pierre-Jakez Hélias et Xavier Grall prennent des positions opposées sur la vision de la Bretagne. Dans Le Cheval d’orgueil, Hélias offre un regard nostalgique sur la Bretagne rurale, tandis que Grall, dans Le Cheval couché, prône une Bretagne tournée vers l’avenir, sans concession pour un passé idéalisé.
La littérature bretonne, riche de son passé, demeure vivante et se renouvelle constamment. Elle reflète les aspirations identitaires de la Bretagne et perpétue une tradition littéraire unique où cohabitent mythologie, histoire, romantisme et engagement politique. Que ce soit par la plume de romanciers, de poètes ou de folkloristes, la littérature bretonne continue de captiver et de transmettre l’âme de la Bretagne aux nouvelles générations, assurant ainsi sa pérennité.
Littérature médiévale et légendaire (VIe – XVe siècles)
- De Excidio et Conquestu Britanniae – Gildas (VIe siècle)
- Ce texte en latin, écrit par Gildas, moine breton, est l’une des premières chroniques sur la chute de la Bretagne insulaire sous les invasions anglo-saxonnes. Il est une référence pour comprendre la vision historique des Bretons de l’époque.
- Historia Brittonum – Nennius (IXe siècle)
- Compilation latine qui contient des récits et légendes sur les Bretons, notamment les exploits du roi Arthur. Ce texte est essentiel pour le développement des mythes bretons, en particulier ceux liés au cycle arthurien.
- Vita Sancti Goeznovei (Vie de Saint Goeznove) – Anonyme (IXe siècle)
- Biographie de l’un des saints fondateurs de Bretagne, rédigée en latin. Elle représente une partie de la littérature hagiographique de la Bretagne médiévale.
- Historia regum Britanniae (Histoire des rois de Bretagne) – Geoffroy de Monmouth (1135)
- Ouvrage rédigé en latin, qui fait le lien entre la littérature arthurienne et les origines mythiques des rois bretons. Il introduit des personnages comme Merlin et réunit des récits épiques qui influencent toute la littérature médiévale européenne.
- Le Roman d’Aiquin – Anonyme (XIIe siècle)
- La seule chanson de geste bretonne conservée, qui raconte des événements fictifs où s’entremêlent l’histoire et la mythologie.
Renaissance et période classique (XVe – XVIIIe siècles)
- Catholicon – Jehan Lagadeuc (1499)
- Premier dictionnaire trilingue (breton, français, latin), imprimé en 1499. Ce texte est essentiel dans l’histoire de la langue bretonne car il en propose une normalisation écrite et lexicale.
- Les Grandes Chroniques de Bretagne – Alain Bouchart (1514)
- Chronique historique qui compile les récits et légendes bretonnes et participe à la création d’une identité bretonne au sein de la France de l’époque.
- Mystère de Saint Gwenolé (XVIe siècle)
- Drame religieux en langue bretonne, adapté des mystères médiévaux en français. Il témoigne de l’usage du breton dans la tradition théâtrale et religieuse.
Romantisme et redécouverte du folklore (XIXe siècle)
- Barzaz Breiz – Théodore Hersart de La Villemarqué (1839)
- Recueil de chants populaires bretons en breton et en français, qui marque un renouveau de l’intérêt pour le folklore et la langue bretonne. La Villemarqué réunit des récits épiques, des chants de guerre et des ballades, mais l’authenticité de certaines pièces a été remise en question.
- Les Derniers Bretons – Émile Souvestre (1836)
- Ouvrage en français qui décrit les coutumes, les paysages et les croyances bretonnes. Souvestre s’intéresse aux traditions populaires, particulièrement celles de la Bretagne rurale.
- La Légende de la mort en Basse-Bretagne – Anatole Le Braz (1893)
- Recueil de contes et de légendes en français autour de la mort et de l’au-delà, un thème central dans la tradition bretonne. Le Braz recueille les récits des paysans et décrit leurs croyances sur l’au-delà et les esprits.
- Légendes traditionnelles de Basse-Bretagne – François-Marie Luzel (1870)
- Folkloriste de renom, Luzel recueille les légendes et contes de la tradition orale, les publiant en breton et en français. Ses œuvres constituent un fond inestimable de la littérature orale bretonne.
Littérature contemporaine et nationale (XXe siècle)
- Le Sang noir – Louis Guilloux (1935)
- Roman en français, il se déroule dans la Bretagne de l’entre-deux-guerres et dépeint les désillusions et les luttes de la classe ouvrière. Guilloux est un auteur majeur qui explore les enjeux sociaux et humains dans une Bretagne en mutation.
- Ur Breizhad oc’h adkavout Breizh (Un Breton à la recherche de la Bretagne) – Roparz Hemon (1930s)
- Hemon, écrivain et défenseur de la langue bretonne, exprime dans ce recueil son engagement pour la cause bretonne, alliant littérature et politique.
- Le Cheval d’orgueil – Pierre-Jakez Hélias (1975)
- Œuvre autobiographique en français qui raconte la jeunesse de l’auteur en pays bigouden. Véritable fresque de la culture bretonne rurale, cet ouvrage est considéré comme un classique.
- Le Cheval couché – Xavier Grall (1977)
- En réponse au Cheval d’orgueil, Grall critique la vision passéiste de la Bretagne de Hélias et prône une Bretagne moderne et vivante. Ce pamphlet poétique traduit la lutte d’une génération pour une identité bretonne nouvelle.
- Hommes liges des talus en transes – Paol Keineg (1969)
- Ce recueil de poésie en breton et en français est une révolte contre la domination culturelle et linguistique que subit la Bretagne. Keineg s’y engage pour la défense de l’identité bretonne et sa poésie marque un tournant dans la littérature militante bretonne.
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Breizh-info.com, 2024, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine