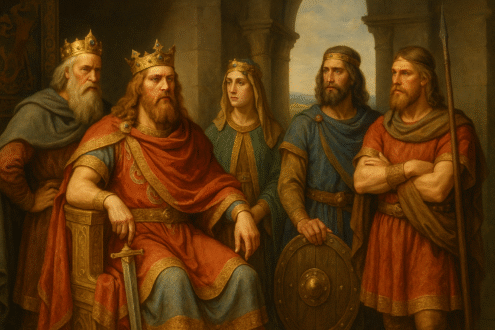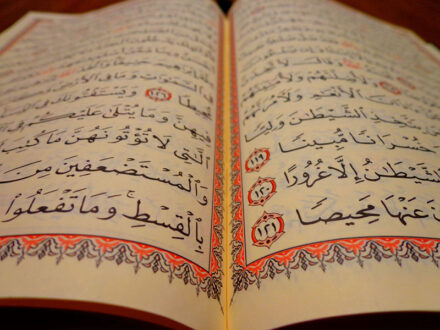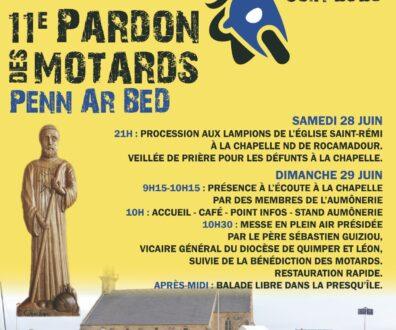Trop souvent relégués au rang de barbares sanguinaires ou de rois fainéants, les Mérovingiens pâtissent d’une image brouillée par des siècles de propagande carolingienne et de mythes scolaires. Dans Les Mérovingiens : Histoire, Société et Mythes, (éditions du Panthéon) le neurologue et historien passionné Nicolas Bérard entreprend de restituer à cette dynastie fondatrice toute sa richesse politique, culturelle et spirituelle.
En convoquant les apports de l’archéologie, de l’anthropologie et de la philologie, il explore cette époque charnière entre Antiquité et Moyen Âge, où les Francs façonnèrent les bases de notre civilisation. Entretien avec un auteur pour qui connaître Clovis et ses descendants, c’est mieux comprendre ce que signifie être Français.
Breizh-info.com : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Je m’appelle Nicolas BERARD, drômois d’origine et féru d’Histoire depuis de très longues années. J’exerce actuellement le métier de neurologue à l’hôpital universitaire de Marseille (La Timone). Je suis également titulaire d’un diplôme universitaire en histoire de la Médecine. Avant d’être auteur, j’ai longtemps été lecteurs de très nombreux ouvrages de référence dans le domaine de l’Histoire et de la Préhistoire. Mon appétence est plus volontiers portée sur la période médiévale et antique qui, je le suppose, a nourri un imaginaire plus riche et plus fantastique chez l’enfant rêveur que j’ai d’abord été, tant ce monde était captivant, peuplé de chevaliers, de vikings, de créatures mythologiques et d’odyssées incroyables. Plus tard, avec mon cheminement d’adulte et mon introduction progressive à la discipline scientifique, j’ai trouvé dans ces périodes anciennes – voire très anciennes si j’inclus les ères préhistoriques et protohistoriques -, un prisme de lecture du monde magnifique et très fertile, où le rapport au temps, à la nature humaine, à nos représentations construites me donnent à l’heure actuel des éléments de compréhension et éclairent mon positionnement sur le monde que nous vivons. J’ai le sentiment que par nos centres d’intérêt intellectuels, nous cherchons bien souvent à mieux nous comprendre, mieux savoir qui nous sommes, et pour cela il nous est utile de savoir d’où nous venons: autant que je crois trouver des réponses à cette quête dans les neurosciences modernes, je crois également en trouver dans l’Histoire, et volontiers dans l’histoire de nos origines.
Ma passion pour le Haut-Moyen-Âge et mes motivations à la rédaction de ces ouvrages n’étaient initialement pas destiné au grand publique, cependant de lecture en lecture et à force d’éplucher les sources contemporaines de l’époque mérovingienne, l’idée à peu à peu germé d’en faire une œuvre très documentée et la plus exhaustive possible sur un sujet particulièrement vaste. J’avais le sentiment que pour bon nombre, un grand vide existe dans nos repères temporels entre Clovis et Charlemagne. Cette rédaction a abouti dans l’idée de produire un «essentiel en détail» de la période mérovingienne, à la manière d’une encyclopédie dans laquelle j’ai choisi d’aborder la question sous de nombreux points de vue dépassant le récit factuel des évènements d’époque, pour plonger le lecteur dans une visite des premiers temps de la Gaule médiévale en revenant sur des éléments civilisationnels. A ce titre, j’aborde notamment la place de la médecine, l’élaborations culturelle de nos premiers temps français, les rapports de castes et la stratification sociale, la législation, le résultat des recherches en archéologie, j’étudie et reviens sur les courants artistiques et philosophiques de l’époque, sur l’habillements et l’armement, sur les légendes et mythes entourant la période, je questionne ou développe l’origine de pratiques actuelles et d’image modernes à reconstruire ou du moins rediscuter…
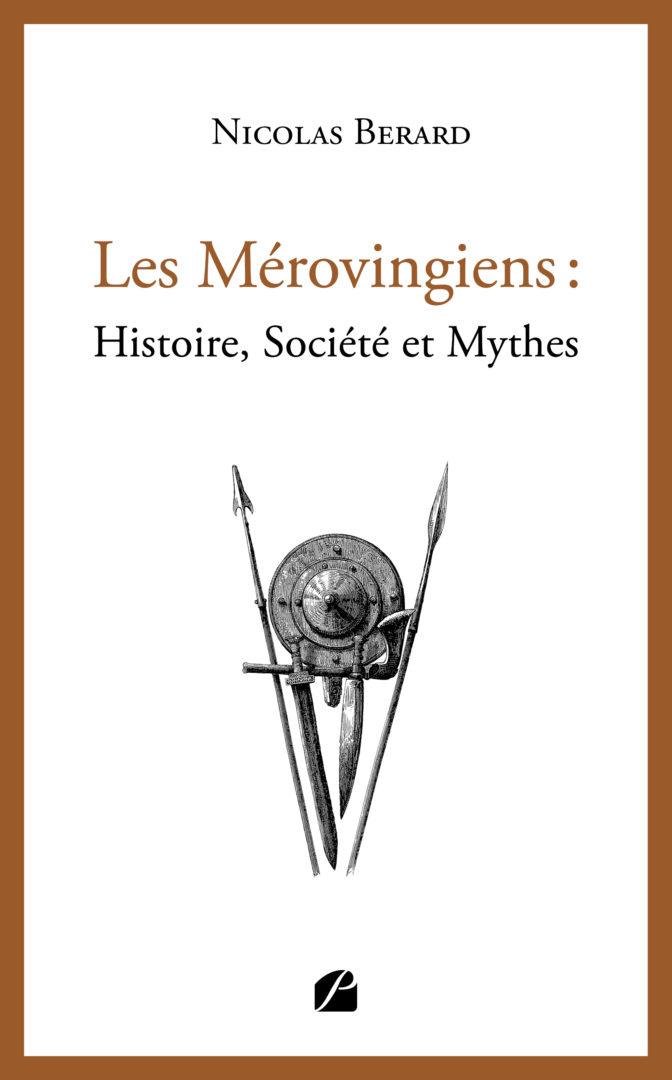
Les Mérovingiens régnèrent du IVe au VIIIe siècle et représentent le passage entre Antiquité et Moyen Âge, une période charnière que nous méconnaissons encore largement.
Au-delà du cliché de chefs barbares arrivés au pouvoir par les armes, l’auteur nous permet d’appréhender ce passé mérovingien au travers de rappels anthropologiques, linguistiques ou encore religieux. Il récapitule l’état des connaissances sur la formidable épopée des Francs, dans un contexte culturel bouillonnant : population celte face à une élite romaine supplantée par une caste dirigeante aux mœurs germaniques, dans un contexte d’implantation progressive du christianisme en Gaule.
Breizh-info.com : Dans l’imaginaire collectif, les Mérovingiens sont souvent dépeints comme des barbares sanguinaires ou des rois fainéants. À quel point cette vision est-elle erronée ?
Les Mérovingiens sont régulièrement décrit comme des rois violents et colériques, habituellement dépeint sous des traits emportés, impulsifs et sévères. Le récit historique de la période du Haut Moyen-Âge occidental nous est principalement connu au travers de l’Histoire des Francs, œuvre littéraire de Grégoire de Tours écrite dans la seconde moitié du VIème siècle et qui retrace l’histoire des rois francs sans omettre les faits violents qui ponctuent leur biographie. Non sans un certain parti-pris, Grégoire, évêque de Tours, laisse transparaître dans ses écrits une réelle désapprobation à l’égard de certains rois aux mœurs indélicates et brutales et n’hésite pas non plus à valoriser l’action des hommes agissant avec bonté et clémence, dans le respect des valeurs d’une société chrétienne du début de l’ère médiévale.
A ce titre, sont cités, pour en fustiger les auteurs, les évènements infames qui accompagnent la lutte de pouvoir et les guerres d’influences qui se tissent dans une aventure politique et militaire de tout instant. Il est vrai, ou du moins rapporté comme tel, que l’époque s’accompagne d’assassinats nombreux, d’évictions de princes héritiers par le glaive et dans le sang, de condamnation des vaincus livrés à divers supplices profondément immondes… Nous pourrions remémorer, pour l’exemple, l’anecdote du vase de Soissons, l’assassinat des fils de Clodomir, les diverses exactions orchestrées par la reine Frédégonde, le supplice de Brunehaut, le martyr de Léger, le meurtre de Galswinthe, de Sigebert Ier, de Gondovald, de Chramne… Cependant il ne s’agit absolument pas d’une particularité inhérente à la période mérovingienne, bien au contraire. L’époque en question s’appréhende dans une continuité avec les mondes romain et germanique dans une société où les condamnations, les châtiments judiciaires sont marqués par le violence physique et la démonstration dissuasive. La société des hommes des premiers siècle est rude, inflexible et cadrée par de multiples conceptions du monde qui incluent la violence dans les principes de réparations et de gestion de crises. Les choses sont ainsi, sans distinction d’époque entre la période romaine, carolingienne ou même capétienne, il n’est pas encore question de pacifisme, de promotion de la non-violence vers laquelle nous essayons de tendre dans nos siècles actuels avec plus ou moins de succès (et de manière très récente), dans une réalité moderne qui échappe encore à bien des régions du monde d’aujourd’hui. Faut-il au fond interroger bien plus véridiquement la nature humaine que l’histoire mérovingienne? Nous avons, siècles par siècle et traumatisme après traumatisme choisi de construire une société où les garde-fous sont nombreux et fruits de maints combats menés. Pour autant, la période mérovingienne et les rois qui gouvernent ne sont pas désintéressés des problématiques de sécurité et gardent la volonté première d’assurer la protection de ses sujets. L’exemple de la rédaction d’une loi salique par Clovis en est concret: dans l’idée de garantir la justice et de mettre fin aux vengeances privées, la société mérovingienne est régie par des lois, le droit romain s’applique, de nombreux tribunaux sont montés et les condamnations sont codifiées et proportionnelles.
Le rattachement de l’ère mérovingienne à une ère de violence tient, à mon avis, pour beaucoup de la construction et du fantasme. De la même manière que le Moyen-Âge est régulièrement présenté comme une période où les hommes sont sales, malades, négligés et loqueteux dans une Terre sans soleil, notre histoire mérovingienne s’instaure dans un contexte qui fut nommé a postériori «les invasion barbares», et qui véhicule, avec le reste du Moyen-Âge une image bien sombre, nourrie de récits sanguinaires. Comme si les premiers hommes de notre pays n’avaient pu être que des primitifs, des sauvages, des barbares (avec tous les guillemets du monde), comme si cela venait satisfaire notre idée d’un certain déroulé historique attendu, ayant débuté dans le chaos pour nous mener de siècle en siècle vers la paix, la justice, la lumière et l’humanisme radieux? Chacun d’entre nous croit connaitre les latins et se représente des sénateurs en toges immaculée toujours propres et présentables, raffinés et adepte de l’hygiène du corps, et ce n’est ni la dépouille d’un Jules César lardé de dizaines d’entailles et baignant dans son sang, ni la face livide décapitée de Pompée offerte au vainqueur, ni la crucifixion de Jésus-Christ ayant enduré la passion, ni le visage cyanosé et vultueux d’un Vercingétorix étranglé dans l’ombre de son ergastule, ni la folie d’un Néron pyromane, ni les suicides les plus spectaculaires (Caton d’Utique, Sénèque…) de l’époque romaine qui nous font reconsidérer notre si douce représentation de ces humains drapés de blanc, amateur d’art et de lettres, de banquets, de musique et de vins… L’idée parallèle d’évoquer l’époque antérieur et le passé helléniste de notre civilisation viendrait souligner le même paradoxe: a-t-on un jour représenté l’Arcadie sous la pluie et les grecs sans soleil quand il suffit pourtant de se plonger sans creuser bien loin dans la mythologie et les récits d’Hérodote pour contempler l’ampleur de la violence qui régnait sur ces temps anciens (à ce titre d’ailleurs, le monde méditerranéen comporte bien plus d’anecdote à caractères sexuels tabous profondément incestuelles ou terriblement non consenties et de supplices qualifiables de barbares)!
Il devient alors complexe de défendre les Mérovingiens de ne pas avoir été sanguinaires, mais il est injuste de leur en faire porter la quintessence allégorique, et pire, il serait faux de considérée que ceci n’est pas qu’un aspect de la société mérovingienne. Car la société mérovingienne est aussi une société où l’art continue de se développer, où l’émulsion intellectuelle continue d’être, à travers le milieu spirituel chrétien, où s’écrit encore la poésie (citons Venance Fortunat) et où les hommes instruits dans la moralité chrétienne ont un sens aiguisé du bien et du mal et œuvre autant que possible (avec plus ou moins de ferveur) à la création d’un monde juste et beau. Les canonisations sont multiples sous l’ère mérovingienne, plusieurs rois sont devenus des saints et plus largement leurs épouses. Outre les quelques ordonnances royales qui montrent un soin des monarques à faire régner la Justice (la loi salique étant le plus clair exemple), la période mérovingienne s’associe à l’essor de la valeur chrétienne de charité, d’aide aux indigents, du respect de l’hospitalité, de soins des malades (Clovis est parfois présenté comme le premier roi thaumaturge). Fleurissent alors de nombreux monastères qui acquièrent une fonction hospitalière, et chaque citoyen franc, élevé dans la foi, est éveillé à la nature de ce qui est bien ou mal, bon ou mauvais, à travers un prisme chrétien qui façonne encore en bonne partie notre lecture du monde et de la morale.
Pour ce qu’il en est de cette vision des rois fainéants, elle ne semble pas crédible à l’heure actuelle, mais belle et bien construite par le roman national qui a suivi la période en question. Avec Clovis II, fils du grand roi Dagobert (mort en 639), l’histoire des mérovingiens perd de sa superbe car s’amorce un lent déclin qui, en un siècle et demi, mettra un terme définitif à la lignée de Clovis au profit de celle qui donnera naissance à Charlemagne. La réalité historique est complexe à réellement démêler et le récit qui nous est parvenu, à savoir notre connaissance des évènements factuels qui entourent la période de déliquescence dynastique repose sur le Liber Historiae Francorum et les continuations de Frédégaire qui furent écrite après l’an 700, après la mort de Pépin de Herstal, le grand vainqueur des Maires du Palais (la deuxième continuation de Frédégaire est d’ailleurs écrite par Childebrand, frère de Charles Martel).
Ceci pose question sur une impartialité des éléments historiques connus… Le récit factuel et admis de la phase terminale de la dynastie mérovingienne est écrit par une plume carolingienne. Les évènements se sont-ils déroulés d’une manière aussi nettement défavorable qui décrits? Si oui, on peut alors admettre que les dernières générations de mérovingiens semblent avoir été de biens jeunes rois au parcours peu impactant, mais cela semble difficile à avaler! A titre d’exemple, l’image du roi mérovingien tiré par des bœufs est un des arguments majeurs des partisans de Charlemagne, pour affirmer l’inutilité des mérovingiens et ainsi légitimer la prise de pouvoir carolingienne. Décrivant des monarques vautrés dans un char, Eginhard, biographe de Charlemagne, a d’ailleurs su ancrer cette image dans l’Histoire et la faire perdurer jusqu’à nos jours. Pourtant, derrière cette volonté de décrédibiliser la dynastie se trouve un symbole aux origines bien plus archaïques car la tradition veut que le nouveau roi parcoure son royaume monté sur un char a bœufs, prodiguant ainsi bonne fécondité a son peuple. Il s’agit en réalité d’un rite de fécondité ancien dont Tacite témoigne déjà dans La Germanie. Le récit des compagnes militaires (certes remportées par Charles Martel) et des diverses ordonnances royales montre en tout cas la persistance d’une implication politique des derniers rois mérovingiens et une véritable lutte pour leur conservation. Pourtant il en est autrement dans notre imaginaire collectif, l’Histoire s’écrit par les vainqueurs…
Breizh-info.com : D’où vient cette image péjorative des derniers rois mérovingiens ? Est-elle une construction politique des Carolingiens ou des historiens postérieurs ?
Dans la continuité de la réponse précédents, trop souvent rapportes à cette fin peu chevaleresque, les Mérovingiens sont peu à peu devenus les rois fainéants et indignes qui précédèrent Charlemagne et sa lignée. Cette réputation, colportée dès le VIIIe siècle, est devenue pour l’opinion des gens du commun une vérité suffisante pour acclamer les Pépinides comme les seuls rois dignes qu’ils n’aient jamais eus (qui furent finalement connus sous le nom de Carolingiens en raison de Charlemagne et de sa grandeur qui, pour les historiens, surpassait de loin celle de tous ses ancêtres). Il est bien certain que la fin des Mérovingiens n’a rien de glorieux, et qu’il faut laisser aux Pépinides les lauriers de leur ascension, mais il reste important de préciser que cette image déplorable fut amplifiée par les Carolingiens eux-mêmes. Valorisés par la décadence de la dynastie éradiquée, les nouveaux rois pouvaient alors régner sans conteste et sans crainte de la défection de leurs vassaux s’ils apparaissaient en défenseurs de la royauté et en sauveurs de l’héritage de Clovis. Ainsi, durant des siècles, les crieurs publics, les conteurs et autres diffuseurs d’opinions ont œuvré pour salir le nom des derniers rois, et pour bâtir autour d’eux tant de légendes lugubres qui donnèrent cette vision faussement reconnue des rois fainéants.
A la suite de cette campagne diffamatoire menée par les élites carolingienne en quête de légitimité, l’Histoire s’est plongée dans le dit «Moyen-Âge» comme il fut nommé a postériori. Il s’agit d’une période millénaire de domination culturelle et spirituelle chrétienne qui a beaucoup décentré l’homme pour faire de Dieu la réelle priorité. Il faut attendre de voir émerger des périodes culturelles plus récentes de l’époque des Temps Modernes pour qu’apparaissent des courants humanistes, moins rattachés à des dogmes religieux et plus centrés sur des problématiques mettant l’homme en premier plan. Dans cette Renaissance, comme elle fut nommée sur le plan artistique, naît une large idéalisation de la période antique où, comme il est supposé en raison de la pluralité des pensées dominantes et des courants philosophiques existants, on se met à construire l’image idéalisé de la période gréco-romaine qui apparaît d’autant plus glorieuse qu’elle contraste avec la période médiévale alors sujette à toutes les accusations. Dans ce contexte, le déclin de l’époque romaine fut inéluctablement associé à l’entrée dans l’obscurantisme, et les mérovingiens était alors les coupables tout trouvés.
Les idées des Lumières ont également joué un rôle important dans la validation de ce schéma avec l’apparition d’une vision extrêmes satirique et dévalorisante ricochée sur les mérovingiens à travers la chanson si bien connu du bon roi Dagobert ayant mis sa culotte à l’envers. A l’origine caricaturale des souverains contemporains (Louis XV et Louis XVI principalement), la chanson a peu à peu enfermé notre roi dans ce rôle de bougre malhabile, à tel point qu’on en oublia son sens premier. Pour beaucoup, cette chansonnette anodine n’est plus qu’un descriptif de la nature fort maladroite d’un roi d’antan. A la fin du XIXe siècle, l’accessibilité à l’école (lois Jules Ferry) apporte une nouvelle vision de Dagobert et de ses descendants. Déjà malmené par la chanson révolutionnaire (qui influence la suite des évènements), Dagobert est présenté, dans les programmes scolaires, comme le premier des rois fainéants et se voit accompagné de la série des caricatures propres à ces monarques.
Lui qu’Eginhard et les Carolingiens estimés comme le dernier des grands mérovingiens… Le voici passant de derniers des héros à premier des nabots… Cette image de roi ridicule qui persiste aujourd’hui (deux films de 1963 et 1984 le prouvent) fait de Dagobert un roi diamétralement opposé à l’image qu’il suscitait jadis, mais contribue à rendre une autre forme de renommée a ce monarque d’envergure qui compte parmi les plus grands rois de France. C’est avec cette création des programmes scolaires et cette lecture à l’ancre désormais sèche du roman national, que fut gravé dans le marbre l’image faussement dommage qui fait des mérovingiens, pour les premiers membres de la dynastie, des rois sanguinaires et cruels, et pour les seconds, des couards lymphatiques et pusillanimes.
Breizh-info.com : On parle souvent de Clovis et de son baptême comme acte fondateur de la France. Dans quelle mesure cela reflète-t-il une réalité historique et non une reconstruction mythologique?
La légende de la conversion de Clovis au retour de la bataille de Tolbiac durant laquelle la victoire lui aurait été accordé dans les suites d’une prière à Jésus-Christ semble plus difficile à prouver, mais telles sont les motivations qu’on prête au roi et qui sont exposées dans les sources contemporaines. De toute évidence, si l’acte de foi est à prendre comme tel, il existe des conséquences politiques majeures dans la conversion de Clovis au christianisme. De la même manière que Clovis épouse en 491 le nommée Clothilde de Burgondie, un rapprochement au christianisme à plusieurs effets pour le roi des Francs. D’une part, Clovis, dès lors qu’il règne sur des sujets gaulois, règne sur une population christianisée depuis le Ier et IIe siècle. Par son ancêtre bisaïeul Clodion ayant conquis la région de Tournai, et par son père Childéric, qui a semble-t-il été sensibilisé au christianisme en contemporain de sainte Geneviève, Clovis ne pouvait qu’être favorable à la religion catholique. S’il fut initialement réticent à embrasser la religion de son épouse (Grégoire de Tours nous évoque la mort de son premier fils Ingomir, né de Clothilde et baptisé dans la foi catholique pourtant décédé peu après), il ne demeure pas moins le souverain d’une population qui se rends à l’office chaque semaine en écoutant les prêches de prêtres ou d’évêques qui sont le réel vecteur d’information du territoire.
L’opinion des religieux faisant l’opinion du peuple, Clovis a tous les intérêts d’être apprécié des évêques et de prendre soin de son image auprès d’eux. Clovis, d’autre part, adopte la religion d’Etat de l’ancien Empire Romain, ce qui n’est pas sans l’inscrire dans une continuité culturelle légitimiste, et ceux d’autant dans une époque où les rois souverains frontaliers wisigoths comme ostrogoths sont adepte de l’arianisme. Dans une période de lutte et d’influence où la botte italienne est sous la gouvernance du nommé Théodoric le Grand, qui se veut souverains et guide spirituelle de l’occident en reconstruction, Clovis marque et assume un clivage qui signe ses intentions de n’avoir ni maitre ni autorité supérieure parmi les nouveaux souverains d’Europe, mieux, cet acte lui apporte la reconnaissance de l’empereur romain d’Orient Anastase Ier qui le considère en successeurs des Césars romains. La suite de l’Histoire s’est écrite de victoire en victoires et a donné raison à la religion que choisit Clovis puisqu’elle put prendre son essor en même temps que le triomphe des mérovingiens sur leurs voisins, et gagner, monarque après monarque, en influence et en rayonnement jusqu’à donner au Moyen-Âge cette hégémonie spirituelle que nous lui connaissons.
Breizh-info.com : Votre ouvrage met en lumière un brassage culturel mérovingien entre héritages celtiques, romains et germaniques. Quels sont les éléments les plus marquants de cette hybridation ?
La richesse culturelle de la période mérovingienne tient en effet en partie de cette quadruple influence qui colore la société franque du début du Moyen-Âge. Compendieusement, les populations majoritaires qui habitent la Gaule sont d’essence celtique, elles ont ensuite été romanisé après la conquête des Gaules par Jules César, marquant un globale remaniement culturel qui s’est ensuite enrichi de l’implantation d’une caste dirigeante aux mœurs et à la culture germanique, sur laquelle une influence chrétienne est venue s’apposer. Ce syncrétisme est particulièrement visible dans le domaine artistique que l’archéologie a su exhumer. L’interdépendance des styles, des motifs, des matériaux et des techniques, plus ou moins orientés selon les différentes régions de la Gaule est d’ailleurs sujette à tant de diversité, que toute catégorisation nous apparaitrait réductrice: la Burgondie est, à l’époque merovingienne, une terre très romanisée qui en porte l’influence bien plus que la Gaule du Nord, dont les racines sont germaniques.
A une échelle plus quotidienne, l’hybridation syncrétique observé par cette apposition culturelle multiple est également visible dans l’habillement: le cucullus et le sayon sont gaulois, la chlamyde et le chiton sont grecque, la braie est germanique, la tunique est romaine et ceci coexiste dans un brassage bien souvent indistinct.
Plus généralement, la conception du monde et la mentalité philosophique des mérovingiens est emprunte de racines germaniques ou la vision de la vie est synonyme de lutte (à l’instar du combat eschatologique du Ragnarok) mais reste pondérée par une vision romaine du raffinement et du soin et par une lecture chrétienne du bien et du mal (un chapitre entier de l’ouvrage est dédié à cette évolution conceptuelle et philosophique qui s’opère dans l’esprit des Francs du proto-Moyen-Âge). La pratique de la médecine ou encore l’application des lois n’échappe pas à cette spécificité mérovingienne non plus.
Breizh-info.com : La transition entre la Gaule romaine et le royaume mérovingien est souvent perçue comme une rupture brutale. Peut-on au contraire parler d’une continuité ?
La construction mentale qui nous amène souvent à voir la transition entre Antiquité et Moyen-Âge comme un épisode clivant et brutal est largement surestimée. Il s’agit bien plus vraisemblablement d’une continuité et d’une transition douce, malgré les idées reçues. Il n’y a pas de rupture si nette avec la venue des mérovingienne et les populations déjà implantées ne sont pas amenées à repenser leur mode de vie, ne sont ni opprimées, ni bannies. Dans le fond, seule la caste dirigeant change, mais le système administratif reste le même. L’ordre établit et la société gallo-romaine ne seront réformés que par touches successives et les mutations culturelles s’appliqueront avec lenteur. Il me semble plus juste de considérer l’avènement mérovingiens chez les gallo-romains comme une nouvelle strate apposée à un terreau déjà riche, qui conserve sa langue, ses lois, sa religion et nombre de ses codes sociaux… L’évolution et la bascule dans l’ère médiévale est progressive, elle accompagne l’essor de l’influence du christianisme qui évolue décennies après décennies. Les éléments marquant de l’évolution de la société gallo-romaine en une société mérovingienne ne sont d’ailleurs pas particulièrement apportés par Clovis. Bien sûr, avec Clovis, le roi devient chrétien, la loi salique s’impose, et le territoire s’agrandit, mais c’est avec Clotaire II qui se développe l’école du palais, et sous Clotaire Ier que vit Saint Benoit ou sous Sigebert Ier que vit Saint Colomban. L’entrée réelle dans la société médiévale comme connue dans ses différences avec l’antiquité tient en deux points dominants: la modification d’une l’organisation du pouvoir politique qui passe d’un empire à une royauté (ce qui fait peu de différence pour le peuple), et l’essor de la religion chrétienne qui s’enracine dans l’organisation politique. Cela ne s’opère pas dans la violence, cela se gagne par l’adhésion des sujets mérovingiens. C’est encore une fois l’imaginaire générale qui tend à mettre en opposition Antiquité et Moyen-Âge qui semble apporter cette vision, mais il n’y a rien de similaire entre comparer l’an 400 avec l’an 500 et mettre en opposition le Ier siècle (pax romana) avec le Xie (Paix de Dieu). Cela pourrait vite apporter de la confusion, au même titre qui l’on présentait l’évolution de la société aux grand publique en lui laissant imaginer qu’il n’y a aucune transition entre l’époque du Grand siècle de Louis XIV et notre actuelle Ve République… Rappelons que les hommes qui vécurent dans la fin des années 450 ne furent pas directement informés qu’ils changeaient d’ère et ne le virent absolument pas, car cette date de 476 qui marque la chute de l’Empire romain et sonne le départ du Moyen-Âge fut en réalité abordée comme un marqueur temporel 1500 ans plus tard…
Breizh-info.com : L’implantation du christianisme sous les Mérovingiens est souvent décrite comme progressive mais inéluctable. Y a-t-il eu des résistances païennes notables ?
On parle bien souvent des Francs comme des nouveaux chrétiens de la Gaule médiévale. Pourtant, la transition entre paganisme et christianisme fut loin d’être instantanée dans les esprits mérovingiens. La venue des Francs s’annonce dans une ère de fort essor du christianisme en Gaule qui, gagnant d’abord l’élite, avait fini par rassembler presque tous les Gallo-Romains dès les premiers siècles, bien avant la venue des Francs en Gaule. L’acte politique et spirituel (dont la sincérité est complexe à établir) de Clovis, qui choisit d’embrasser la religion catholique, entrainant avec lui ses fidèles, ainsi que le métissage progressif entre Gaulois et Francs qui s’unirent, favorisèrent l’extinction de ces croyances germaniques. En effet, l’évènement majeur qui déciderait du sort de Wotan (divinité franque proto-odinique) était bien la suprématie de l’Eglise qui allait s’enraciner politiquement et obtenir le monopole de la communication et de la diffusion des opinions en terre merovingienne. Notons cependant que le monde rural resta longtemps très attaché à ses valeurs et à ses croyances païennes qui, pour lui (contrairement à la pensée cléricale), cohabitent sans difficultés conceptuelles avec les croyances chrétiennes.
Car tel est bien là la question, à l’image des mutations spirituelles qui abondent avec l’expansion du monde romains dans les siècles de la Pax Romana, où divers cultes orientaux et «barbares» se greffent au panthéon, incluant par la Sol Invictus, Mitra, Cybèle et même le nommé Jésus de Nazareth, les peuples dominés par une nouvelle caste dirigeante se montrent généralement plutôt ouverts à élargir leurs croyances, bien plus qu’à renoncer à celles préexistantes. Sans parler de résistance active (comme ce fut par exemple le cas avec les persécutions chrétiennes et les martyrs dans l’époque romaine), conscients d’une survivance très ancrée de croyances «impies» dans les esprits populaires, les clercs (Grégoire de Tours notamment), et les lettrés chrétiens se livrèrent rapidement à une campagne de diabolisation massive des créatures païennes. Désormais regroupées sous des noms latins très réducteurs (rendant très compliquées les recherches des spécialistes) tels que faunus, sylvus ou encore neptunus, les créatures païennes devinrent peu à peu les monstres qui nourrissaient les légendes chrétiennes. Ces numens, qui ne relèvent pas de Dieu, et relèvent donc du diable, furent terriblement salis et assombris. Leurs apparitions devenant des signes du malin ou de ses serviteurs, nous les affublâmes de bien des origines impropres (esprits déchus, créatures révoltées contre Dieu et bannies, simples démons et lémures), et ils n’apparurent, au fil du temps, que sous des formes perfides et infernales. Sans aller jusqu’à dire que ce phénomène païen fut une chance pour les chroniqueurs chrétiens, il n’en résulte pas moins qu’il fut pris par l’Eglise comme une façon habile et peut-être en partie inconsciente de prouver sa supériorité. Les exemples sont nombreux de ces victoires de la foi chrétienne contre les créatures viles, les tempêtes ou les esprits malins. Avec les saints sauroctones, autant qu’avec tant d’évènements miraculeux décrits dans des cadres de christianisation, partout les textes et les icônes abondent en démonstrations de la suprématie chrétienne… Personnifiées sous les traits de dragons ou de bêtes immondes en tous genres, ces créatures, si puissantes qu’elles étaient, n’en furent pas moins chassées et bannies par la «force» des bons chrétiens, expatriées loin des villes et des terres des hommes.
En dépit de cette appropriation spirituelle de l’Eglise catholique, et de ses tentatives de diabolisation virulentes, une longue période de cohabitation existe entre le paganisme et le christianisme (il en fut de même entre christianisme et croyances romaines et celtes à partir du IIe siècle). Encore bien présents dans certains milieux francs plutôt agricoles, le culte de la Terre-Mère, des Esprits tutélaires, ou du père Odin, trouvèrent un sens longtemps après la conversion de Clovis, comme l’attestent différents textes médiévaux (comme ceux de Paulus Diaconus et de saint Colomban, ou encore les inscriptions de Merseburg) dont les plus récents datent du Xe siècle. Objets de cultes agraires, de traditions familiales ou de rites obscurs, ces créatures, que l’on nomma «démons» dès le Moyen-Âge, furent chassées au fil des siècles. On planta des croix pour les intimider, on raconta peu à peu que le son des cloches les dérangeait au point qu’ils s’exilèrent loin de toute église ; que des chrétiens exceptionnels les avaient, sinon apprivoisés, bannis dans des forêts sombres ou en des lieux éloignes de la civilisation ; qu’ils habitaient désormais de hauts sommets venteux ou de profonds étangs bien à l’écart du monde des hommes. Demeurant pour certains des divinités protectrices ou des esprits ancestraux, la plupart de ces êtres finirent par disparaitre, et leurs survivants ne relevèrent bientôt plus que de la superstition paysanne, du dicton, ou de traditions aux origines perdues.
Breizh-info.com : Mérovée, le fondateur de la dynastie, est un personnage assez énigmatique. Quelle est la part de légende et de réalité autour de son existence ?
Selon la version la plus admise, Mérovée est le père de Childéric, et le grand-père de Clovis, il est fils de Clodion cependant sa filiation est difficile à établir et sujette à caution. Il est possible qu’a la mort de Clodion, le royaume ait été divisé entre ses filsdont Mérovée aurait obtenu Tournai. Ce moindre royaume le rend moins important aux yeux des chroniqueurs de son temps, mais il prime sur son ou ses frères par sa parenté avec Clovis.
La légende de Mérovée est en partie alimentée par le mythe qui entoure sa naissance. D’après la Chronique de Frédégaire, sa mère, déjà enceinte, fut séduite par une créature marine alors qu’elle se baignait dans l’océan. Fécondée une seconde fois, cette union des semences donna vie a une nouvelle dynastie dont les membres seraient imprégnés d’une aura surnaturelle. Pour certains historiens, Mérovée serait ainsi un personnage mythologique, fils de la mer, à l’image d’une divinité que les Francs honoraient dans leur époque paganiste.
En réalité, l’existence historique de Mérovée semble très fortement probable. Plusieurs textes (contemporains ou non) en font mention. Il s’agit vraisemblablement du roi qui mena les troupes franques à la bataille des champs catalaunique, toutefois aucune source ne le précise clairement puisqu’il n’existe pas de texte relatant les éléments biographiques directs concernant Mérovée. De nombreux historiens ont étudié la questions et formulées diverses hypothèses concernant ce roi mystérieux dont l’existence parait difficile à récuser tant le personnage est repris et cité dans les généalogies ultérieures. Est-il le personnage cité par son contemporain Priscus qui s’allia à Aetius? Était-il un chef franc salien parmi d’autre dans une fratrie qui engendra jusqu’à Childéric (un nommé Clodebaud apparait dans une généalogie austrasienne datant des années 630) ? Constitue-t-il une ascendance maternelle de Childéric? Aucun document ne semble en mesure de fournir une réponse claire et toute spéculation reste entendable. Il faudra ainsi admettre que Mérovée viendra pour longtemps encore draper les origines mérovingiennes de légendes, nimbant des brumes fantastiques le temps des premiers rois, comme si le point de départ de notre royauté, à l’instar de bien des situations semblables en histoire comparée, ne pouvait qu’être mythologique. Rappelons à ce titre que les ascendances généalogiques prêtées à Mérovée, par son père Clodion, le rattache à des personnages mythiques tel que son bisaïeul Pharamond, lui-même associé à la descendance du troyen Hector.
Breizh-info.com : Peut-on parler d’un proto-État sous les Mérovingiens, ou leur pouvoir reposait-il encore largement sur des structures tribales ?
Si les peuples francs primitifs vivent dans une société de petite échelle où l’autorité royale est celle d’un chef de guerre fort qui gouverne à la fois par clientélisme et par démonstration répétée de sa domination physique, la période mérovingienne s’inscrit plus en continuité avec le monde romain qui la précède en Gaule, du moins à l’heure ou Clovis s’empare du pouvoir, et fini par donner les contours de la société médiévale qui suivra. Utiliser le terme de proto-état reviendrait à souligner des éléments disparates récusant une centralisation globale de l’organisation politique à l’époque mérovingienne, ce qui me semble peu exacte. Cette idée pourrait trouver sa réponse affirmative en considérant que la Gaule est encore très largement morcelée à l’époque mérovingienne sur le plan politique, et qu’une unité territoriale est rare, puisque la coutume germanique n’applique aucun droit d’ainesse (qui ne voit le jour qu’à titre anecdotique durant la fin de la période mérovingienne). A la mort des souverains, leurs fils obtiennent tous une part du royaume. Ce principe de succession qui s’appliquera jusqu’aux capétiens alimenta de nombreuses querelles fratricides qui purent entrer en guerre ouverte les uns contre les autres, même si des jalousies fraternelles et des tentatives de complots jalonnent notre histoire de manière toute aussi fréquente (mais sans doute moins frontale) avec l’adoption du système de succession qui favorisera le premier-né mâle. Pour autant, à chaque royaume son appareil étatique centralisé avec son pouvoir militaire, judiciaire, administratif et exécutif appartenant au roi. A ce titre, les premiers rois barbares mérovingiens disposent d’un pouvoir quasi absolu. S’appuyant tout d’abord sur leur légitimité germanique, acquise par une origine mythique et par de hauts faits de guerre et basée plus tard sur une légitimité impériale et religieuse, l’autorité royale est sans conteste auprès des Francs et pour tous les Gallo-Romains.
Parce qu’il règne sur des sujets nombreux, le pouvoir du roi étant affaire de représentation, il reste conféré par l’aristocratie qui le sert. D’abord chefs et commandants de guerre germains, bien vite, les leudes jouèrent un rôle devenant plus administratif (et souvent exercé par les Gallo-Romains), hérité de l’Empire. Par son rôle, l’aristocratie, dès l’époque des fils de Clovis, se constitue en partie de hauts fonctionnaires qui forment un gouvernement central institué par le roi, et occupent une place qui devient progressivement celle des ministres. Même si le roi conserve une autorité absolue, il la relègue à des hommes spécialistes dans leur domaine. Dans ces fonctions qui fleurissent sous Clotaire II et Dagobert, le référendaire (ou chancelier), chef du pouvoir législatif, détient le rôle de premier ministre en rédigeant et promulguant les édits royaux. De même, le trésorier royal, contrôleur des mines et des métaux, ministre des Finances, administre le fisc et fait battre la monnaie (même si quelques pièces circulent à l’effigie des grands feudataires). A partir de Clotaire II, l’école palatine forme des maires et d’autres dignitaires qui viennent seconder les ministres et prennent, dans un premier temps, un rôle de secrétaire d’Etat.
Au niveau central, l’organisation territoriale est donnée par le roi a des ducs (dux) qui assument des fonctions militaires et a des comtes (comes) qui gèrent l’administration locale. La Justice est, elle, exercée par le roi qui fait appliquer des lois écrites et tranche les affaires litigieuses. En clair, avec les mérovingiens, le système politique s’organise et jette les bases d’un état solide et d’une nation forte qui lui assurera stabilité et longévité.
Breizh-info.com : Pourquoi les Carolingiens ont-ils cherché à effacer l’héritage mérovingien ? Quels étaient leurs intérêts dans cette réécriture de l’Histoire ?
En toute honnêteté, les Carolingiens n’ont pas souhaité tout effacer du souvenir mérovingien, puisqu’ils ont voulu s’ériger en successeurs et héritiers des premiers rois, et en défenseur du souvenir des grands souverains francs qu’avaient été Clovis jusqu’à Dagobert. Le travail de légitimation s’est associé au travail de décrédibilisation des derniers mérovingiens. Pour les carolingiens, le roi Dagobert Ier est considéré, après la chute de la dynastie merovingienne, comme le dernier roi digne de la couronne des Francs (puisqu’il est précédé par les rois dits fainéants). Ainsi, lorsqu’il dépose la dynastie, Pepin le Bref, par un second sacre symbolique en 754 par le pape à la basilique Saint-Denis, rappelle au peuple qu’il est le nouveau roi des Francs, et qu’il s’inscrit dans la continuité de Dagobert. La Gesta Dagoberti est d’ailleurs rédigée sous l’ère Carolingienne, après la mort de Charlemagne.
C’est avec Clovis II et avec l’ascension progressive des Pépinides que le rapport au roi gagne en ambiguïté… De plus en plus jeune et par des règnes de plus en plus courts, les rois mérovingiens ont vu leur autorité toujours plus discutée par les maires du palais de plus en plus impliqués sur le plan politique et militaire.
Sans revenir sur la fin discutable de la dynastie mérovingienne, car retranscrite par leur vainqueur, il fut utile d’accuser, d’accabler et de blâmer les rois qu’on venait de trahir et d’usurper! Cette étape est essentielle à la légitimation du pouvoir carolingien et valorise d’autant plus son ascension puisque son accès au pouvoir signifie dès lors délivrance du pays! Ce récit du déclin mérovingien porte les carolingiens en sauveur d’une nation déliquescente. Pour autant, la société comme instauré par Clovis et sa descendance n’est pas structurellement modifié par les Carolingiens, au contraire, elle s’aborde dans un système qui évolue peu. Les Carolingiens, au même titre que les prédécesseurs, sont d’essence franque et leur place aristocratique leur donne un cadre culture germanique identique aux Mérovingiens. La réelle évolution sociétale qui s’opère sous les Carolingiens tient dans la cléricalisation du pouvoir qui se base sur un modèle ne dissociant plus le religieux au sein même de l’appareil politique. Ce cap qui ne fut pas franchi par les Mérovingiens annonce une ère qu’on a pu nommer Renaissance carolingienne, et qui place l’influence spirituelle chrétienne désormais très largement au premier plan.
Breizh-info.com : Aujourd’hui, le grand public méconnaît largement cette période. Comment expliquez-vous ce relatif oubli historique ?
Il est vrai que l’ère mérovingienne est globalement méconnue du grand publique, et cela tient à la place qu’on donne aux repères temporels dans notre structuration des temps anciens. Les écoliers (faut-il reparler de Jules Ferry), doivent apprendre, après l’an zéro, la date de 476 (chute de l’Empire Romain d’Occident) et la date de l’an 800 (couronnement de Charlemagne), s’en suit d’ailleurs 987 et l’ascension de Hugues Capet. Pour ce qu’il est à connaitre avant, sans doute la naissance de l’agriculture, de l’écriture, puis de la démocratie et enfin l’apogée romaine. Dans les programmes historiques, la place n’est pas vraiment large pour les Mérovingiens, il faut déjà avoir un regard sur la préhistoire, l’Égypte antique, le monde grec, romain puis gallo-romain…
Alors que faire de ces 300 années qui suivent le baptême de Clovis? Et de même pour les 200 années qui suivent le sacre de Charlemagne (je pose la question d’ailleurs des repères historiques du grand publiques sur la période 1000 ap. JC – 1500 ap. JC: Saint Louiset la Guerre de Cent-Ans)? Je ne crois pas qu’il faille directement cibler la période des mérovingiens pour accuser ce coup du sort, je pense qu’il existe une quantité de sources moindre pour une période qui commence à nous sembler lointaines… Notre espèce à 300000 ans, mais penser à l’époque qui existe avant le XVIème siècle est pour beaucoup, il me semble, comme évoquer des temps pré-diluviens. Il est pourtant amusant de considérée que l’ère mérovingienne, tient une place temporelle longue comme entre aujourd’hui et la mort de Louis XIV, mais il faut entendre que le sujet, probablement moins présent dans notre monde car estimé souvent comme archaïque, ne fait pas le poids en étude comparée avec les conflits modernes. Les causes et les effets connus de l’époque médiévales sont probablement moins à-vif, mieux digérées et plus admises… Les transition politiques du siècle des Lumières et la révolution françaises, les réformes pharaoniques de Napoléon Bonaparte, la naissance d’une ère industrielle, les traumatismes récents d’un XXe siècle grevé de guerres mondiales et de totalitarismes politique offrent déjà un bien vaste sujet et sont si documentés qu’ils éclipsent naturellement l’Histoire ancienne…
Breizh-info.com : Si vous deviez convaincre un lecteur néophyte de s’intéresser aux Mérovingiens, quel argument utiliseriez-vous ?
Qui sont ces drôle de barbus chevelus qui se promènent en tunique bleu avec une chlamyde rouge dans nos livres d’Histoire, qu’ont il fait et comment pour occuper le premier tiers du Moyen-Âge? Comment est né la chevalerie, qu’est-il advenu de Romeet d’Attila ? Qui était réellement ce Clovis, le bon roi Dagobert ou même saint Eloi? Passera-t-on à côté du souvenir de grands rois comme Clotaire Ier ou Sigebert Ier? Oubliera-t-on le crapuleux Chilpéric Ier et les exactions de son odieuse concubine Frédégonde? Oubliera-t-on la vie de de Clotaire II ou de Charles Martel? En flânant dans Paris, laisserons-nous dans l’oubli les ossements de Clovis sur la montagne sainte Geneviève et le souvenir vide des souverains inhumés dans saint Germains des Prés? Oubliera-t-on que Childebert fut le premier à bâtir une église en lieu et place de la si belle Notre Dame ? Le vase de Soissons résonnera-t-il encoredans la même détonation tonitruante que le cor de Rolland ? Racontera-t-on demain ces histoires glaçantes, ces récits audacieux, ces aventures miraculeuses, ces destins extraordinairesqui font l’histoire des mérovingiens?
D’ailleurs, outre le récit passionnant de faits abracabrantesques et de revirement historique plus déroutant même que le scénario de Game Of Thrones, la période mérovingienne voit aussi naitre nos institutions, nos villages et notre mythologie! L’étude de ces hommes qui nous ressemble en tout point éclaire notre nature humaine et notre rapport au pouvoir, il questionne le rapport qu’entretient l’humanité avec la territorialité, avec le conflit, avec la quête de développement et de croissance.
En parallèle et comme évoqué plus avant, je souligne encore qu’il est amusant de noter à quel point notre regard sur cette époque mérovingienne est truffée d’idée préconçues et d’affirmations toutes faites souvent bien loin de la réalité (pour ceux qui ont un avis sur la question) ! Mais d’ailleurs, peut-on si simplement généraliser 300 années d’histoire? Il est intriguant d’entendre parfois dire «au Moyen-Âge, les choses étaient ainsi», «durant l’Antiquité, tel se faisait comme ça», car nous parlons de longue temporalité! Il saute assez vite aux yeux que les réalités du monde il y a 100 ans n’ont rien à voir avec celles d’il y a 200 ans ni avec celles d’aujourd’hui, et que rien n’est comparable entre la société de l’ancien régime pré-révolutionnaire et la première guerre mondiale! Alors plongez-vous, diable, dans ces 300 années fascinantes qui éclairent notre passé et ce vaste point d’ombre qui s’étend de Clovis à Charlemagne! Nous parlons d’une époque qui voit naître la France, ni plus ni moins, qui voit débuter le Moyen-Âge et se terminer l’Antiquité, nous assistons à la naissance de la nation française dans son essence première!
Régnant aux temps du fer et des loups, les Merovingiens sont entrés dans l’Histoire avec leurs allures dures et austères, dans leur humanité brutale du crépuscule des dieux. Formidables soldats marchants à mi-chemin entre les Gaulois celtes et les chevaliers chrétiens, plus semblables à des barbares violents qu’à des Gallo-Romains éduqués, les rois chevelus sont surtout devenus un symbole, une image, un mythe. Nos ancêtres, ces héros, ces aïeux légendaires qui font la gloire et le prestige de nos origines sont ces grands guerriers que l’on croyait invincibles, ce sont ces barbares féroces que l’on disait sanguinaires ! Ils sont ces hommes forts des temps anciens, ces fils d’un hiver vengeur qui portaient la couronne avec le charisme des rois et maniaient l’épée avec la bravoure des chefs. Drapés de la pourpre chlamyde autant que de peaux de bêtes, ils ont fait naitre autour d’eux un folklore magnifique, l’image de ces sauvages terrifiants passés rois des contrées. Pileux plus que des ours, hirsutes, barbus et chevelus, ils incarnaient la force brute et loyale de ces temps passés ou les forêts cachaient encore des créatures fantastiques. Côtoyant la romance, de leurs destinées bien réelles, les Merovingiens sont ces hommes antiques qui font la genèse de notre Histoire, eux qui ont vécu dans ce monde où les dieux inflexibles s’abreuvaient du sang des vaincus et dont les nuits de ténèbres voyaient marcher sous la lune des géants et des spectres.
Pourtant, bien au-delà des simples faits d’armes et des légendes antiques, la force et la beauté singulière de l’aventure merovingienne ne résident point dans ses récits de guerres ou même dans l’image que ces ancêtres nous ont laissée, elles résident dans l’ascension de son peuple. La gloire merovingienne qui, jusqu’à la moitié du VIIe siècle, fut sans conteste en Europe, n’est pas née d’un seul homme, ni d’un mythe ou d’une fable, elle est née de rois et de guerriers qui ont su faire les bons choix aux bons moments, qui ont triomphé sur les champs de bataille et qui ont œuvré pour leurs gens. A coups d’épées, de lances, d’alliances ou de traites politiques, les rois mérovingiens, dont la domination se consolida génération après génération, ont ancré les Francs et leur légitimité sur la terre des Celtes, ils ont donné à la Gaule les hommes qui la peuplent encore. Les mérovingiens ont rendu une magnificence aux Francs, ils ont fait de ces guerriers terrifiants des rois, des seigneurs, des savants et des saints, mais plus encore, ils ont fait de ce peuple, a l’origine bien dérisoire, la nouvelle puissance de l’Europe médiévale. De Clodion à la mort de Clotaire Ier (561), les Francs ont su passer de fédérés provinciaux, étendant une vague autorité sur quelques marécages et sur de profondes forêts glaciales, a une situation de maitres de l’Europe ! En un siècle et demi, le peuple Franc est devenu le nouveau phare des civilisations, il a fait de Rome une figure obsolète et s’est taillé un tel Empire, qu’il donnait le vertige aux peuples alentour. Les premiers rois des Francs ont fait vivre une royauté, une religion, une administration, une féodalité, une société qui éclairera le monde pour les siècles à venir. Ils ont fait d’un peuple de grognards crasseux une nation de frères unis derrière ses valeurs et par son sol. Ils ont fait de la France la fille aînée de l’Eglise et, par la même, ont assuré son renom pour toute l’ère médiévale. Ils ont allumé des lumières qui, même pour celles qui disparurent, trouvent encore un écho dans nos siècles modernes. Voilà l’art des Mérovingiens, voilà leur prodige inouï, celui d’avoir construit la base indispensable à la gloire de notre terre, indispensable à Charlemagne, indispensable aux Capétiens, aux Valois, aux Bourbons qui ne furent, chacun à leur façon, que les héritiers d’une splendeur bien plus antique que celle de leur propre famille. Tous les successeurs de la dynastie merovingienne n’ont été, depuis, que les bergers et les protecteurs de ce peuple franc que Clovis a rendu souverain.
Propos recueillis par YV
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine