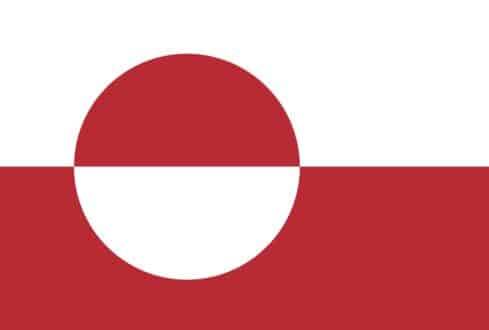De petits traits incisés sur des os de mammouth aux algorithmes qui régissent désormais le moindre pan de notre quotidien, le chemin des chiffres épouse l’aventure humaine. Avec « L’Odyssée des chiffres », série documentaire en trois volets réalisée par Benoît Laborde pour Arte, le téléspectateur embarque dans un périple vertigineux qui traverse 10 000 ans d’histoire, quatre continents et d’innombrables bouleversements politiques, économiques et scientifiques. Une fresque aussi érudite que captivante, où la puissance de l’image sert un récit exigeant : comprendre comment dix symboles indo-arabes ont fini par façonner le monde.
Des cailloux mésopotamiens au zéro indien : aux origines du comptage
Premier choc de la série : la découverte, en plein Kurdistan irakien, de minuscules jetons d’argile datés du IXᵉ millénaire avant notre ère. Bien avant l’écriture, ces galets sculptés permettent déjà aux premiers paysans mésopotamiens de compter gerbes de blé et têtes de bétail. Au-delà de la gestion des greniers, la comptabilité devient un instrument de pouvoir ; les tablettes cunéiformes qui suivront ne seront, à l’origine, que des reçus de stockage.
La caméra plonge ensuite dans l’Inde du Ve siècle où surgit l’idée la plus féconde de toute l’histoire des mathématiques : le zéro. Sans ce « vide » conceptuel, impossible d’écrire les grands nombres ni de jongler avec les valeurs négatives. Transportés à Bagdad au VIIIᵉ siècle, ces chiffres indo-arabes conquièrent le monde musulman grâce au polymathe Al-Khwarizmi ; ils attendront toutefois cinq cents ans et la plume de Léonardo Fibonacci (puis l’imprimerie de Gutenberg) pour supplanter les chiffres romains dans l’Europe chrétienne, méfiante jusqu’à l’obscurantisme : on soupçonnera même le pape Sylvestre II, promoteur de ces symboles « païens », de collusion avec le diable !
Du calcul divin au contrôle social : la dimension politique des nombres
Le second épisode montre combien compter n’est jamais une activité neutre. En Chine antique, les nombres guident d’abord la divination avant d’être réquisitionnés par Qin Shi Huangdi, le premier empereur, pour administrer un territoire gigantesque. Deux mille ans plus tard, la jeune République française impose le mètre et le système décimal : uniformiser les mesures, c’est unifier la nation et affirmer l’autorité de Paris sur les provinces comme sur les colonies. Même logique outre-Atlantique : en 1890, Herman Hollerith déploie ses cartes perforées pour recenser la population américaine. Dès lors, l’État fédéral possède, littéralement, la matrice de chaque citoyen ; IBM n’est plus très loin.
À travers ces exemples, « L’Odyssée des chiffres » renverse le cliché du nombre pur. Le documentaire rappelle qu’il s’agit d’un outil de domination autant que de connaissance : du relevé cadastral pharaonique aux indicateurs macroéconomiques contemporains, compter, c’est organiser, taxer, classer – bref, gouverner.
Pascaline, supercalculateurs et intelligence artificielle : la fuite en avant
Le troisième épisode, sans doute le plus vertigineux, relie la pascaline de 1652 – première machine à additionner sans effort humain – aux data centers capables aujourd’hui d’ingurgiter des milliards de données par seconde. On y voit la salle d’un ancien bunker de l’armée américaine où tournaient, pendant la Guerre froide, les premiers ordinateurs à vocation militaire. Les ingénieurs interrogés évoquent la filiation directe entre la carte perforée de Hollerith, le code binaire de Turing et les puces actuelles, gravées à l’échelle nanométrique.
Là encore, la série refuse toute complaisance : l’essor exponentiel du calcul nourrit autant d’espérances que d’angoisses. L’intelligence artificielle, prévient l’historienne des sciences Judith Maltese, poursuit la logique de délégation entamée au XVIIᵉ siècle : « Nous confions aux chiffres non seulement de décrire le réel, mais de le décider à notre place. » Dès lors, ces symboles seraient-ils devenus nos nouveaux dieux ? La question, posée en filigrane, traverse le documentaire sans jamais verser dans la technophobie.
Visuellement, « L’Odyssée des chiffres » mixe prises de vue grand-spectacle – temples mayas, grottes préhistoriques, ruelles de Venise où s’imprimèrent les premiers manuels de comptabilité – et animations didactiques élégantes. Les personnes interviewées, de l’archéologue irakien fouillant les collines de Ziwi-Chemi-Shanidar au mathématicien indien Manjul Bhargava, livrent des analyses accessibles sans sacrifier la rigueur.
La narration évite les listes d’inventions pour privilégier le fil rouge de la puissance : chaque saut arithmétique répond à un besoin politique ou commercial, chaque révolution numérique redistribue les rapports de force. Le spectateur ressort convaincu que les « petits symboles au pouvoir infini » ne sont jamais de simples outils ; ils orientent nos sociétés, sculptent nos imaginaires et – peut-être – préfigurent l’ère où la machine détiendra la suprématie de la décision.
Pour quiconque s’intéresse à l’histoire, à la science ou simplement au destin des civilisations, « L’Odyssée des chiffres » constitue une leçon magistrale – et un rappel salutaire : compter, c’est exister ; savoir pourquoi l’on compte, c’est rester libre.
« L’Odyssée des chiffres », documentaire en trois parties (3 × 52 min), réalisé par Benoît Laborde. Diffusion sur Arte et arte.tv.
Crédit photos : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine