Parler de souveraineté numérique, d’autonomie stratégique ou de sécurité des infrastructures critiques, c’est, en 2025, parler des câbles sous-marins. Discrets, vulnérables et vitaux, ces cordons de verre et de cuivre qui serpentent sous les océans transportent 99 % des communications numériques mondiales. Sans eux, internet s’éteint, les marchés financiers gèlent, la diplomatie est paralysée. Ce ne sont pas des tuyaux : ce sont des artères. Leur interruption serait l’équivalent cyber du sabotage d’un oléoduc à haute pression.
Longtemps négligée, leur protection s’impose désormais comme une priorité stratégique. Le sabotage de plusieurs câbles en mer Baltique à l’automne 2024 a agi comme un électrochoc. Bien que les enquêtes officielles évoquent des causes accidentelles, glissements de terrain sous-marins, collisions avec des ancres, nul expert sérieux n’ignore la dimension hybride de ces attaques probables. Couper un câble, ce n’est pas déclencher une guerre, c’est envoyer un signal. C’est opérer dans cette zone grise que les stratèges russes appellent « non-linéaire » et que les analystes de l’OTAN ont fini par qualifier d’undersea grey warfare.
Les câbles sous-marins sont vulnérables. Ils ne sont ni enterrés ni protégés sur la majorité de leur tracé. Leur position est connue, cartographiée, consultable. En haute mer, ils n’appartiennent à personne, ne relèvent d’aucune souveraineté, et tombent dans une zone de droit incertain. Les points d’atterrissement, en revanche, sont critiques : Marseille, Brest, Bilbao, Alexandrie, Singapour. Là, ils peuvent être sabotés physiquement, ou infiltrés électroniquement. L’Agence nationale de sécurité américaine (NSA), comme l’ont montré les révélations d’Edward Snowden, pratique une surveillance active des câbles, à l’aide de dispositifs spécialisés capables de capter les signaux optiques sans perturber le flux.
La capacité de nuisance est asymétrique. Un seul navire câblier sous pavillon étranger, opéré par une société écran, peut interrompre, en quelques heures, un segment clé du réseau mondial. Or, les moyens de surveillance et de réaction sont gravement sous-dimensionnés. L’Europe, continent de la donnée et de la régulation, est paradoxalement incapable de défendre l’infrastructure qui la connecte au monde. À ce jour, seule une trentaine de navires câbliers existent sur le globe, dont à peine une poignée en Europe. Les délais d’intervention, même pour des pannes accidentelles, peuvent atteindre plusieurs semaines.
C’est ici que la France entre en scène. Elle possède, sans publicité excessive, la plus grande zone économique exclusive (ZEE) du monde, s’étendant sur trois océans. Elle abrite Alcatel Submarine Networks, basé à Calais, qui détient près de la moitié du marché mondial de la pose de câbles. Elle dispose d’une flotte moderne opérée par Orange Marine, et d’un savoir-faire industriel rare dans les technologies de détection, de réparation et de protection sous-marines. En matière de souveraineté numérique, la France a les moyens d’agir et le devoir de proposer.Ce potentiel ne doit plus être cantonné à la logique hexagonale. Il est temps de penser en termes d’intervention européenne coordonnée, dotée de capacités permanentes de surveillance, de maintenance et, si nécessaire, d’action dissuasive. Cette force ne saurait être purement civile : les enjeux de sécurité exigent un appui militaire, notamment via la Marine et ses homologues européennes. Un corps mixte de protection des infrastructures sous-marines, à l’image des task forces navales de l’OTAN, pourrait être créé sous mandat européen ou par coalition d’États volontaires.
Les initiatives actuelles restent dispersées. L’opération annoncée par l’OTAN est un premier pas, mais elle demeure limitée géographiquement et politiquement. De même, les réglementations européennes sur les infrastructures critiques, bien qu’utiles, sont encore inopérantes face à des acteurs étatiques hostiles. L’Union européenne doit aller plus loin : adopter un plan câblier stratégique, financé et coordonné, prévoyant la redondance des routes, la protection renforcée des points d’atterrissement, la formation d’équipes spécialisées et l’investissement dans la robotique sous-marine autonome.
Les câbles sous-marins sont au XXIe siècle ce que les voies ferrées furent au XIXe : des vecteurs de puissance, de commerce, de contrôle. Les protéger, c’est défendre non seulement la connectivité, mais l’indépendance. Laisser ce réseau aux seules mains du privé, ou à la merci d’acteurs extérieurs, reviendrait à répéter les erreurs du passé : sous-estimer l’infrastructure parce qu’elle est invisible.
Le temps presse. Une nouvelle géopolitique des abysses s’esquisse. Il appartient à l’Europe de s’y préparer, ou d’y sombrer.
Trystan Mordrel
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine











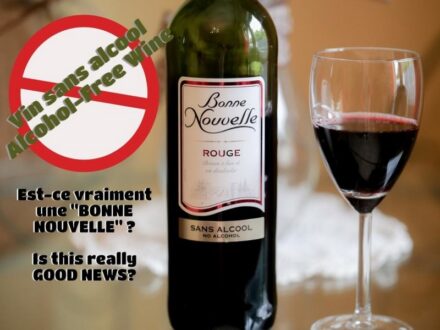


3 réponses à “Câbles sous-marins : la guerre invisible des profondeurs”
Bonjour,
Je veux bien que l’europe et l’otan s’y intéressent, lorsque nous aurons récupéré un peu de souveraineté.
Cdt.
M.D
bonjour,
Pas bien compris ici:
une trentaine de navires câbliers existent sur le globe, dont à peine une POIGNEE en Europe
Alcatel Submarine Networks, basé à Calais, qui détient près de la MOITIE du marché mondial de la pose de câbles.
L’occident a déclaré la guerre aux pays des BRICS et si la Russie tête de file des BRICS qui a désormais refusé le dollars avec toute l’association il ne fallait pas commencer la guerre via l’Ukraine contre la Russie et ses alliés dont la Chine. Puissance des 5/6ème de l’humanité que si ils voulaient, mettraient à mal l’Europe et tout l’occident très très mal placé pour la suprématie qu’il veut conserver avec 1 million de fois trop de dettes. Les cables sous marins sont des proies faciles comme les gazoduc Nord Stream. Si l’occident va trop loin à vouloir à la fois, le pétrole de la mer Caspienne, attaquer l’Iran, démembrer la Russie et attaquer la Chine bien sûr il y aura une rétorsion cinglante qui fera et fait effet boomerang. Le mieux c’est la paix et les négociations.