Le 15 août, en plein cœur de l’été, alors que les moissons touchent à leur apogée et que la lumière dore encore les côtes bretonnes, les cloches de nombreuses églises résonnent pour célébrer l’Assomption de la Vierge Marie. Jour férié en France, cette fête n’est pas seulement une solennité liturgique : elle est un repère culturel, un symbole d’espérance et un héritage qui lie, depuis des siècles, foi chrétienne et identité populaire. En Bretagne, elle s’enracine dans les pardons, les processions et la dévotion mariale, fusionnant traditions celtiques et spiritualité catholique.
Aux sources d’un mystère de foi
L’Assomption — du latin assumere, « prendre avec soi » — désigne l’élévation au ciel de Marie, corps et âme, à la fin de sa vie terrestre. Contrairement à l’Ascension du Christ, qui est clairement rapportée dans les Évangiles, l’Assomption n’apparaît pas dans les textes bibliques canoniques. Ses origines plongent dans les traditions orales et les écrits apocryphes, comme le Transitus Mariae (IIe-Ve siècle), qui racontent la « dormition » de la Mère de Dieu : un sommeil paisible suivi de son enlèvement au ciel par les anges.
Dès les premiers siècles, cette croyance s’enracine dans l’Église. Le récit rapporté par saint Jean de Damas au VIIIe siècle évoque l’empereur Marcien demandant le corps de Marie lors du concile de Chalcédoine en 451 : on lui répondit qu’il avait été emporté au ciel, laissant un tombeau vide. Ces traditions, bien qu’absentes de la Bible, expriment une intuition théologique : celle d’une femme préservée de la corruption du tombeau, figure de l’humanité rachetée.
Sur le plan liturgique, la fête naît à Jérusalem au Ve siècle, lorsque l’évêque Juvénal consacre une église à Gethsémani en l’honneur de Marie. Peu à peu, la date du 15 août s’impose, notamment sous l’empereur byzantin Maurice (582-602) qui généralise sa célébration à tout l’Empire. En Orient, on parle encore de la « Dormition », mais la conviction est la même : Marie partage dès maintenant la gloire de son Fils ressuscité.
De Jérusalem à Rome : la lente universalisation de la fête
Introduite à Rome au VIIe siècle par le pape Théodore, originaire de Constantinople, la fête gagne l’Occident sous le nom de Dormitio Sanctae Mariae ou Assumptio Beatae Mariae Virginis. Dès le Moyen Âge, elle devient l’une des principales solennités chrétiennes, mêlant processions, bénédictions des récoltes et traditions locales. Le Concile de Mayence, en 813, l’inscrit officiellement au calendrier liturgique occidental.
Les siècles suivants voient se développer un riche corpus artistique : fresques, vitraux et polyphonies illustrent la Vierge élevée au ciel, couronnée reine. Les débats théologiques sur l’Immaculée Conception, de saint Thomas d’Aquin à Duns Scot, préparent le terrain au dogme.
Il faut cependant attendre le XXe siècle pour que l’Assomption soit proclamée vérité de foi par l’Église catholique : le 1er novembre 1950, le pape Pie XII définit solennellement que « Marie, l’Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste ». Cette proclamation ne crée pas une croyance nouvelle : elle entérine une tradition ancienne et universelle.
L’Assomption, un ciment spirituel pour l’Europe
Dans l’Europe chrétienne, l’Assomption s’est imposée comme un rendez-vous spirituel majeur. Jour férié dans la plupart des pays catholiques (France, Italie, Espagne, Belgique, Portugal, Pologne…), elle symbolise la victoire de la vie sur la mort et l’espérance d’une résurrection future. Partout, elle donne lieu à des manifestations populaires : processions de Palerme à Assise, représentations théâtrales à Elche en Espagne, pèlerinages à Częstochowa en Pologne.
En Orient orthodoxe, la Dormition est précédée d’un jeûne et entourée de rites liturgiques anciens, montrant que, malgré les divisions ecclésiales, la figure de Marie demeure un lien oecuménique puissant.
Au-delà de l’aspect religieux, cette fête s’inscrit dans la culture populaire : marchés, festivals d’été, bénédictions d’herbes médicinales, comme pour signifier que la foi irrigue aussi la vie quotidienne. Dans un contexte européen marqué par la sécularisation, elle reste, selon les mots de Jean-Paul II, un « signe d’espérance pour l’humanité ».
En France, l’Assomption prend une dimension particulière depuis 1638. Cette année-là, le roi Louis XIII, inquiet de ne pas avoir d’héritier, consacre solennellement le royaume à la Vierge Marie. Il ordonne que chaque 15 août, une procession solennelle soit organisée dans toutes les paroisses pour implorer la protection de la Reine du Ciel sur la France. Un an plus tard, naît le futur Louis XIV.
Ce vœu royal, inscrit dans la mémoire nationale, confère au 15 août un double statut : fête religieuse et symbole de l’unité du royaume sous le patronage de Marie. Aujourd’hui encore, cette date reste un moment privilégié pour prier pour la France, comme le rappellent les célébrations à Lourdes, Paris ou Rocamadour.
En Bretagne, l’Assomption au cœur des pardons et de l’identité régionale
En Bretagne, la fête du 15 août dépasse largement le cadre liturgique : elle est un temps de rassemblement communautaire où foi et identité se mêlent intimement. Les pardons, pèlerinages traditionnels mêlant processions, prières, musique et convivialité, sont le cœur battant de cette journée.
À Sainte-Anne-d’Auray, sanctuaire majeur, des milliers de pèlerins se pressent pour les messes, le chapelet et la procession eucharistique. Ici, la dévotion mariale s’unit à celle de sainte Anne, grand-mère du Christ, apparue en 1624 à Yvon Nicolazic, le paysan. À Notre-Dame de Rumengol, dans le Finistère, le pardon du 15 août est l’un des plus anciens : il attire marins, paysans et familles entières, venus honorer celle qu’on appelle « Reine de Bretagne ». À Perros-Guirec, le pardon de La Clarté voit encore se dérouler une procession immémoriale sur le tertre.
Dans les ports, comme à Saint-Malo ou Concarneau, la fête prend des accents maritimes : bénédiction des bateaux, gerbes jetées à la mer pour les marins disparus, invocation à Marie « Étoile de la Mer » pour protéger ceux qui affrontent les flots. Ces manifestations populaires, mêlant rites anciens et ferveur chrétienne, perpétuent une mémoire où la Vierge Marie est à la fois figure spirituelle et symbole protecteur des communautés.
Dans une société où la pratique religieuse décline, l’Assomption continue d’attirer, parfois pour des raisons plus culturelles que confessionnelles. Pour certains, c’est l’occasion de renouer avec les racines familiales et régionales ; pour d’autres, un moment de silence et de réflexion au cœur de l’été.
En Bretagne comme ailleurs, elle demeure un espace de résistance à l’effacement des repères : un rappel que l’identité n’est pas seulement affaire de langue ou de territoire, mais aussi de traditions spirituelles transmises de génération en génération. Le 15 août, qu’on soit croyant ou simple héritier de cette mémoire, la cloche qui sonne rappelle que le passé n’est pas mort : il continue d’inspirer l’avenir.
YV
Crédit photo : Image réalisée par l’IA
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine








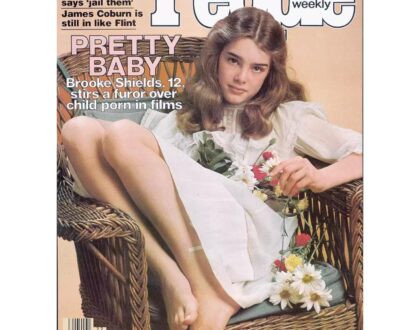
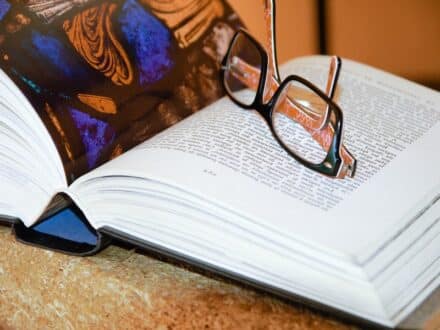

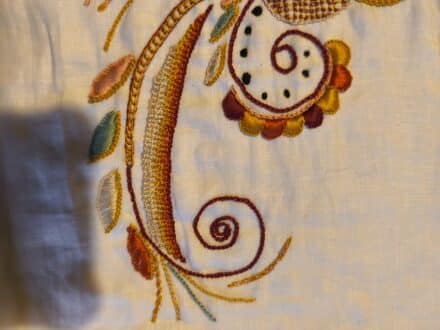
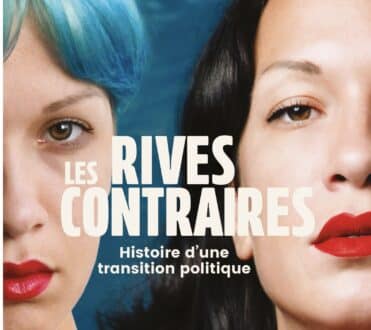

8 réponses à “Assomption du 15 août : de la Dormition de Marie aux pardons bretons, un héritage spirituel et identitaire millénaire”
les pires marxistes anti-France se trouvent en Bretagne, c’est curieux pour une région qui se prétend conservatrice et catholique
Merci Monsieur Vallerie pour la qualité de votre article !
Je plussoie vos propos, même si je ne peux pourtant qu’approuver le commentaire de François Blanc ayant moi-même tant d’exemples dans ma propre famille à travers toute la Bretagne …
Je n’arrive d’ailleurs toujours pas à comprendre cette incohérence spirituelle à l’instar des cathos de La Croix ou de l’ex-nouvelle Présidente des Scouts et Guides de France…
Peut-être serions-nous bien avisés alors de prier pour que « les simples héritiers de cette mémoire » deviennent des croyants cohérents i.e. avec Corps-Coeur-Esprit bien alignés ?
L’ASSOMPTION
Oh toi, MARIE, Mère et Femme bénie
Qui t’élève en ce jour jusqu’aux cieux
Soit pour nous ambassadrice
Auprès de Dieu et de ton Fils
Intercède pour nous pauvres pêcheurs
Veille sur notre Âme d’égarés
Nous, pauvres Hommes, emplis de faiblesse
T’en prions avec ferveur, AMEN !
Jean-Yves Gabard
Un peu saoulantes les affirmations gratuites assénées à l’emporte pièce…Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César »!
Plutôt que de Sainte-Anne d’Auray, il eut été bon de parler d’abord du sanctuaire de Notre-Dame de Toute-Aide en Querrien, à La Prénessaye, seul sanctuaire marial où une apparition de la Vierge Marie est reconnue officiellement par l’Eglise en Bretagne.
D’autres apparitions mariales en Bretagne, mais non reconnues officiellement, bien vivantes dans la mémoire de notre peuple : celles auprès de Marie-Amice Picard, Catherine Danielou, Marie-Julie Jahenny etc., à Kerizinen, Le Guiaudet en Lanrivain, Notre-Dame de Carmes à Lescouët-Gouarec…
Revenons à notre Culture Celtique au lieu de se laisser infliger les élucubrations de uns et des autres d’ailleurs il aura fallu ripoliner les machins du Moyen Orient pour qu’ils soient acceptés et ceux qui contestaient c’était le bûcher! Sainte religion d’Amour que voilà! Ah on est loin de l’Ancien Testament! Aucun rapport entre les deux!
Oui les pires gauchistes de France sont en Bretagne et particulierement a Rennes, ceci depuis 2 generations. Ils sont prets a tout detruire. Ils sont passe du catholicisme fervent de leur grand-parents au marxisme tendance planetaire trotsky.
L’avenement de Jean Marie Le Pen n’a pas aide, le leader a droite est breton. Il avait une rancune tenace contre l eglise catholique (source sa biographie en enfance). Il a ete se battre pour l Algerie francaise. Il a toujours ete contre la promotion de la langue bretonne. Contre l’essor d’une region Bretagne.
« Vierge Bénie entre toutes les femmes
Mère Bénie entre toutes les mères »
Très beau cantique marial en ce jour de dévotion qui est la véritable Fête Nationale de la France et non l’affreux 14 Juillet, commémoration du massacre d’une garnison de vieux soldats qui avaient combattu toute leur vie pour la France (la Bastille, n’a jamais été prise, elle avait ouvert ses portes et s’était rendue !!!).