Condamnée à 31 mois de prison pour un simple message publié sur X (ex-Twitter), la Britannique Lucy Connolly vient d’être libérée. À 42 ans, cette mère de famille dénonce aujourd’hui une détention politique orchestrée, selon elle, par le gouvernement travailliste de Keir Starmer. Elle annonce vouloir poursuivre la police britannique en justice et affirme être entrée en contact avec l’administration Trump aux États-Unis.
Do you support Lucy Connolly? pic.twitter.com/s0H9KW5RBg
— Make Britain Great Again (@UK_Needs_Reform) August 24, 2025
Une mère de famille transformée en « exemple »
Lucy Connolly avait été incarcérée pour avoir rédigé un message après les meurtres d’enfants commis à Southport. Non violente, sans antécédent judiciaire et sans risque de fuite, elle a pourtant été privée de liberté dès l’instruction. « J’étais désignée pour servir d’exemple », explique-t-elle aujourd’hui, se décrivant comme « la prisonnière politique de Starmer ».
Elle raconte avoir été poussée à plaider coupable par son avocat, sous peine de risquer « cinq à sept ans » derrière les barreaux. On lui aurait fait miroiter une libération rapide sous bracelet électronique. En réalité, le juge a prononcé une lourde peine, qui selon elle reprenait « mot pour mot le discours de Starmer ».
Conditions de détention humiliantes
Connolly décrit une incarcération marquée par des restrictions inhabituelles : refus de permissions de sortie, rejet de sa demande de libération anticipée et, à plusieurs reprises, violences physiques de la part de surveillants. « Ils peuvent vraiment vous faire mal s’ils le décident », a-t-elle confié, affirmant avoir été brutalisée alors qu’elle criait à l’aide.
Elle assure que les directeurs de prison subissaient des pressions venues « d’en haut » pour lui compliquer la vie, confirmant son sentiment d’avoir été traitée comme une détenue politique.
Désormais libre, Lucy Connolly entend passer à l’offensive. Elle affirme préparer, avec ses avocats, une plainte contre la police pour avoir diffusé de fausses informations la concernant, faussant ainsi le procès.
Parallèlement, elle a annoncé qu’elle rencontrera cette semaine un haut représentant de l’administration Trump, qui s’est déjà dite préoccupée par l’état de la liberté d’expression en Europe et au Royaume-Uni en particulier.
Une affaire symptomatique des dérives britanniques
Le cas Connolly a provoqué une onde de choc outre-Manche. Le mouvement de Nigel Farage, Reform UK, propose même de créer une « Lucy’s Law », une loi qui permettrait aux citoyens de contester une décision judiciaire jugée manifestement injuste.
La Free Speech Union (FSU), qui l’a soutenue, rappelle qu’au Royaume-Uni, jusqu’à 30 personnes par jour sont arrêtées pour des messages en ligne jugés offensants, qu’il s’agisse de retweets ou de caricatures. Pour son fondateur, Lord Young, « Lucy est l’illustration la plus claire du naufrage de la liberté d’expression en Grande-Bretagne ».
De son côté, Connolly dit avoir définitivement perdu foi dans les institutions : « On nous a toujours appris que la police est là pour nous aider. J’ai découvert qu’elle pouvait aussi vous piéger ». Quant aux médias, qui l’ont qualifiée de raciste, elle affirme : « Je ne leur pardonnerai jamais. On m’a condamnée pour “désinformation” alors qu’eux en diffusaient sans vergogne ».
Pour elle, la responsabilité du Premier ministre est directe : « Starmer est juriste, il connaît les droits de l’homme. S’il s’en souciait vraiment, il investirait dans le logement, la santé mentale et la réinsertion, pas dans l’emprisonnement de citoyens pour des tweets ».
L’histoire de Lucy Connolly, désormais largement relayée à l’étranger, devient un symbole international des atteintes à la liberté d’expression en Europe. Du 10 Downing Street à la Maison-Blanche, en passant par la Free Speech Union, son cas soulève une question explosive : jusqu’où les démocraties occidentales peuvent-elles aller dans la criminalisation de la parole ?
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine










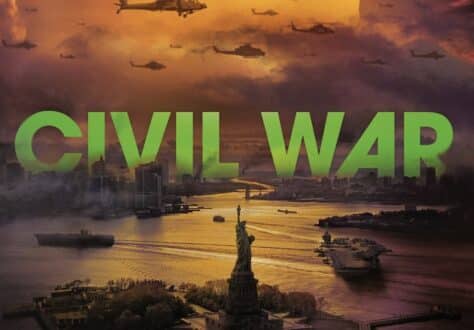



10 réponses à “Royaume-Uni : Lucy Connolly, « prisonnière politique », libérée et décidée à poursuivre la police”
cette perfide Albion, une vraie pourriture tant dans sa politique intérieure, que dans celle de sa politique étrangère
son enragement dans sa politique communautaire, lui fait sacrifier volontairement sa population autochtone
Il y a quelques annees un juge anglais a condamne une personne qui avait simplement recopie une citation d une livre de W. Churchill – datant de 1912.
En France on a aussi le cas si on cite les ecrits de Peyrefitte « C etait de Gaulle. »
Les 2 sauveurs France/UK sont celebres comme les 2 grands hommes du 20ieme siecle et condamnable quand on cite leurs paroles.
Effectivement, je confirme. J’ai été censuré sur Facebook alors que j’avais simplement cité une phrase de Charles de Gaulle !
@petitjean – C’est pareil en France, non ? Le français n’a qu’un droit : celui de se taire !
Ce qui me frappe c’est le « travail » opéré aujourd’hui sans vergogne, avec une violence préméditée, orchestrée par « des forces de l’ordre » couvertes par les plus hautes autorités des États européens, sans qu’une réaction massive, énergique, de type militaire… des populations autochtones visées ne soit observée.
Jusqu’à quand ces populations autochtones d’Europe, France comprise naturellement, accepteront-elles de se laisser tondre gratis, de subir sans broncher les opérations dévoyées de ces forces mises en œuvre pour verrouiller la liberté, comme jadis en Union soviétique ou aujourd’hui en Chine communiste ?
La libertés d’expressions est de plus en plus restreinte en Europe , cela quelque soit le pays; en Allemagne c’est haro sur l’afd, en Angleterre et en France c’est sur les citoyens citoyennes que l’état s’acharne a les faire taire ; en France sous la Mite errante , ceux celles qui en savait trop, parlait trop, ou déplaisait ont fini dans une boite.
Le mot Liberté ne veux plus rien dire dans ce pays ou si on n’est pas d’accords avec les partis de gauche ,on est tout de suite désigné comme ennemi a éliminé.
« son cas soulève une question explosive : jusqu’où les démocraties occidentales peuvent-elles aller dans la criminalisation de la parole ? » Si dans votre phrase vous remplacez simplement le mot démocraties par dictatures, vous aurez la réponse à votre question.
» au Royaume Uni, 30 personnes par jour sont arrêtées pour des messages jugés offensants » Inutile de pointer du doigt « la perfide Albion » : la sinistre réalité se dévoile sous nos yeux ; la bête immonde est là et bien là. Et ce n’est pas celle que les caricaturistes de la politique griment en « extrême-droite ». C’est la censure, vampire assoiffé de votre sang et de vos libertés qui entend bien ne plus vous laisser ni l’un ni les autres
Sur ce sujet, voir l’édifiante déclaration de Vladimir Boukovsky, dissident soviétique (du temps de l’URSS) réfugié aux Etats-Unis qui décrit la dérive politique européenne qui conduit peu à peu nos peuples au même régime qu’il a connu autrefois ; dérive qu’il décrit et critique dans cette vidéo « J’ai vécu dans votre futur et ça n’a pas marché » disponible sur YT
Bien entendu que cette UERSS est liberticide et corrompue jusqu’à l’os, profitant de son pouvoir pour faire les poches des peuples; et détournant des Milliards (voir sur le site Money-Radar)comme pendant le Covid par Von Der Lyen