Installé au bar des Brisants à Lechiagat, regard tourné vers le Guilvinec, j’ai ouvert le Financial Times. Dans ses colonnes, Paul Caruana Galizia et ses confrères s’affligent du fait que « les Noirs américains sont plus de deux fois plus susceptibles d’être refusés pour un prêt immobilier que leurs homologues blancs déclarant les mêmes revenus ». Tout y est, le rappel du Home Mortgage Disclosure Act de 1975, la dénonciation du « redlining » naguère pratiqué, les statistiques sophistiquées et l’invocation des militants associatifs.
Le « redlining » fut une pratique typiquement américaine des années 1930 à 1960, consistant pour les banques à tracer en rouge, sur leurs cartes, certains quartiers entiers jugés risqués car habités majoritairement par des Noirs. Ces zones, ainsi marquées, étaient privées d’accès au crédit hypothécaire, ce qui entretenait un cercle vicieux : absence d’investissements, délabrement urbain, paupérisation accrue. Le Congrès mit un terme officiel à cette pratique par une législation contraignante, mais elle est restée dans la mémoire collective comme l’archétype de la discrimination bancaire.
Pourtant, à mesure que l’on avance dans la lecture, un malaise s’installe. Le FT a passé au crible près de quarante millions de demandes de prêts, il a mobilisé ses modèles, mais pas une seule fois ne s’interroge sur les causes profondes de ce phénomène. Pourquoi les institutions financières, dont la survie repose sur l’évaluation rationnelle du risque, prendraient-elles le luxe d’écarter des clients solvables ? Pourquoi ce « désamour » persistant ? Ici le silence devient assourdissant. Rien sur le rapport aux dettes, rien sur la stabilité des emplois, rien sur la criminalité, rien sur les comportements de consommation. Comme si toute explication devait être tenue pour suspecte, sauf celle qui incrimine un « racisme systémique ».
Or les chiffres sont connus et n’ont rien de clandestin. Aux États-Unis, les taux de criminalité sont très inégalement répartis selon les communautés. Le Bureau of Justice Statistics relève que les Noirs, qui représentent environ 13 % de la population, comptent pour plus de la moitié des auteurs d’homicides recensés. Le taux d’incarcération est près de cinq fois supérieur à celui des Blancs.
En matière scolaire, les écarts sont tout aussi manifestes. Les Américains mesurent les acquis scolaires à travers des « tests standardisés », équivalents de nos concours mais généralisés, où chaque élève, qu’il soit du Bronx ou de Californie, doit répondre aux mêmes épreuves de mathématiques ou de lecture. Ces tests, tels que le SAT ou l’ACT pour l’entrée à l’université, permettent de comparer objectivement les performances entre États, établissements et communautés. Or, depuis des décennies, les résultats moyens des Afro-Américains s’y situent en dessous de ceux des Blancs et nettement derrière ceux des Asiatiques de l’Est (Japonais et Chinois), dont les scores dépassent régulièrement la moyenne nationale.
Cela n’explique pas tout, bien sûr, mais il est difficile de croire que ces réalités n’entrent jamais en ligne de compte lorsqu’une banque mesure, même indirectement, la fiabilité d’un emprunteur.
L’article concède à peine que les scores de crédit des Noirs sont en moyenne « quarante points plus bas » que ceux des Blancs. Pour un lecteur européen, il faut préciser que ce « crédit score » est une note chiffrée, généralement comprise entre 300 et 850, attribuée à chaque individu en fonction de son comportement financier. Sont pris en compte l’historique des remboursements, le poids des dettes en cours, la diversité des crédits contractés ou encore la durée d’existence des comptes bancaires. Aux États-Unis, ce score est décisif : il conditionne non seulement l’accès à un prêt immobilier, mais aussi à une carte de crédit, à un logement, voire à certains emplois.
Or, selon les études, les Afro-Américains disposent en moyenne de dossiers plus courts, dits « thin files ». Dans le langage bancaire américain, cela désigne un historique de crédit trop mince, constitué de peu de lignes et de peu d’années de données. En clair, l’individu a contracté peu d’emprunts, utilisé peu de cartes bancaires, ou bien n’a pas assez longtemps démontré sa capacité de remboursement. Ce manque d’antériorité le rend difficile à évaluer pour les agences de notation et pénalise sa note globale.
Ainsi, deux personnes disposant du même revenu annuel peuvent être jugées très différemment selon l’épaisseur de leur dossier. Celui qui a, pendant dix ans, contracté un prêt automobile et remboursé ponctuellement ses cartes de crédit aura un score élevé, quand celui qui n’a aucune trace antérieure dans le système bancaire, ou au contraire quelques incidents de paiement, sera considéré comme plus risqué. Les « thin files » ne sont donc pas seulement un chiffre abstrait, ils traduisent un rapport au crédit, à l’épargne et à la régularité des paiements.
Le Financial Times mentionne bien cet écart d’une quarantaine de points du credit score, mais il préfère aussitôt l’expliquer par la « ségrégation historique » et par l’implantation de banques de quartier qui auraient, par le passé, moins souvent enregistré les paiements positifs de leurs clients. Là encore, la causalité est orientée d’avance, comme si la moindre différence devait forcément être la trace d’une faute structurelle.
On mesure à ce contraste combien le progressisme contemporain est devenu dogmatique. Spengler, déjà, voyait dans l’économie moderne une grande bataille de discipline et de rationalité. Le crédit, écrivait-il, est une forme de confiance, et la confiance est elle-même le produit d’habitudes, de mœurs, de réputation. Que certaines communautés aient plus de mal à l’obtenir ne relève pas nécessairement de l’injustice, mais d’une logique sociale que l’on ne veut plus regarder en face.
Cette cécité volontaire n’est pas propre aux États-Unis. L’Europe pratique une censure analogue, sous d’autres formes. Dans les faits divers, combien de fois lit-on des dépêches anonymisées, où le prénom du suspect est soigneusement dissimulé pour ne pas suggérer son origine ethnique ? Dans les campagnes officielles, les images deviennent des fables. Pour illustrer le harcèlement de rue, on nous montre des blonds aux yeux bleus siffler des passantes dans le métro parisien. Chacun sait que cela relève de la fantaisie woke et non de l’observation empirique. Ici comme là-bas, le réel, lorsqu’il contrarie l’idéologie, doit être repeint aux couleurs de l’égalitarisme.
En sortant du bar je me suis dirigé vers la longue jetée du port de Lechiagat, le vent d’ouest s’était levé, soulevant une houle courte. Je songeais en marchant le long de l’espace réservé à la réparation des bateaux, que l’article du Financial Times est emblématique de ce siècle : il ne constate pas, il moralise ; il ne questionne pas, il assène. Et comme l’écrivait Carl Schmitt, le politique commence toujours par désigner un ennemi. Ici, l’ennemi n’est pas le risque financier, mais la réalité elle-même. Alors on l’exorcise par des chiffres redressés, des slogans moralisants et des récits édulcorés. Quand les faits résistent, il ne reste qu’à les nier.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées
Crédit photo : Photo générée par l’IA
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine







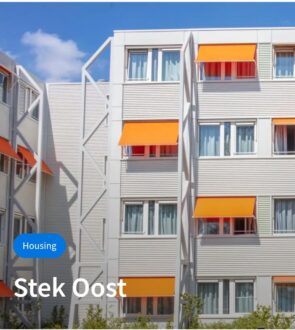

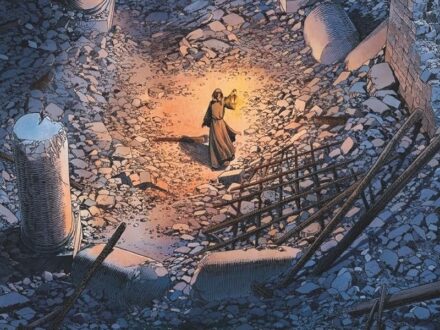




3 réponses à “Banques, races et fictions progressistes”
Pour parodier Laurent Gerra flagornant Jack Lang dans un sketch: « Quel bel homme » que ce Balbino, et intelligent en plus pratiquant plusieurs langues.
Cependant, pour avoir passé une semaine à Lechiagat il y a quelques années (avec une copine, 1ere entorse à mon statut de veuf !) je n’arrive pas à situer le bistrot où « sévi » Maître Balbino, au voisinage de l’esplanade des ateliers de réparations des bateaux de pêche avec portique et tout le bazar.
Va falloir que je me relocalise sur Google Map.
Il est diabolique ce Balbino, impossible de le localiser au Bar des Brisants, un beau bar avec 2 terrasses, au voisinage du bar-PMU-Tabac de la Pointe à la façade rouge.
Il est en bordure immédiate de la patouille, au loin on aperçoit une église sans doute de Lechiagat.
L’état des lieux du bar des Brisants n’a pas changé entre 2013 et 2023, et tant mieux car il n’y a rien à changer à ce coin privilégié.
Je suis largué, et pourtant Google Maps est d’une netteté et d’une précision diabolique.
Toujours la même chose. Pour des raisons idéologiques, un égalitarisme dévoyé, la « bien Pensance » nie le réel et invente des causes telles le racisme systémique, la discrimination voire la condition sociale comme si la pauvreté était une excuse à la médiocrité voire à la délinquance « parole d’ancien pauvre et pourtant travailleur et bien éduqué ».
J’admets volontiers que les Asiatiques aient un QI supérieur aux Blancs dès lors que les résultats PISA entre autres en apportent la preuve et je ne veux pas bénéficier de la « discrimination positive » qui n’est rien d’autre qu’une tricherie.
« Chassez le réel, il revient au galop ».