Je lisais ces pages ce matin sur l’écran de mon ordinateur, attablé au bar des Brisants, à la Pointe de Léchiagat, à deux pas du slipway où l’on hisse les chalutiers hors de l’eau. Le bruit du métal sur le bois, les cris des goélands et l’odeur d’iode accompagnaient ma lecture. Devant moi, ce n’étaient pas les nouvelles locales ni les comptes rendus de criée, mais quatre pleines pages du Times de Londres, achetées au prix fort par la République populaire de Chine. Non pas une publicité pour une banque ou un promoteur, mais un long plaidoyer de droit international consacré aux procès de Tokyo. Une étrangeté qui, déjà, mérite attention.
Le texte signé par le professeur Guan Jianqiang, présenté comme un érudit renommé, se voulait une clarification : les procès de Tokyo ne furent pas des simulacres, mais une étape légitime, nécessaire, dans la fondation du droit international moderne. Le Japon avait capitulé sans conditions, perdant toute souveraineté, et devait répondre de ses crimes. À lire ces colonnes, tout soupçon de « justice des vainqueurs » se dissipe : l’agression, les massacres, les atrocités contre les populations civiles, tout cela relevait déjà des normes en vigueur.
On devine cependant que la cible n’est pas seulement académique. Le Japon contemporain, celui qui cherche à réviser sa constitution pacifiste, celui qui regarde vers Washington pour s’armer contre Pékin, est désigné comme l’héritier suspect d’un passé jamais soldé. Et le professeur chinois d’ajouter que les propos d’Abe Shinzō, relativisant la capitulation, ne sont que le symptôme d’un révisionnisme latent.
Quatre pages d’un grand quotidien britannique : le coût se chiffre en dizaines de milliers de livres. Il n’y a rien d’anodin dans ce geste. Cela rappelle un précédent fameux : en 1987, Donald Trump, alors magnat immobilier à l’ego bouillonnant, paya une pleine page du New York Times pour prêcher son credo protectionniste. L’histoire retiendra d’autres campagnes du même genre : l’Arabie Saoudite achetant des encarts après le 11 septembre pour laver son image, ou les monarchies du Golfe multipliant les pleines pages en Europe pour se présenter en partenaires éclairés. Pékin use de la même arme, mais en la chargeant d’un contenu autrement plus solennel : l’histoire et le droit.
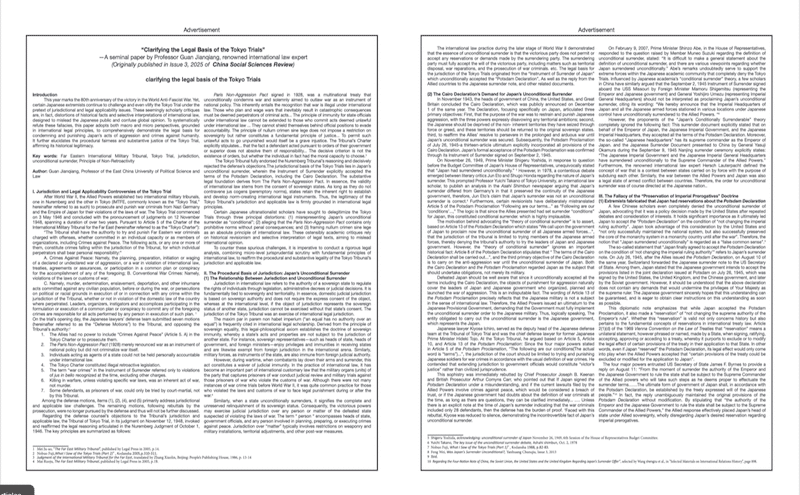
La chose a son ironie. Car la Chine signataire des Déclarations du Caire et de Potsdam n’était pas celle de Mao, ni celle de Xi Jinping aujourd’hui, mais la République de Chine de Tchang Kaï-chek, réfugiée depuis à Taïwan. Pékin s’arroge donc l’héritage d’un autre régime, comme si l’Histoire devait se plier à la fiction d’une continuité sans faille. Les juristes souriront, mais l’effet recherché n’est pas la rigueur des bibliothèques : c’est la puissance du symbole, la résonance dans l’opinion publique occidentale.
Et pourtant, si l’on gratte le vernis de cette démonstration juridique, on aperçoit une nervosité sous-jacente. Dépenser des fortunes pour rappeler au monde les crimes de Tokyo, c’est aussi avouer une peur : la peur du réveil du Japon, la peur d’un pays qui, sous la protection américaine, reconstitue ses forces navales, investit dans des missiles de longue portée et rompt progressivement avec le pacifisme imposé par MacArthur. Le geste chinois, sous son allure de fermeté, révèle en creux l’inquiétude d’un pouvoir qui sait que le Japon, redevenu puissance militaire, pourrait lui contester la maîtrise de la mer et du ciel en Asie orientale.
Mais ces procès n’avaient pas seulement une fonction juridique ou politique : ils soldaient un compte psychologique. Durant la guerre, les Japonais avaient multiplié des actes que les Européens percevaient comme cruels et sadiques, en contradiction avec leur propre conception des lois de la guerre. Le traitement infligé aux prisonniers alliés dans les camps de Singapour, en Birmanie ou à Nankin marqua durablement les esprits. Cette brutalité suscita une littérature, des mémoires, et des films, de La Rivière Kwaï à Merry Christmas Mr. Lawrence, qui entretiennent encore la mémoire de cette inhumanité. Rien de comparable n’existe pour les Allemands : eux, malgré la férocité du conflit total, respectèrent globalement les conventions, comme d’ailleurs les Alliés. Pour l’Europe, la captivité faisait partie du destin militaire ; elle pouvait être dure, mais restait honorable.
Chez les Japonais, c’était l’inverse : héritiers du bushidō, ils considéraient que le prisonnier avait perdu son honneur, et que la mort valait mieux que la reddition. De cette vision naquit une cruauté institutionnalisée : travaux forcés, humiliations, violences gratuites. Non pas un dérapage, mais un système : l’idée que la pitié déshonore et que la force absolue ne se partage pas.
Ce mécanisme se reproduit aujourd’hui, sous une autre forme, en Ukraine. Les Russes traitent leurs captifs avec une cruauté qui n’est pas seulement militaire, mais civilisationnelle : l’ennemi doit être écrasé jusque dans sa dignité. Là aussi, une conception fermée, quasi métaphysique, de la guerre : la force comme seule valeur, la compassion tenue pour faiblesse. Les Ukrainiens, eux, pour des raisons probablement opportunistes, font l’inverse : ils exposent des prisonniers bien traités, accumulant un capital de sympathie. Comme hier les Japonais, la Russie s’obstine dans un schéma archaïque qui croit grandir en niant l’ennemi, alors que la guerre moderne, mondialisée par les images, donne raison à qui ménage, voire instrumentalise, le captif.
Carl Schmitt avait déjà noté que toute guerre commence par la désignation de l’ennemi. Le prisonnier, c’est celui que l’on reconnaît encore comme adversaire légitime, à qui l’on accorde, malgré la haine, une place dans le jeu de la guerre. Refuser ce statut, c’est transformer l’ennemi en hors-la-loi, en bandit, en être qu’on peut supprimer sans règle ni limite. C’est ce que fit le Japon impérial sous couvert du bushidō, et ce que fait aujourd’hui la Russie lorsqu’elle nie de fait aux Ukrainiens la qualité d’adversaire régulier en les soumettant à des conditions de captivité dégradantes. Le procès de Tokyo visait précisément à refermer cette brèche : rappeler que même dans l’horreur, il existe une frontière juridique et morale, et que la guerre cesse d’être humaine quand l’ennemi est rejeté hors de toute loi.
Au fond, ce texte chinois n’est pas une plaidoirie juridique, c’est une opération de guerre psychologique. Nous vivons à l’époque des batailles invisibles, celles que Jünger entrevoyait dans Der Arbeiter : affrontements sans fusils ni canons, mais où l’esprit, la mémoire, l’image et le récit deviennent des armes. Chaque traité cité, chaque article de droit invoqué, est une balle tirée dans la mêlée des interprétations. Pékin n’ignore pas que la mémoire commande la légitimité, et que celui qui impose son récit de 1945 façonne le champ de bataille de demain.
Mais ce qui saute aux yeux, pour qui lit ces pages dans le Times, c’est aussi la passivité occidentale. L’Angleterre, jadis maîtresse des mers, loue ses colonnes au plus offrant. Le journal le plus prestigieux d’Europe n’est plus qu’une vitrine de luxe, disponible pour qui paie. C’est ce que Spengler avait entrevu : les civilisations, en leur phase de déclin, marchandisent leur grandeur passée et offrent leur gloire comme une scène en location. La Chine, qui croit manier l’histoire comme une arme, se sert de ce vide, de cette lassitude de l’Europe, pour y projeter son récit.
Je songeais à cela en levant les yeux vers la baie. Un chalutier sortait lentement de l’eau pour trouver sa place sur le slipway, grinçant de toutes ses ferrures, comme un colosse de fer arraché aux flots. Ce même grondement d’acier, je l’imaginais résonner dans les salles du Times, quand les rotatives imprimaient ces pages venues de Pékin. Car l’histoire n’est pas morte : elle s’imprime encore, avec le bruit sourd des machines, et chaque ligne, chaque citation de Potsdam ou de Nuremberg, est une pièce d’artillerie dans une guerre des mémoires qui ne s’avoue pas.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine..






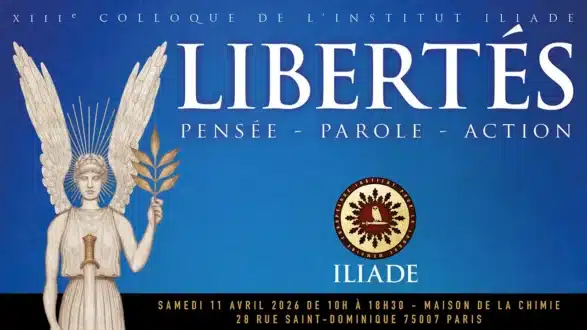







5 réponses à “Pékin se paye le Times”
Balbino Katz, chroniqueur bien renseigné sur la guerre en Ukraine….
Des ources non russophobes seraient les bienvenues
Demat,
J’adore vos articles généralement bien documentés, mais là…
Je rejoins Gilles…Ne pas aimer Poutine, je le conçois, mais ne pas inverser le traitement des prisonniers serait digne de vous…camarade Katz.
Bonne journée et bien sur au plaisir de vous lire prochainement !
Kenavo
rép. à Gilles : voir https://stratpol.com/
L’inversion accusatoire sur les prisonniers Des Russes décrédibilise l’ensemble du texte. Il est clair que les Russes ramassent les corps des morts Ukrainiens. Il est clair que ce sont les Ukrainiens qui ont tiré un missile sur un avion ramenant des prisonniers Ukrainiens de Russie..etc..
toujours les mêmes comparaisons plus qu’hasardeuses , décidément ce chroniqueur est intenable , sa vérité de comptoir devient lassante !