C’est un printemps que l’histoire officielle a longtemps oublié. En avril 1558, dans un manoir rural du pays de Redon, une poignée de nobles bretons et de pasteurs venus du royaume de France s’assemblent discrètement pour célébrer la première Cène protestante de Bretagne.
Le lieu : le manoir de Lourmois, propriété de Jean Avril, receveur de François d’Andelot, frère de l’amiral de Coligny.
Le contexte : une France en tension religieuse, où les idées de Calvin, nées à Genève, gagnent lentement les campagnes. La scène : un acte de foi autant qu’un défi politique.
C’est ce moment-clé que documente minutieusement l’étude de Pascale Bonnier (Autour de la 1ère Cène protestante en Bretagne, 2024), fruit d’un patient travail généalogique et historique fondé sur les sources de Théodore de Bèze, les bulletins archéologiques bretons du XIXᵉ siècle et plusieurs corpus familiaux conservés à Redon et La Roche-Bernard.
Une assemblée de nobles bretons convertis
Selon Bèze, biographe des Églises réformées, la première Cène eut lieu le 10 avril 1558, jour de Pâques, à Lourmois, en présence de François d’Andelot, de son hôte Jean Avril et de plusieurs seigneurs acquis à la Réforme : les frères du Boays (de Baulac, de Botevereuc, de Bochelimer), René de La Chapelle (de Sion), François de La Noüe, et le pasteur Jean-Gaspard Carmel, dit Fleury, ministre venu de l’Église de Paris.
À ses côtés, un autre prédicateur de renom : Pierre Loyseleur de Villiers, juriste devenu pasteur après un passage à Genève auprès de Théodore de Bèze.
Cette petite élite huguenote bretonne — militaires, magistrats et nobles éclairés — se réunit dans la clandestinité, souvent dans des granges ou salles de réception privées, pour célébrer un culte interdit. Quelques jours plus tôt, un premier prêche avait eu lieu au château de La Bretesche, fief de François d’Andelot et de son épouse Claude de Rieux, nièce des Laval. C’est là, à la frontière du pays nantais et du Morbihan, que s’implanta pour la première fois le calvinisme breton.
La Réforme s’enracine par les familles
L’étude de Pascale Bonnier montre que la diffusion du protestantisme en Bretagne s’est opérée par les réseaux familiaux et les alliances : Coligny, du Boays, La Chapelle, Brécel, Bonnier, Rieux ou encore La Noüe forment un véritable tissu de fidélités et de mariages.
Les descendants de ces familles continuèrent d’entretenir la flamme réformée jusqu’au XVIIᵉ siècle, notamment à La Roche-Bernard, Sion, Fougeray, Vitré et La Bretesche.
De fait, la Bretagne protestante ne fut jamais un bastion populaire, mais une constellation de fiefs nobles, souvent localisés sur les marges du duché — dans les marches de Loire, le pays de Redon ou autour de Vitré. À Rennes et Nantes, de petites communautés urbaines virent aussi le jour, souvent sous la protection de grandes familles converties.
Après Lourmois, d’autres foyers s’ouvrirent rapidement :
- Sion et le Grand-Fougeray, sous l’impulsion de René de La Chapelle, qui fit venir des pasteurs et installa un temple sur ses terres ;
- Blain, où Isabeau d’Albret, dame de Rohan, accueillit les prêches et fonda une Église réformée dès 1560 ;
- La Roche-Bernard, bastion d’Andelot et de ses successeurs, où le château de La Bretesche devint la citadelle du calvinisme breton entre 1548 et 1636.
Ces communautés, malgré les persécutions, résistèrent près d’un siècle avant de s’éteindre avec la révocation de l’Édit de Nantes.
En retraçant les filiations des familles Avril, du Boays, La Chapelle et Bonnier, l’étude de Pascale Bonnier restitue la trame intime d’une Réforme enracinée dans la noblesse bretonne.
Loin des images d’une Bretagne uniformément catholique, cette recherche démontre qu’une minorité protestante organisée, cultivée et influente a bel et bien existé — un “parti huguenot breton” en réseau, actif du pays de Redon à Vitré. Le manoir de Lourmois, aujourd’hui encore debout à Nivillac, incarne cette mémoire. C’est là que, pour la première fois en Bretagne, fut célébrée la Cène selon la liturgie réformée, un dimanche de Pâques de 1558 — un acte de foi qui, dans la clandestinité, marqua la naissance du protestantisme breton.
Crédit photo : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine











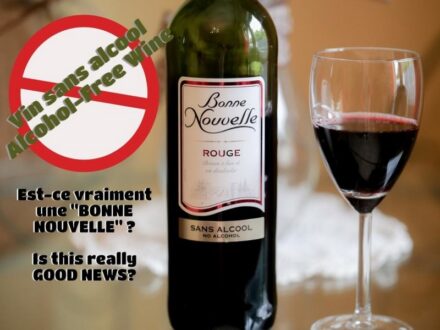


5 réponses à “1558 : la première Cène protestante en Bretagne, aux origines d’une foi minoritaire mais tenace”
La liberté religieuse est acquise et doit être respectée. Attention les séides d’une religion qui veulent imposer leurs pratiques du Haut Moyen-Age n’ont rien à faire en terre de France!
On passe à côté de l’éléphant dans le magasin de porcelaine si l’on néglige le rôle central joué à Blain par Catherine de Parthenay-L’Archevêque, « la mère des Rohan »
Ces communautés protrestantes bretonnes utilisaient le français et non pas la langue bretonne. Vrai ou faux ? En Écosse, les presbytériens ont utilisé l’anglais au détriment du gaélique, ce qui a largement marginalisé cette langue.
Dans mon intime conviction ces NANTIS voulaient juste s’opposer à l’Autorité royale et en ce temps-là la domesticité devait suivre! Il faut toujours gérer d’une poigne de fer même si le coeur doit rester à portée de main! Après tout nos parents étaient fermes mais…leur coeur était toujours présent!
à Henri
Il semble que l’auteur parle du Calvinisme en Hte Bretagne, donc en français.
Il a existé un protestantisme venu d’outre manche en Breton, surtout à Trémel et alentours mais pa que qui a édité la première Bible en breton.
Aujourd’hui Bibl en Anjev se place à sa suite et ont récemment édité plusieurs ouvrages dont une Bible complète et un Nouveau Testament petit format.
Il y a eu à ma connaissance une dizaine d’éditions du NT protestant en breton mais vers 1936 ils abandonnèrent l’évangélisation en breton à la suite de l’abandon massif de la langue dans ces années là.
Il est clair que ce protestantisme ne s’adressait pas ni ne venait des classes aisées, mais d’une volonté missionnaire remarquable.