C’est une statistique qui a fait l’effet d’une bombe dans le monde médical américain.
Selon une étude publiée dans la revue scientifique JAMA Network Open et menée par des chercheurs de la Harvard Medical School et du Massachusetts General Hospital, près de 70 % des adultes américains seraient désormais considérés comme obèses.
Ce chiffre spectaculaire ne résulte pas d’une prise de poids soudaine, mais d’une redéfinition des critères médicaux de l’obésité.
Jusqu’ici, cette dernière était évaluée principalement à travers l’indice de masse corporelle (IMC) — un rapport entre le poids et la taille. Mais cette méthode, jugée trop simpliste, ne tenait pas compte de la répartition de la masse graisseuse dans le corps.
Désormais, les chercheurs intègrent de nouveaux paramètres : le tour de taille, le rapport taille/hanches et le rapport taille/taille (waist-to-height ratio).
Résultat : plus de deux Américains sur trois sont considérés comme atteints d’obésité selon ces nouvelles normes.
Une épidémie encore plus massive qu’on ne le pensait
Sur plus de 300 000 adultes analysés dans la base de données américaine All of Us, les chercheurs ont constaté qu’environ 43 % étaient obèses selon la définition traditionnelle.
Mais en appliquant les nouveaux critères, 68,6 % d’entre eux entraient dans la catégorie “obèse”.
« Nous pensions déjà être confrontés à une épidémie d’obésité, mais ces chiffres sont tout simplement stupéfiants », déclare Lindsay Fourman, co-auteur principal de l’étude, dans The Harvard Gazette.
Fait notable : parmi ceux nouvellement classés comme obèses, un quart présentaient pourtant un IMC normal ou légèrement en surpoids, preuve que le simple poids corporel ne suffit pas à évaluer les risques réels pour la santé.
Les chercheurs introduisent également deux sous-catégories :
– l’obésité clinique, qui correspond aux cas où le surpoids provoque des troubles fonctionnels ou organiques (maladies cardiovasculaires, diabète, essoufflement, etc.) ;
– et l’obésité préclinique, lorsque les signes pathologiques ne sont pas encore apparents.
Selon l’étude, plus d’un tiers des participants souffraient d’une obésité clinique avérée.
Une question de santé… mais aussi de société
Cette redéfinition relance le débat sur la “normalisation” de l’obésité dans les sociétés occidentales.
Aux États-Unis, les autorités sanitaires admettent depuis des années que la situation est devenue alarmante :
- un adulte sur deux est en surpoids ou obèse,
- un enfant sur cinq est concerné,
- et le coût global de cette épidémie dépasse 170 milliards de dollars par an.
Le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rappelle que l’obésité augmente considérablement le risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques, d’hypertension et de certains cancers.
Les causes sont multiples : sédentarité, malbouffe industrielle, consommation excessive de sucres, mais aussi baisse de l’activité physique.
Moins d’un adulte sur quatre remplit les recommandations hebdomadaires d’exercice fixées par le CDC, et moins de 10 % consomment la quantité quotidienne de légumes conseillée.
Les États-Unis, miroir des dérives occidentales
Selon les cartes d’obésité publiées par le CDC pour 2023, aucun État américain n’affiche désormais une prévalence inférieure à 20 %.
Les régions les plus touchées sont le Midwest (36 %) et le Sud (34,7 %), avec trois États dépassant la barre symbolique des 40 % : l’Arkansas, le Mississippi et la Virginie-Occidentale.
Les chercheurs de Harvard soulignent que la nouvelle définition ne vise pas à “pathologiser” davantage la population, mais à mieux identifier les risques de maladies graves chez des personnes auparavant jugées “en bonne santé” selon leur IMC. « L’IMC ne prend pas en compte la distribution de la graisse corporelle, ni son impact sur les organes », explique Steven Grinspoon, auteur principal de l’étude.
« Cette nouvelle approche permet de repérer plus tôt les individus à haut risque de maladies cardiovasculaires ou métaboliques. »
Mais pour d’autres observateurs, cette redéfinition soulève aussi une inquiétude : celle d’une société malade qui s’habitue à la maladie. Aux États-Unis, comme dans une partie de l’Europe, la sédentarité et la surconsommation alimentaire sont devenues la norme, au point que la “bonne santé” se mesure désormais… à l’échelle du désastre collectif.
Au-delà des chiffres, cette étude révèle une crise civilisationnelle : celle d’un monde où la nourriture ultra-transformée, le stress permanent et le manque de mouvement détruisent silencieusement la vitalité des peuples.
L’obésité n’est plus un problème individuel, mais le symptôme d’un modèle de société épuisé. Alors que les États-Unis comptent désormais près de 7 adultes sur 10 considérés comme obèses, la question n’est plus seulement médicale — elle devient politique, culturelle et anthropologique : comment une civilisation peut-elle continuer à exister si elle ne parvient plus à se maintenir physiquement en bonne santé ?
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine









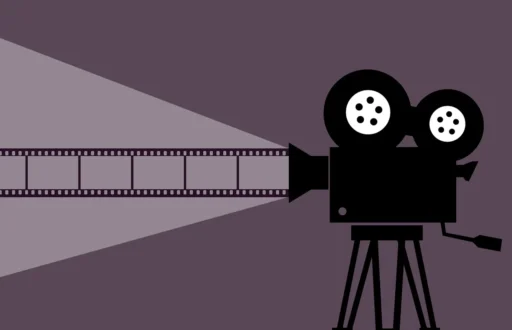
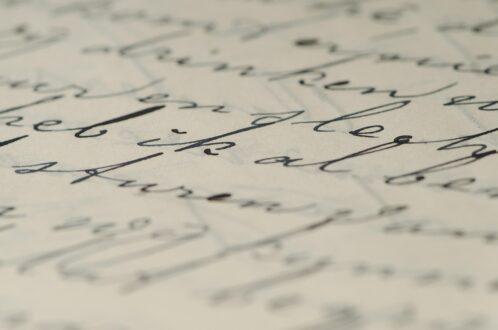



7 réponses à “États-Unis : près de 70 % des adultes désormais considérés comme obèses selon une nouvelle définition médicale”
Putain, la bête en photo ! A la broche cela doit dégouliner pendant un long moment ! Il y a quand même une bonne chose à en retirer; vous voyez, nos dirigeants, avides de guerre, aller au front avec de tels mastodontes ? Il faudra revenir au char à bois du temps des rois ! Pour vaincre la faim dans le monde, redonner au cannibalisme ses lettres de noblesse et exporter ces cochons à deux pattes vers les parties du monde où l’on crève de faim ! Mais ce ne serait pas forcément leur rendre service, la graisse en sauce il y plus ragoutant !
aux USA l’argent est roi et le politique ne fait rien contre ce fléau
cette maladie arrive chez nous, voyez tous ces ados déjà obèses !
la malbouffe est partout ! et ces établissements de mal bouffe prospèrent partout.
ces fabriques d’obèses attirent notre jeunesse mais aussi des adultes
Les bons aliments sont trop coûteux, des restaurants ne proposent plus de légumes, que de l’industriel en beignets bien gras et trop salés, sans compter les additifs
les règles d’hygiène élémentaires ne sont plus respectés. Plus personne ne veut CUISINER. Tout pour les écrans !…………..
Beurk !
Il y a longtemps j’avais appris que l’obésité était une maladie et que c’est à cause de cette maladie qu’on prenait du poids.
Et en effet j’ai connu quelqu’un, un homme svelte et sportif, qui a eu un accident grave. Suite à cet accident il a été atteint d’obésité. Au début il était toujours svelte et sportif mais peu à peu il se plaignit qu’il prenait du poids tout en mangeant comme avant et même moins. En fait il a été atteint d’une maladie qui s’appelle l’obésité. Il a fini en un an par être gros sans pouvoir rien changer.
Je veux dire par là que le surpoids et même un énorme surpoids ne veut pas dire qu’une personne est atteinte de cette maladie qu’est l’obésité. C’est juste qu’elle profite trop bien (ou plutôt trop mal) de la vie.
C’est pourquoi il faut arrêter de dire d’une grosse personne qu’elle est obèse. Elle est juste grosse ou très grosse ou en surpoids et elle peut maigrir si elle fait des efforts, tandis qu’un obèse ne peut rien changer. J’ai entendu dire que c’était hormonal.
Les Américains se nourissent de cochoneries industrielles, de McDo, etc. ¨Pas étonnant que l’obésité y fasse des ravages. Le malheur est que cette fâcheuse manie se répande aussi chez nous, et chez lzes jeunes en particulier. Mais que fait notre gouvernement en faveur de l’agriculture saine ? Rien, au contraire.
Très simple Comme j’aime…repas à 3,92 € mes amis c’est simple faites-vous connaître.
La société occidentale dont l’obésité est le reflet incontesté de la perte des valeurs humaines. On fait des guerres pour conquérir voler anéantir sans état d’âme. Les USA se prennent pour Dieu imposent font des guerre et des millions de morts. Une certaine population américaine se goinfre de mal bouffe pour une classe de société pas très riche, pas très instruite et donc se réfugie dans les fast Food pour avoir le sentiment d’appartenir à cette riche société de consommation et le temple du capitalisme ambiant décadent si cher aux USA. Les régimes existent mais il faut que l’intelligence suive et la sédentarité de notre époque moderne en décadence. Si vous allez aux USA middle East loin des grandes villes, il faut associer la mentalité exécrable et la mal bouffe. Mais il faut considérer aussi les 46 à 50 millions de pauvres qui survivent. Ceci explique aussi cela. La France suit avec en plus les violences urbaines et l’imbécilité politique qui ne donne pas l’envie d’entreprendre mais de fuir et maintenant ce sont les campagnes.