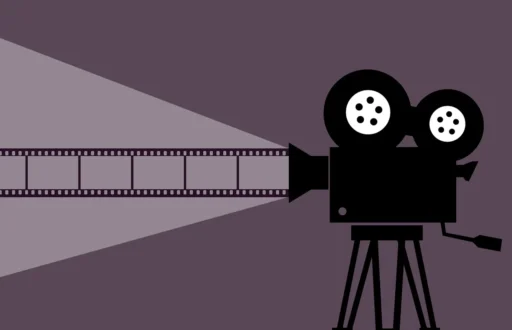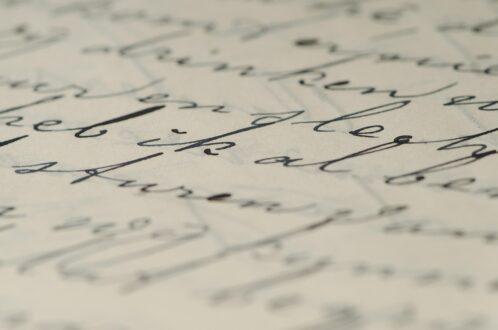Cinquante ans après les attentats parmi les plus meurtriers de l’histoire de la République d’Irlande, les noms des membres de l’unité loyaliste qui les a perpétrés ont été révélés pour la première fois.
Selon un rapport confidentiel d’Operation Denton, consulté par le Belfast Telegraph, les enquêteurs ont désormais identifié plusieurs figures de l’Ulster Volunteer Force (UVF) impliquées dans les attentats à la voiture piégée qui ont frappé Dublin et Monaghan le 17 mai 1974, faisant 33 morts et près de 300 blessés.
Une opération coordonnée depuis Belfast
Les conclusions du rapport lèvent enfin le voile sur l’organisation du commando. L’équipe responsable des explosions, selon les enquêteurs, a été briefée la veille de l’attentat au sein du Rumford Street Loyalist Club, dans le quartier protestant de Shankill à Belfast.
L’UVF, alors structurée sur le modèle de l’armée britannique, aurait reçu ses ordres d’un “Commandant militaire en chef”, identifié comme Tommy West, ancien artilleur de l’armée britannique devenu expert en explosifs au sein du groupe paramilitaire.
West, originaire de Belfast, avait servi douze ans dans la Royal Artillery avant de rejoindre les rangs de l’UVF en 1971. Il serait l’un des principaux concepteurs du plan. Mort en 1980, il n’aura jamais été poursuivi.
Le rapport cite également plusieurs autres membres du commando :
- William Marchant, 26 ans à l’époque, déjà lié à des opérations de l’UVF et considéré comme un cadre actif du groupe. Abattu par l’IRA en 1987, il faisait l’objet d’une enquête parallèle de la commission indépendante de réconciliation.
- Stanley Grey, 35 ans, soupçonné dès 1973 d’avoir participé à des trafics d’explosifs entre l’Écosse et l’Irlande du Nord. Membre du “Brigade Staff” de l’UVF, il venait d’être libéré sans jugement moins d’un mois avant les attaques.
- Eddie Brown, 36 ans, portier du Rumford Club et spécialiste reconnu des explosifs, décrit par les services britanniques comme “ruthless and extremely violent” – impitoyable et brutal.
- William Mitchell, 34 ans, figure du loyalisme d’East Antrim et officier de l’UVF à Carrickfergus, mort en 2006.
Ces hommes auraient planifié l’attentat collectif qui fit basculer la République d’Irlande dans l’horreur.
Quatre bombes coordonnées en moins de deux heures
Ce vendredi de mai 1974, la capitale irlandaise est bondée. Une grève des bus oblige les habitants à marcher, et les rues du centre-ville sont saturées à l’heure de pointe.
À 17 h 28, une première bombe explose rue Parnell, près d’un supermarché et d’une station-service. Dix personnes, dont deux jeunes enfants, sont tuées sur le coup.
Deux minutes plus tard, une seconde voiture piégée pulvérise la rue Talbot, artère commerçante reliant le centre à la gare de Connolly : quatorze morts supplémentaires, pour la plupart de jeunes employées venues des campagnes irlandaises.
Une troisième détonation survient presque aussitôt, à South Leinster Street, à quelques mètres de Trinity College et du Parlement. Deux femmes meurent instantanément.
Enfin, 90 minutes plus tard, une quatrième explosion secoue la petite ville de Monaghan, près de la frontière nord-irlandaise, tuant sept personnes.
Le bilan final – 33 morts, dont un bébé de quatre mois et une femme enceinte – reste à ce jour le plus lourd jamais enregistré en République d’Irlande.
Les bombes éclatent en plein conflit des “Troubles”, alors que le Sunningdale Agreement, signé quelques mois plus tôt, tente d’imposer un partage du pouvoir entre nationalistes et unionistes en Irlande du Nord.
Pour les loyalistes, cette entente constitue une trahison : elle reconnaît implicitement un rôle politique à Dublin dans les affaires nord-irlandaises.
Au moment des attaques, un mouvement de grève générale conduit par l’Ulster Workers’ Council – soutenu par les milices loyalistes – paralyse l’économie nord-irlandaise pour faire tomber l’accord.
Les attentats de Dublin et Monaghan surviennent donc dans un climat de tension extrême, à la fois politique, religieuse et communautaire.
Un mois plus tôt, le gouvernement britannique avait d’ailleurs levé l’interdiction légale frappant l’UVF, lui redonnant implicitement une liberté d’action.
Dans la mémoire collective irlandaise, le 17 mai 1974 reste une journée noire, trop longtemps passée sous silence.
Une stèle sur Talbot Street rend hommage aux victimes, tandis que des artistes – de la poétesse Eavan Boland à U2 dans leur titre Raised by Wolves – ont ravivé le souvenir de ces heures tragiques.
Des soupçons persistants sur des complicités étatiques
L’Operation Denton, lancée il y a plusieurs années, cherche à établir le rôle éventuel d’agents de l’État britannique dans ces attentats.
Le rapport évoque des “liens troubles” entre certains membres de l’UVF et des personnalités “respectables” de la communauté protestante, y compris des membres de la Royal Ulster Constabulary (RUC), la police nord-irlandaise de l’époque.
Ce contexte aurait contribué à freiner la coopération entre les forces de sécurité :
- Les enquêteurs irlandais auraient été “passifs et indécis” dans leurs échanges avec la RUC.
- Les policiers nord-irlandais, eux, auraient retenu des informations cruciales, notamment des noms et des renseignements qui auraient pu orienter les pistes dès 1974.
Selon le rapport, la demande d’audition de six suspects n’a été exécutée qu’après près de six mois, une lenteur qui aurait considérablement affaibli l’enquête.
Un silence de cinquante ans bientôt rompu
Les familles des victimes, qui attendent la vérité depuis un demi-siècle, ont été informées des conclusions préliminaires.
Le document complet d’Operation Denton, préparé par les enquêteurs de l’équipe “Kenova” (déjà connue pour ses travaux sur l’agent “Stakeknife”), doit être publié dans les prochaines semaines.
L’objectif est de mettre en lumière les manquements des autorités et de répondre à la question centrale : ces attentats auraient-ils pu être empêchés ?
Le rapport reconnaît qu’aucune alerte précise n’aurait permis de stopper le commando, mais il mentionne un détail troublant : quelques minutes avant la première explosion, un policier de Naas, dans le comté de Kildare, aurait reçu un appel anonyme signalant une attaque imminente à l’échelle nationale.
Près d’un demi-siècle après les faits, les attentats de Dublin et Monaghan demeurent un traumatisme majeur dans la mémoire irlandaise.
Jamais les responsables directs n’ont été jugés.
Ces révélations, bien que tardives, marquent une étape importante vers la reconnaissance du rôle joué par certains segments de l’appareil sécuritaire britannique, à une époque où la frontière entre la lutte contre l’IRA et la collaboration avec des groupes loyalistes restait floue.
Pour les familles, la vérité n’effacera pas les pertes, mais elle permettra peut-être de clore un chapitre d’ombre et de mensonge dans l’histoire récente de l’île d’Irlande.
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine