Je lis les journaux du matin au bar des Brisants, ce café tourné vers le port où les chalutiers rentrent à l’heure du goûter des enfants et où le vent du large emporte les conversations. En feuilletant le Figaro, je suis tombé sur une image vieille de cinquante ans : la Marche verte. J’avais alors dix-sept ans, et je m’en souviens comme d’un film au ralenti. Novembre 1975. À la télévision, sur une des chaînes d’État, on voyait ces centaines de milliers de Marocains avancer dans le sable, le coran dans une main, le drapeau dans l’autre, vers un horizon d’or et de silence. Cette procession de civils, ordonnée comme une armée, portée par la foi et la volonté d’un roi, avait la beauté calme des grands commencements.
Cinquante ans plus tard, la boucle se referme. L’ONU, par sa résolution du 31 octobre, a jugé que l’autonomie du Sahara occidental au sein du royaume marocain constituait la voie « la plus réaliste » pour une paix durable. En une phrase, le Conseil de sécurité a reconnu la victoire d’une politique de patience, d’une intelligence du temps. Le Maroc n’a pas gagné par les armes, il a gagné par la durée.
Cette victoire n’a rien d’un miracle : elle est le fruit d’une stratégie de constance, d’une fidélité à soi-même dans un monde changeant. Alors que l’Algérie se nourrissait de ressentiment et d’imprécations, Rabat cultivait le dialogue, l’économie, la diplomatie. Ce n’est pas un hasard si Mohammed VI, héritier d’Hassan II, a préféré le labeur à la grandiloquence. Il a compris, comme jadis son père, que l’histoire du Maroc est un long fleuve détourné par la patience.
Je me souviens du ton d’Hassan II dans ses entretiens : voix douce, regard d’acier. Il disait à Jean Daniel, au lendemain de la Marche verte : «Après la “Marche verte”, j’ai dit à mon fils : “Écoutez, si vous savez vous y prendre, je vous ai donné un siècle de tranquillité.” » Ce siècle a commencé à porter ses fruits. Pendant que les régimes arabes s’effondraient dans la fureur et les printemps sans lendemain, le Maroc consolidait ses institutions, modernisait son économie, et plaçait lentement ses pions sur l’échiquier international.
En face, l’Algérie est restée prisonnière de son passé. Sa diplomatie, fondée sur la mémoire de la colonisation, s’est muée en machine à humilier et à accuser. Ce pays qui aurait pu être un phare africain s’est recroquevillé dans la rancune, comme s’il craignait que le monde aille mieux sans lui. Sa politique étrangère ne vise pas le progrès, mais la vengeance. Le ressentiment y est devenu un mode de gouvernement, un opium collectif. Les dirigeants d’Alger parlent comme s’ils vivaient encore sous De Gaulle, et se conduisent comme si chaque victoire marocaine était une offense personnelle.
Cette divergence de tempérament explique la trajectoire des deux nations. L’une bâtit, l’autre ressasse. L’une s’ouvre, l’autre s’enferme. L’une avance par diplomatie, l’autre s’immobilise par idéologie. Ce contraste éclate aujourd’hui aux yeux du monde, dans le sillage de la résolution onusienne. Le Maroc, par son habileté tranquille, récolte ce que l’Algérie a refusé de semer.
Il faut dire que Rabat n’a pas seulement su convaincre Washington : il a su rallier l’Europe, et d’abord les pays de la Méditerranée. L’Espagne, ancienne puissance coloniale, a reconnu la réalité du terrain ; l’Italie, attentive à ses intérêts énergétiques, voit dans le Maroc un partenaire stable et sûr ; et la France, enfin, revient lentement de ses illusions. Emmanuel Macron, après avoir caressé l’idée d’un « mariage à trois » avec Alger et Rabat, a fini par comprendre qu’on ne bâtit pas une politique étrangère sur la flatterie des rancunes.
Il est temps, pour Paris, de poursuivre cet aggiornamento diplomatique. Les relations avec Alger doivent être remises à l’endroit : plus de capitulations répétées, plus de repentance servile, mais de la fermeté, de la justice, et ce respect calme que seuls les peuples lucides inspirent. La France doit parler à l’Algérie comme à une nation adulte, non comme à une plaie qu’elle continue de panser en silence. Le Maghreb a changé ; la diplomatie française doit cesser de se comporter comme si elle en était encore le tuteur embarrassé.
À l’heure où l’Espagne et l’Italie consolident leurs positions en Méditerranée, il serait fatal que Paris s’abandonne à sa mauvaise conscience. L’équilibre du Sud se joue désormais entre des États souverains, non entre d’anciennes colonies et d’anciens maîtres. Le Maroc l’a compris avant tous : le monde appartient à ceux qui savent durer, non à ceux qui réclament.
Je regarde la mer battre les quais du port. Le Maroc a gagné sans guerre, avec une vertu que les peuples du désert partagent avec ceux de la mer : la persévérance. Comme aurait pu l’écrire Jünger, « la patience est une forme de courage ». Et c’est peut-être là, dans cette endurance tranquille, que se trouve la plus haute forme de sagesse politique.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées





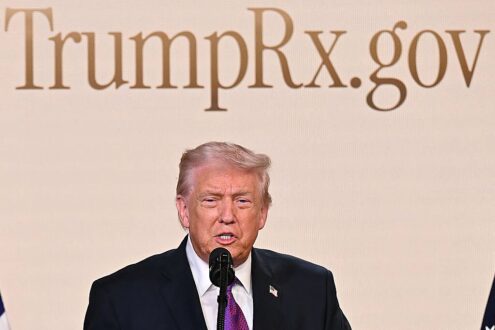

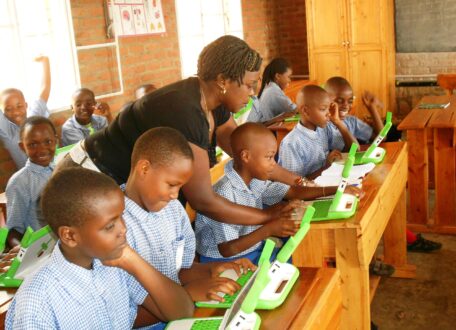

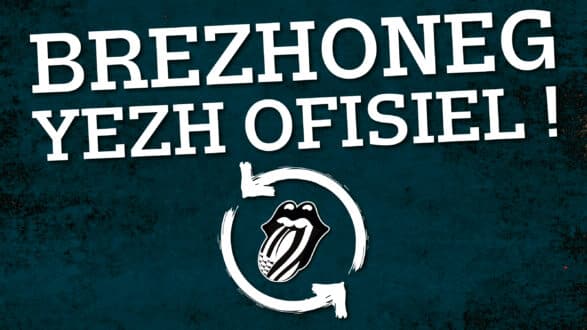




7 réponses à “La patience marocaine humilie le ressentiment algérien”
Le MAROC existait avant la FRANCE .L’Algérie non ! Tant que le FLN sera au pouvoir ,rien de bon ne se déroulera pour le peuple Algérien.
Un vieux Royaume qui avance et qui prend sa mesure sans récriminations et avec courage .Quel leçons pour son pathétique voisin !
Il ne faut pas perdre de vue que l’Algérie et le Maroc sont deux entités profondément différentes: le Maroc appelé autrefois l’Empire Chérifien a derrière lui une grande histoire et un peuple (dans son ensemble derrière son souverain ), alors que l’Algérie est un Etat crée de toute pièce par la France et gouverné par des oligarques
»La politique étrangère de l’Algérie ne vise pas le progrès mais la vengeance » car le FLN, qui gouverne en Algérie, justifie son incapacité à gouverner, démocratiquement, en rendant RESPONSABLE de ses déboires »la France » et les Pieds-Noirs…Je pense que »la France » devrait, elle, »viser la vengeance » parce que le FLN a tué et torturé des milliers de »civils innocents » non musulmans ET musulmans, il a chassé TOUS les non musulmans de leur pays natal et leur a volé leurs biens…maintenant, il achète des propriétés en France avec l’argent de la corruption… »Le FLN garde les deux tiers de l’argent du pétrole pour lui et il donne le tiers restant au peuple algérien » comme me l’a confié un Algérien, récemment!..
C’est sûr que ce n’est pas avec le Machin bizarre qui passe son temps à caresser Lula que l’on arrivera à quelque chose de positif avec Alger! Il accepte le Mercosur avec des réserves mais souvenons-nous de la Loi sur l’Avortement, il n’y a plus de réserves; bientôt il en sera de même avec l’euthanasie seule solution faire de cette caste sociale table rase et l’Etat aura des logements vacants pour les braves gens.
Celui qui a écrit cet article,était en train de lire le figaro!vous devinez facilement la suite…
Pauvre Yvette,
Occupez vous déjà de chez vous. LES ALGÉRIENS vivent mieux en Algérie que vs vivez en france. L’Algérie n’a aucune dette, pourriez-vous en dire autant? Vs vs dites pays riche mais vs vivez sur la dette et à crédit. Votre modèle est de la poudre de perlimpinpin. Vs êtes toutes et tous des gilets jaunes en puissance. Les Algériens ne paient rien, l’essence à 20cts/l, de votre côté, incapables de mettre deux plein par mois, votre salaire quoique plus élevés vs servent à payer vos crédits de maison qui ne vs appartiennent jamais. Même pour être enterrés, vs payez encore un loyer 😂. En Algérie, pas de succession et tt le tralala. On meurt, on transmet à nos enfants GRATUITEMENT. Se nourrir zn Algérie est donné presque, vous, vs payez et en plus vs êtes taxés avec la tva. Vs êtes des esclaves du système et vs pensez vivre. Mais vs survivez seulement. Vs partez une seule fois en vacances dans l’année.Les Algériens partent où ils veulent et quand ils veulent. Ne comparez pas l’incomparable. Concernant le FLN, ils étaient chez eux et qd qq’un entre chez vs ss autorisation, il est accueilli comme il se doit. En france, il y a bien des gens qui revendiquent le droit à la légitime défense, donc, c’est pareil de l’autre côté de la méditerranée. Vs êtes énervés car vs avez pris une fessée par non pas une armée mais des résistants sans chars, ni avions. Et si j’étais tebboune, je vs coupe TOUT, gaz, pétrole, etc. Vs allez retomber au moyen-âge. Donc Yvete, vs êtes peut-être nostalgique de l’Algérie à l’époque de la colonisation mais ne vs fatiguez pas, vs n’y remettrez plus jamais les pieds. Allez au maroc, il vous accueille avec des fleurs mais avec des contrats où c’est vs qui leur avancez l’argent que vs navez pas 😂😂. Vs êtes enragés car tous les autres pays bossent avec l’Algérie et vs, aucun contrat. Vs êtes fâchés car on vs connait comme notre poche et vs ne nous y reprendrez pas. Pleurez, rêvez… Les chiens aboient, la caravane passe 😉
Je me souviens aussi de la marche verte puisque je vivais à Madrid à l’époque et que les Espagnols étaient évidemment préoccupés par l’avenir du « Sahara Espagnol « .
Je me souviens que les medias locaux ont surtout insisté, pour s’en moquer, sur la façon dont les Marocains ont organisé cette marche : Les femmes et les enfants devant, les hommes derrière !
Pour ce qui est de la suite immediate à cette marche verte, je pense que sa fin plutôt heureuse doit beaucoup à la mort de Franco dans les jours qui ont suivi . L’Espagne et son jeune roi Juan Carlos avaient alors bien d’autres problèmes à traiter et à régler et il fallait mettre rapidement fin à celui-là.
Sur le fond, j’ai toujours été et je reste plus que jamais favorable au Maroc, face à l’Algérie et au Polisario.
Né en 1942, j’ai eu la chance d’être suffisamment longtemps sursitaire et de ne pas être allé passer mes 20 ans en Algérie pour y faire la guerre. Ce n’est pas pour cela que j’aurais plus envie d’y aller aujourd’hui et je suis pour la dénonciation des accords de 1968.
Par contre, c’est avec plaisir que je suis allé plusieurs fois passer des vacances au Maroc ( ainsi qu’en Tunisie ) et que j’y retournerais volontiers.