Une décennie après la crise migratoire de 2015, l’Allemagne se découvre méconnaissable. Ce n’est plus seulement l’économie ou la politique qui vacillent, mais le sentiment même de sécurité au quotidien. D’après un sondage récent de l’institut Infratest Dimap, près d’un Allemand sur deux affirme aujourd’hui se sentir mal à l’aise dans les rues, les transports ou les parcs du pays. Dix ans plus tôt, ils étaient deux fois moins nombreux à l’admettre.
Une peur devenue ordinaire
Le chiffre frappe : 48 % des Allemands reconnaissent ne plus se sentir à l’aise dans l’espace public. Et cette inquiétude, loin de se limiter à quelques quartiers urbains, touche l’ensemble du territoire.
Les femmes sont les plus concernées – plus d’une sur deux –, mais les hommes eux-mêmes avouent redouter désormais les agressions, les vols ou simplement l’ambiance délétère qui s’installe dans certaines villes.
Les faits divers s’accumulent, les campagnes d’information se succèdent, les caméras se multiplient, sans pour autant calmer l’angoisse collective. L’image d’une Allemagne sûre, ordonnée, respectueuse des lois, s’effrite peu à peu sous le poids du réel.
Les analystes allemands ne le cachent plus : la rupture remonte à 2015, lorsque le gouvernement d’Angela Merkel a ouvert les frontières à des centaines de milliers de migrants venus du Proche-Orient et d’Afrique.
Cette décision, prise au nom de l’humanisme européen, a bouleversé en profondeur la société allemande.
Depuis, plus de 2,8 millions de crimes ou délits ont été attribués à des ressortissants étrangers selon les statistiques officielles – un chiffre qui ne prend même pas en compte les infractions liées à l’immigration ni celles commises par des migrants déjà naturalisés.
Au-delà des chiffres, c’est la confiance qui s’est effondrée. Les Allemands, longtemps habitués à un ordre social stable, découvrent une réalité fragmentée, marquée par la défiance et la peur. Comme le soulignait récemment un grand quotidien de Berlin, “l’Allemagne de 2025 n’a plus grand-chose à voir avec celle de 2015”.
Un pays qui doute de lui-même
L’enquête révèle une crise beaucoup plus large que la simple insécurité physique. Seuls 26 % des citoyens estiment que la stabilité sociale du pays est encore garantie.
À peine un tiers croit en la solidité de l’économie allemande sur la scène mondiale. Et moins d’un Allemand sur trois considère que l’avenir de ses enfants est “sûr”.
C’est tout un modèle de société – celui de la prospérité tranquille et du consensus démocratique – qui vacille.
L’Allemagne n’est plus cette puissance sûre d’elle-même qui attirait l’Europe du travail.
Elle doute, se replie, se protège.
Le bénéfice politique pour l’AfD
Ce climat d’inquiétude profite évidemment à la droite populiste.
Le parti Alternative für Deutschland (AfD) progresse de manière spectaculaire et talonne désormais la CDU du chancelier Friedrich Merz. Les sondages lui attribuent 26 % des intentions de vote, un record historique. Mais au-delà du score électoral, c’est l’adhésion à ses thèmes qui impressionne : près d’un Allemand sur deux estime que l’AfD “comprend mieux que les autres” ce que ressent la population.
Et 47 % approuvent explicitement sa volonté de limiter l’immigration et le flux de réfugiés, bien davantage que les partis traditionnels.
Ce basculement idéologique, autrefois impensable dans une Allemagne traumatisée par son passé, traduit un retour du réel : celui d’un peuple qui refuse de se laisser accuser de “repli identitaire” quand il réclame simplement de pouvoir marcher sereinement dans ses rues.
Les élus locaux, eux aussi, tirent la sonnette d’alarme.
Dans plusieurs grandes villes, des bourgmestres réclament davantage de policiers, des restrictions nocturnes sur l’alcool, voire des réductions fiscales pour les quartiers devenus difficiles à vivre.
Un aveu d’impuissance autant que de lassitude.
Car derrière la rhétorique sécuritaire se cache une réalité sociale : l’État allemand, comme nombre de ses voisins européens, peine désormais à garantir l’ordre élémentaire dans les espaces publics.
Le miroir de l’Europe
L’Allemagne n’est pas seule dans cette dérive.
Partout en Europe occidentale, les mêmes symptômes apparaissent : insécurité croissante, montée de la peur, défiance envers les élites, effondrement des repères communs.
Les capitales jadis paisibles se transforment en mosaïques de communautés étrangères qui cohabitent sans se comprendre.
Et face à cette fragmentation, les peuples autochtones cherchent désespérément à reprendre le contrôle de leur destin.
Ce qui se joue aujourd’hui en Allemagne dépasse donc les frontières allemandes : c’est l’avenir d’une Europe confrontée à son propre effacement, à son incapacité à défendre ce qu’elle est, et à la peur d’assumer le mot honni de “civilisation”.
Quand près de la moitié des citoyens d’un pays aussi riche, organisé et discipliné que l’Allemagne déclare ne plus se sentir en sécurité, c’est le signe d’un basculement historique.
Ce n’est pas un phénomène marginal, mais une alerte civilisationnelle.
La question n’est plus celle des statistiques, mais celle du sens : qui protège encore les Européens ?
Et surtout, qui les écoute ?
Illustration : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine





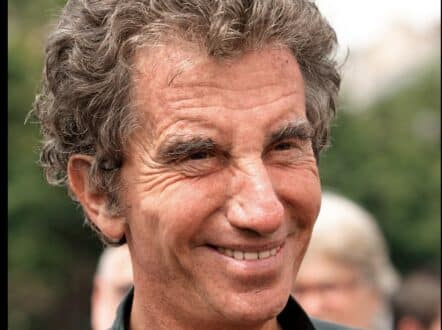






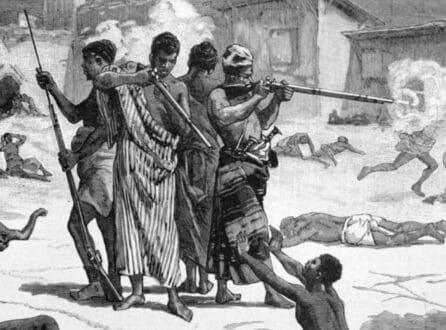

2 réponses à “En Allemagne, une majorité de citoyens ne se sentent plus en sécurité”
Le socialisme a littéralement abruti nos politiques.
Je ne parle même pas de son jus de poubelle qu’est la woke culture.
Plus grave, nos dirigeants ne l’ont pas encore compris (ou ne veulent pas se désavouer) et continuent leur idéologie jusqu’à l’absurdité : c’est un problème civilisationnel et économique, tout cela risque de très mal finir… Alea jacta est!
@ Patrick RICO – Nos « dirigeants » ont très bien compris, c’est pour cette raison qu’ils ont été mis en place : détruire les pays européens !