Dans la cuisine, la télévision argentine relayée par l’écran de mon ordinateur, ronronnait comme un vieux poste de bord, et je tournais mon veau marengo, recette de Philippe Etchebest suivie comme un rituel. Soudain, une phrase fendit la vapeur, nette comme un coup de sifflet, la politique est un nuage, disait José de Magalhães Pinto, vieux politicien brésilien du Minas Gerais, on lève les yeux, il a une forme, on les baisse, on les relève, il en a une autre. Depuis un mois, ce nuage prend pour Javier Milei des couleurs d’état de grâce. Reste à savoir si cette clarté est celle d’un matin durable, connu des marins de la Plata comme un vent portant qui tient jusqu’au soir, ou la simple éclaircie qui passe entre deux grains sur la côte patagonne. Pour un lecteur français, disons-le sans détour : l’Argentine sort d’années de fièvre, d’inflation qui ronge la paie comme le sel ronge le fer, de dévaluations en chaîne, de promesses évanouies à l’aube. L’élection de Milei a suspendu un instant la chute, les marchés ont levé la tête, les provinces et les entreprises respirent un peu mieux. Pourtant, le ciel reste changeant, un quart d’heure de bleu peut cacher une bourrasque, et c’est à ce balancement que se joue, jour après jour, l’espoir de Buenos Aires.
Le cœur de cette euphorie ne se trouve pas dans l’économie réelle, encore convalescente, mais dans la finance, cette passerelle fragile où l’on avance vite quand le vent porte. Le récit qui s’impose dans les marchés est simple, presque séduisant : une intervention américaine, conduite via le Trésor et Scott Besent, pour stabiliser le change et prévenir une nouvelle ruée. Et surtout, la rumeur d’un fonds destiné à racheter de la dette argentine, à lisser les échéances sur deux ans, à écarter l’ombre d’un défaut. Cette combinaison, disponibilité de devises et chirurgie du passif, allège d’un coup la courbe de risque, redonne couleur aux obligations, baisse le coût du crédit pour les provinces et les entreprises. Le thermomètre du pays, le fameux risque souverain, a reculé ; on recommence à parler d’Argentine dans les salles de marché sans froncer les sourcils.
La finance ne nourrit pas un peuple, elle lui achète du temps. Or ce temps, l’Argentine l’emploie. Vaca Muerta, poumon d’hydrocarbures qui hésitait à respirer, reçoit des signaux d’expansion : émissions obligataires d’YPF, TechPetrol, PlusPetrol, promesse de gazoducs et d’exportations, espoir d’une offre de dollars plus stable. À la campagne aussi, la rumeur d’une meilleure récolte de blé retisse la vieille alliance de la pampa et du Trésor. Si l’on additionne ces files de fourmis, on obtient un récit cohérent : croissance espérée en 2026, investissement qui se réveille, et, pour un instant, le souvenir d’avril 1991, quand la convertibilité donna dix ans d’oxygène avant la panne sèche.
Il y a pourtant dans la coque des points de fatigue que le vernis du moment ne doit pas dissimuler. D’abord, ce secret qui entoure l’accord avec Washington : clauses de confidentialité acceptées par l’équipe économique, informations distillées au compte-gouttes. Le marché aime le mystère tant qu’il fait baisser les spreads, puis il s’en méfie. Ensuite, ce calendrier de réformes qui ressemble à un chantier naval où l’on voudrait remettre le bateau à flot avant la marée : réforme du travail, réforme fiscale, réforme des retraites reportée au prochain mandat. Trois chantiers, trois récifs.
Au sommet du navire présidentiel, la passerelle du pouvoir s’est resserrée. Le gouvernail, naguère tenu à quatre mains, appartient désormais presque tout entier à Karina Milei, la sœur du chef de l’État, figure ombrageuse, silencieuse, mais d’une autorité farouche. Autour d’elle, le cercle s’est réduit, comme dans les vieux équipages quand la tempête menace : on renvoie les passagers, on garde les fidèles. Cette concentration du pouvoir n’est pas un hasard : elle marque la victoire de Karina sur Santiago Caputo, le conseiller occulte, le mago del Kremlin, cerveau de la communication présidentielle et architecte des alliances internationales du mileisme.
Depuis des semaines, entre la sœur et le stratège, les tensions montaient comme la marée. Caputo, homme des coulisses et des deals, tissait ses fils avec Washington et les milieux d’affaires ; il rêvait d’un pouvoir parallèle, d’un État d’ombres gouverné depuis les agences de communication et les cabinets de conseil. Karina, elle, voulait reprendre la barre, ramener le navire à son cap moral, celui de la fidélité au noyau libertarien et à la ligne pure de son frère. Ce duel feutré a tourné à son avantage : Caputo a perdu de son ascendant, ses relais dans la justice et la presse s’affaiblissent, et la Casa Rosada bruisse de la rumeur qu’il pourrait bientôt quitter le bord.
Derrière ce conflit de personnes se cache une lutte d’âme : d’un côté, la tentation du pragmatisme, du marchandage, du libéralisme mondain ; de l’autre, la fidélité au feu originel, à la geste messianique d’un homme qui veut purifier la politique argentine de ses compromissions. Entre la mer du pouvoir et le vent des idéaux, la passerelle tangue. Et si le bateau Milei tient encore sa route, c’est peut-être parce que cette rivalité, loin de l’affaiblir, lui donne pour l’instant la tension nécessaire pour avancer.
Le pont politique, lui, n’est pas un havre de paix. La sœur du président s’efforce de construire une majorité mouvante en grappillant des gouverneurs, en fendant les blocs péronistes, en négociant avec les syndicats une modernisation qui ne se dise pas casse sociale. L’entreprise demande patience et doigté. Les centrales, affaiblies dans un salariat formel devenu minoritaire, conservent assez d’influence pour ralentir, assez de mémoire pour résister. La justice, refuge traditionnel de la casta, offre aux intérêts installés un droit de veto discret et efficace. On peut gouverner contre l’opinion quelques mois, rarement contre les juges plusieurs hivers.
J’entends déjà l’objection : à quoi bon ces prudences quand les chiffres promettent des jours meilleurs ? Les nuages sont trompeurs, répétons-le, parce qu’ils empruntent la forme qu’on veut leur voir. L’Argentine a connu des aurores où l’on jurait qu’elle repartait vers son destin, et des crépuscules où l’on comptait les billets avant le soir. La vraie question n’est pas de savoir si l’état de grâce est réel, il l’est, mais s’il repose sur des assises qui ne soient pas seulement financières. Il ne suffit pas d’injecter de l’or dans les veines d’un organisme, encore faut-il que les tissus vivent.
Pour durer, la stabilisation doit s’infuser dans la vie quotidienne : prix qui cessent de danser, salaires qui arrêtent de se dissoudre, importations redevenues prévisibles, crédit qui revient pour des PME qui ne lisent pas les notes des brokers. La finance peut acheter du temps, elle ne fabrique pas la confiance seule. Celle-ci naît quand l’État devient intelligible, quand les règles cessent de bouger comme un banc d’anchois, quand le pouvoir renonce aux vieux réflexes : décret nocturne, taxe surprise, insulte aux contre-pouvoirs.
Reste la géopolitique, fil tendu entre la Casa Rosada et Washington. On exagère parfois la nouveauté des relations, on sous-estime leur sensibilité. Le Trésor américain n’offre pas ses filets pour les déchirer au premier courant contraire. Une diplomatie qui paraît réduite au binôme dollar-Israël demande une main plus fine que la communication triomphale. Les chancelleries, comme les marchés, n’aiment pas les zigzags.
Revenons une minute au réel, à la table où mijote le veau marengo. La cuisine enseigne une chose que les économistes oublient : rien ne prend sans feu doux. Trop vif, on brûle la sauce ; trop bas, on n’épaissit jamais. La politique économique est affaire d’intensité, de durée, de patience. L’Argentine a souvent cédé à la tentation de l’embrasement : plans éclatants, slogans en bandoulière, et s’est surprise à manger froid. Le moment Milei tient peut-être à ce qu’il a de moins spectaculaire : la discipline du change, l’obstination à rogner un déficit, la décision de ne pas se battre sur tous les fronts à la fois.
Je n’ignore pas la fragilité de la lune de miel. Les commentateurs scrutent le ciel, les uns y voient un cavalier d’Apocalypse, les autres un arc-en-ciel. Je préférerais qu’on regarde la mer, sa houle dit mieux l’avenir que les nuages. Si la houle baisse, si l’inflation consent à reculer franchement, si l’exportation de gaz et de céréales apporte un régime de dollars moins capricieux, si le Congrès laisse passer une réforme du travail praticable et un ordonnancement fiscal lisible, alors l’état de grâce cessera d’être un enchantement, il deviendra une saison.
Oswald Spengler aurait pu dire que les civilisations s’épuisent quand elles confondent destin et décor. L’Argentine possède ce génie de théâtre qui la perd parfois : elle sait faire lever le rideau comme nulle autre, elle doit maintenant apprendre à tenir l’acte. La finance a rallumé les rampes, les acteurs sont en place, le texte, lui, reste à écrire sur la durée.
Je range les casseroles, la viande a pris une belle couleur, le jus nappe comme il faut. Dehors, au-dessus du Guilvinec, le nuage a changé de forme. Je n’y lis rien de plus qu’un présage de vent. Pour Milei, l’heure est à ces œuvres qui ne font pas de bruit : régler le tempo, consolider la quille, garder le cap quand les passagers réclament la vitesse. Les bons capitaines ne promettent pas la mer d’huile, ils apprennent à la traverser.
Balbino Katz
Chroniqueur des vents et des marées
[email protected]







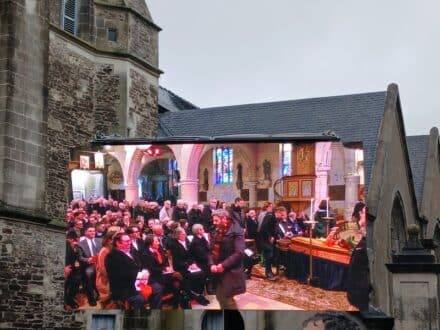






3 réponses à “Argentine, état de grâce ou simple éclaircie avant la tempête ?”
Après lecture de cet article très intéressant et fouillé comme à l’habitude, il ressort , en effet, que la politique , au fond, n’est que l’application de recettes avec plus ou moins de réussites selon les ingrédients utilisés et avec le chef qui se trouve aux fourneaux
Bon eh bien moi je ne suis que le roi des Patachons! J’imagine l’entrée du port de Guilvinec comme le Rio de la Plata …(justement j’envisageais une épaule de veau, recette maternelle, pour le passage de mes filles…)chut nous ne dirons rien à Rançon! il est trop méchant! Mais pourquoi s’est-il énervé? Qu’il vienne avec avec nous chez Gilou pour boire un coup!!!
Quelle recette d’épaule de veau ?