Pendant des années, le père Antoine Exelmans a été présenté comme l’un des visages les plus emblématiques d’un catholicisme tourné vers l’accueil des migrants. Originaire du diocèse de Rennes, volontiers sollicité par les médias et mis en avant pour son action auprès des exilés, il incarnait aux yeux de nombreux journalistes la figure idéale du « prêtre ouvert » engagé sur les questions humanitaires. Sa trajectoire s’est brutalement interrompue en 2024, lorsqu’une première plainte a été déposée au Maroc pour des faits d’abus sexuels sur mineurs. Depuis, les révélations s’enchaînent, au point de transformer celui qui était célébré comme un modèle en protagoniste d’un dossier extrêmement grave.
Un prêtre très engagé et très médiatisé
Ordonné en 1993, Antoine Exelmans alterne ses premières années entre la Bretagne et l’Afrique. Il séjourne notamment en Centrafrique, avant de revenir en Ille-et-Vilaine où il exerce tour à tour à Cesson-Sévigné, Maurepas, Mordelles ou encore comme aumônier des étudiants à Rennes. Dès cette période, il s’investit dans l’accueil de familles migrantes et cofonde l’association Tabitha Solidarité, destinée à accompagner des personnes en situation d’exil.
Au fil du temps, son discours s’affirme et devient omniprésent dans les médias : appel à une « mondialisation fraternelle », plaidoyer pour l’ouverture, défense du dialogue avec l’islam et dénonciation de la méfiance envers les flux migratoires. Plusieurs reportages et portraits très bienveillants lui sont consacrés. En 2020, un prix international récompense son engagement au Maroc. En 2024, il participe aux rencontres MED à Marseille et apparaît aux côtés de responsables ecclésiaux de premier plan.
À ce moment-là, rien ne semble pouvoir écorner l’image d’un prêtre présenté partout comme une référence en matière d’accueil des migrants.
Un départ précipité du Maroc et les premières alertes
Ce récit se fissure en mai 2024. Une plainte est déposée à Casablanca, où Exelmans dirige le service d’accueil des migrants de l’église Notre-Dame-de-Lourdes. Quelques semaines plus tard, alors que sa mission devait se poursuivre jusqu’en 2025, il quitte soudainement le pays. L’archevêché de Rabat évoque un « burn-out » et un retour en France pour « se reposer ». Parallèlement, une enquête interne est ouverte et la structure d’accueil qu’il supervisait est fermée.
Le diocèse de Rennes est rapidement informé que des comportements « laissant entendre » la possibilité d’abus auraient été signalés. L’information circule d’abord en interne, sans communication publique. Ce n’est qu’au début de l’année 2025 que la paroisse de Maurepas est alertée discrètement par courrier afin d’identifier d’éventuels témoignages.
Six jeunes migrants disent avoir été victimes
En novembre 2025, la presse marocaine publie les premiers éléments détaillés de l’enquête. Selon les informations recueillies par plusieurs journalistes locaux, au moins six jeunes migrants — un Camerounais et cinq Guinéens — affirment avoir subi des violences sexuelles entre 2021 et 2024. Tous étaient mineurs lors des faits.
Le prêtre aurait mis en place un système d’emprise en sélectionnant des jeunes en situation de forte vulnérabilité psychologique. Certains d’entre eux auraient été hébergés chez lui, sous prétexte de soins et d’accompagnement. Trois victimes ont déjà été entendues par la police judiciaire marocaine. Le prêtre, lui, a été auditionné en France. Il est aujourd’hui assigné à résidence dans une communauté religieuse à Saint-Étienne, en attente des décisions de la justice française et marocaine.
Une couverture médiatique étonnamment discrète
Durant plusieurs jours, en France, seul un média spécialisé catholique relaie l’affaire. Les rédactions nationales, d’ordinaire très promptes à couvrir les scandales impliquant des membres du clergé, restent muettes. Lorsque certains titres finissent par publier de courts articles, ils reprennent l’affaire de manière minimale, en insistant davantage sur ses actions humanitaires ou sur le catholicisme du prêtre que sur son rôle central dans les milieux pro-migrants.
Là encore, le contraste surprend. L’homme avait été abondamment mis en avant par les mêmes journaux lorsqu’il prônait un accueil inconditionnel des migrants et posait régulièrement pour la presse régionale. Son engagement politique et religieux en faveur des migrants, pourtant au cœur de sa trajectoire, est désormais souvent évacué ou réduit à une note de bas de page.
Une affaire qui interroge l’Église, les médias et les réseaux militants
L’enquête se poursuit à la fois en France et au Maroc, et de nouveaux témoignages pourraient encore émerger. Pour l’Église de Rennes comme pour le diocèse de Rabat, l’affaire est un choc majeur, qui pose la question de la supervision, des alertes internes et de la manière dont un prêtre a pu prendre en charge des mineurs particulièrement vulnérables sans contrôle suffisant.
Pour les médias, elle révèle un autre problème : l’asymétrie du traitement selon le profil idéologique des personnes impliquées. Antoine Exelmans avait été porté aux nues pour ses positions pro-migrants et pour son engagement dans le dialogue islamo-chrétien. Aujourd’hui, ces mêmes aspects, pourtant au cœur de sa mission au Maroc, sont passés sous silence.
Quant au milieu associatif lié aux migrations, l’affaire soulève des interrogations sur les mécanismes de contrôle, sur la place laissée à l’emprise individuelle et sur les risques de dérives dans un secteur où la vulnérabilité des personnes accueillies est extrême.
L’image du père Exelmans a changé du tout au tout en quelques mois. Son parcours, célébré pendant des années, est désormais examiné sous un angle totalement différent, au regard d’accusations d’une gravité extrême. L’enquête judiciaire devra déterminer précisément les responsabilités. Mais d’ores et déjà, l’affaire met en lumière un prêtre longuement soutenu, médiatisé et récompensé, dont les dérives présumées n’ont été révélées que très tardivement.
Crédit photo : OJIM
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine







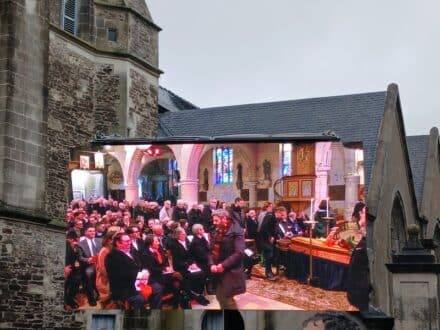






6 réponses à “Affaire père Antoine Exelmans et pédocriminalité : ascension médiatique, militantisme pro-migrants et chute retentissante d’un prêtre breton”
Merci
Vite une loi sur le biocide dont l’article premier interdirait l’abus sexuel , psychologique et mental sur les enfants et adolescents . Ces atteintes majeures dès l’enfance sont la quintessence ( les cinq sens sont atteints de façon pérenne troubles ; ce biocide doit être qualifié d’assassinat et recevoir une peine incompressible . Sur le fronton de chaque institution devrait figurer cette interdiction absolue ; ce tabou indépassable suivi de la mention suivante : le viol d’enfant n’est jamais un acte d’amour .
Un prêtre son travail c’est de distribuer les sacrements, de prier bcp, de s’occuper des âmes des fidèles mais pas de s’occuper des migrants il y en a suffisament qui le font, les curés qu’ils commencent par faire leur vrai boulot, et là il y aura moins de problèmes sinon il vont dans une ONG et défroquent. Parfois une bonne tarte de la part de l’évêque (s’il est un vrai évêque)leur remettrait les idées en place
Sans mot, quel choc! j’ai eu la chance ds le cadre professionnel de croiser son père Baron Jean François EXELMANS, père de 7 enfants,et fier en 1988/1989 de dire que son fils était séminariste…. Heureusement « malheureusement » je vois que cet HOMME fin,son père , est DCD en 2023… ça aurait été terrible pour lui ..quand on connaît l arbre généalogique de la famille…
Rien lu sur ce bon prêtre sur Boulevard Voltaire… Véronique Jacquier et Gabrielle Cluzel doivent se concerter pour savoir s’il faut en parler !
J’avoue que ce dossier (ouvert depuis déjà quelques temps) m’étonne au plus haut point.
J’ai connu et longtemps fréquenté cette famille et je connais chacun des 7 enfants… Et, comment dire ? un élément cloche énormément dans ce dossier… et m’interpelle : le fait que ce soit uniquement des garçons, des migrants de surcroît et uniquement à l’étranger, qui accusent…
Pourquoi cela cloche ?
Il y a un peu plus de trente ans, Antoine avait la réputation unanime d’être très beau garçon. Je me rappelle d’ailleurs une amie, elle-même « canon », m’avoir dit un jour ou Antoine me rendait visite : « lui au séminaire ??? Quel gâchis ! »
Alors certes, on pourrait penser qu’il était alors insensible au charme féminin… mais… parce qu’issu d’une famille dans laquelle le scoutisme était très présent et où chaque enfant avait une forte propension à donner de son temps au service des autres, je me demande pourquoi on n’a pas obtenu de plaintes émanant de jeunes parmi tous ceux qu’il a fréquentés en France ?
Quand un homme a des pulsions de ce genre, elles ne sont pas intermittentes au point de ne chatouiller que sous d’autres latitudes et uniquement certaines années !
Je les ai tous perdus de vue depuis pas mal d’années maintenant, notamment après mes propres années d’exercice sur le continent africain ; et vraiment, je trouve tout cela bien étrange…
Je ne veux pas l’innocenter et je suis également de l’avis de « gaudete » à propos du « travail » d’un prêtre…mais en Afrique j’ai aussi vu des vies de religieux brisées après de faux témoignages portés contre eux parce qu’ils refusaient d’obtempérer à certaines requêtes… Alors prudence !!! car cela pourrait tout aussi bien relever d’une cabale.
L’avenir nous dira le reste…. tout au moins je l’espère, à la fois pour lui, pour sa famille mais aussi pour les victimes présumées et pour l’Eglise.