Être vieux, disait mon père, c’est comme voir l’Histoire faire du surplace, les bras en croix et le regard vide. L’expérience, si l’on veut bien s’y attarder sans céder à la tentation des facilités morales, permet au contraire d’apercevoir derrière les secousses du présent la respiration profonde du temps long, cette marée invisible que les nations surfent ou subissent.
C’est ainsi qu’en observant les décisions économiques prises par les États-Unis en cette année 2025, notamment leur renoncement ostensible au dogme du libre-échange, on ne peut s’empêcher de songer à un précédent vieux de plus d’un demi-siècle : le 15 août 1971, jour où le président Nixon suspendit la convertibilité du dollar en or, enterrant du même geste les accords de Bretton Woods. Je me souviens très bien d’avoir lu cette nouvelle dans un article du quotidien espagnol ABC, sans bien entendu en comprendre alors la portée. Ces deux décisions, distantes d’un peu plus de cinquante années, révèlent le même réflexe d’un empire qui, sentant vaciller les piliers de sa domination, préfère renverser la table plutôt que de céder le moindre pouce de son hégémonie.
À ceux qui voudraient y voir une quelconque trahison des « principes américains », je rappellerai ce mot célèbre de Groucho Marx : « Ce sont mes principes, mais si vous ne les aimez pas, j’en ai d’autres. » L’humour juif new-yorkais a ceci de précieux qu’il en dit long, en peu de mots, sur les contorsions d’un ordre qui ne se veut contraint que par ses intérêts. Depuis 1945, les États-Unis au faîte de leur puissance ont imposé au monde un double axiome : suprématie du dollar d’un côté, évangile du libre-échange de l’autre. Deux piliers jumeaux, mais inégalement stables.
Le premier à flancher fut le plus ancien. En 1971, alors que la guerre du Vietnam engloutissait des flots de dollars, que l’Europe et le Japon retrouvaient des forces industrielles et que la France du général De Gaulle exigeait le remboursement de ses excédents monétaires en or véritable, les États-Unis se retrouvèrent pris à leur propre piège. Faute de réserves suffisantes pour garantir la parité or-dollar, Nixon opta pour un coup de théâtre : il ferma la « gold window », déclenchant un séisme monétaire dont les répliques retentirent jusqu’au sein du FMI. S’en suivit une décennie d’inflation, de désordre monétaire, de chocs pétroliers et de spéculation effrénée qui ont animé mes années d’étudiant. Le monde découvrait alors que la stabilité promise par l’oncle Sam ne tenait qu’à un fil… ou plutôt à un billet vert non convertible.
2025 n’est pas 1971. Pourtant, l’écho est indéniable. Donald Trump, revenu au pouvoir comme un vieux lion décidé à mordre une dernière fois, a pris acte de ce que le libre-échange n’est plus un instrument de puissance américaine, mais son tombeau. À quoi bon prêcher la mondialisation quand vos ports débordent de marchandises étrangères, vos usines ferment, et que votre déficit commercial atteint des sommets himalayens ? En imposant des droits de douane massifs, les États-Unis n’inaugurent pas une ère nouvelle ; ils ferment la porte derrière eux et retournent aux instincts protectionnistes d’avant la Seconde Guerre mondiale, à l’époque du Smoot-Hawley Act et de la grande dépression.
L’on se méprendrait pourtant en y voyant une perte de contrôle. Bien au contraire : comme en 1971, il s’agit d’un acte de souveraineté pure, d’une volonté de puissance assumée qui refuse les compromis multilatéraux. Carl Schmitt nous a appris que la souveraineté, c’est décider de l’état d’exception. Les États-Unis, fidèles à leur génie politique profond, décident à nouveau : ce n’est plus l’or ni le marché, c’est la volonté nationale qui prime. L’Amérique se délie de ses engagements non pas par faiblesse, mais pour réaffirmer, dans une sorte d’unilatéralisme musclé, sa prééminence.
En ce sens, et c’est là un paradoxe cruel, nous devrions presque les en remercier. Comme en 1971, cette rupture de pacte nous oblige à repenser nos dépendances. La fin de la convertibilité a fini, vingt ans plus tard, par nous donner l’euro. L’abandon du libre-échange, couplé à un désengagement américain de notre défense commune, pourrait enfin réveiller chez les Européens ce vieux sursaut de souveraineté que l’on croyait définitivement enseveli sous les sédiments de Bruxelles. L’Histoire ne fait pas de cadeau, mais parfois elle tend une perche.
On le voit bien : les causes diffèrent — crise monétaire d’un côté, confrontation commerciale de l’autre — mais les effets convergent. Dans les deux cas, l’ordre mondial sort ébranlé d’une décision unilatérale américaine ; dans les deux cas, la confiance dans un système reposant sur la bonne foi de Washington s’effondre ; dans les deux cas, l’inflation — ce monstre toujours tapi dans l’ombre — revient roder, attisée par le dérèglement des flux.
Dans ce contexte, les Européens seraient avisés de ne pas se contenter de protestations stériles. Ils devraient, au contraire, puiser dans ces bouleversements la matière d’un projet renouvelé. L’écrivain Guillaume Faye, naguère honni et aujourd’hui presque prophète, aurait pu en appeler à une « Arche-Identité » européenne, capable de survivre au naufrage de l’occidentalisme mondialisé. Si ce moment de rupture ne nous en donne pas l’occasion, alors rien ne nous le donnera.
Oui, les États-Unis changent de principes comme on change de cravate. Oui, leur leadership se fait erratique, brutal, parfois cynique. Il serait toutefois puéril d’en concevoir de l’indignation. Le propre des grandes puissances est d’agir selon leurs intérêts. C’est à nous, les vassaux lucides, de choisir entre le suivisme impuissant et l’émancipation.
Qu’on me permette, pour finir, une image inspirée par mon port d’adoption : le commandant d’un voilier change de cap quand le vent tourne. Un mousse, lui, attend les ordres. L’Europe doit cesser d’être un mousse.
Balbino Katz — chroniqueur des vents et des marées —
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine








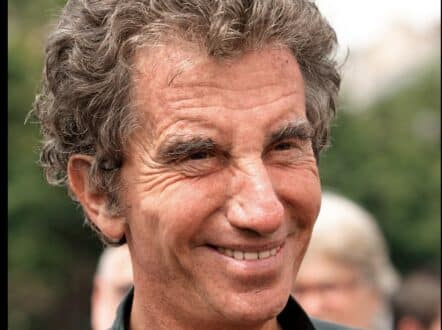


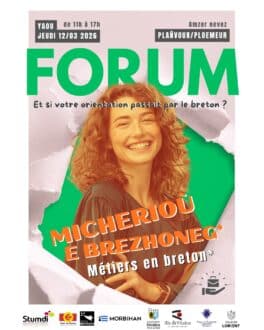


2 réponses à “L’Amérique et ses principes jetables : 1971 – 2025, deux secousses telluriques dans l’ordre économique mondial”
Bon j’ajoute l’explicatif aux droits de douane qui sont le reflet économique et financier que l’équipe de Mr Trump veulent faire soit 2000 milliards d’économie de dépenses des USA. Tous doit être revu à la baisse des budgets OTAN, OMS, ONU USAID même supprimé. Puis Les 860 bases militaires budget de défense des USA est de 1010 milliards voté par Trump pour 2025. Donc selon les Etats Unis tout ce système c’est la sécurité mondiale et donc le dieu dollars la suprématie monétaire pour la stabilité du monde financier pour tout ce qui est exprimé en dollars.En gros c’est 1800 millions de milliards. Donc tous les pays occidentaux doivent participer aux frais de tout ce bazar, dont on a nullement besoin puisque les BRICS ne se font pas la guerre entre eux. Ou alors c’est pour les martiens qui pourraient nous attaquer. Comme les petrodollars qui sont la sécurité donnée par les USA pour les monarchies du golfe Persique pour le gaz et pétrole. Alimentant de fait la masse monétaire du dollars qui permet la spéculation et la cotation des matières premières. Alors l’Europe ne faisant pas partie des BRICS doit payer une royaltie sous forme de droit de douane. Pour les autres pays des BRICS c’est une autre histoire à suivre, ou une guerre contre la Chine et la Russie, que l’Europe veut continuer en allant nul part.La Russie et la Chine alliées, ne reviendront jamais dans le système de Ponzi dollars sur endetté.
« Ces deux décisions, distantes d’un peu plus de cinquante années, révèlent le même réflexe d’un empire qui, sentant vaciller les piliers de sa domination, préfère renverser la table plutôt que de céder le moindre pouce de son hégémonie. »
Ils sont comme le joueur de poker qui voyant qu’il perd retourne la table et provoque de ce faite une bagarre ; nous devons reprendre nos cartes et faire en sorte de ne plus invité ce mauvais joueur a notre table.