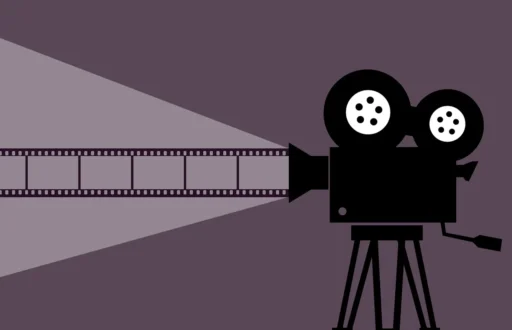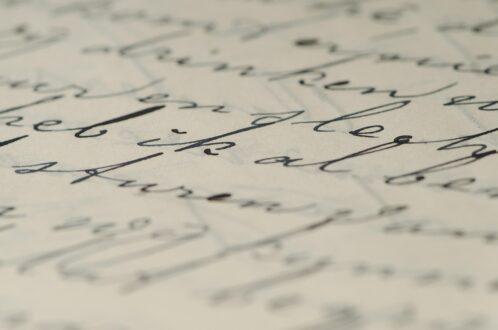C’est un étrange rituel que celui auquel se livre Marine Turchi dans les colonnes de Mediapart, comme si, en feignant de ne pas voir ce que chacun constate, elle espérait raviver un feu désormais consumé. Cinq ans après la mort de George Floyd, l’auteur consacre un long article, non pas à l’analyse lucide d’un phénomène sociopolitique majeur des années 2020, mais à la célébration nostalgique d’un moment insurrectionnel où les passions prirent le pas sur la raison, et la liturgie militante sur l’examen des faits. Le lecteur de bonne foi y cherchera en vain la moindre mention des échecs patents du mouvement Black Lives Matter (BLM), des violences qui l’ont accompagné, des dérives financières de ses dirigeants, ou des conséquences délétères de ses slogans sur les politiques publiques.
Ce qu’on appelle désormais le mouvement BLM ne fut jamais un mouvement social au sens noble du terme, mais une opération idéologico-médiatique, habilement mise en scène au moment d’un confinement mondial où les foules oisives, captives des réseaux et des émotions, se laissèrent séduire par les images d’un martyr postmoderne. George Floyd, repris de justice, mort tragiquement mais non innocemment, devint le nouveau saint séculier d’un culte de la victime. Le slogan Defund the Police — qui eût été accueilli par des rires homériques dans la France de Clemenceau — fit florès dans les mairies démocrates américaines, avec des résultats calamiteux. À Minneapolis, épicentre de la révolte, la criminalité explosa, les habitants des quartiers populaires — Noirs en majorité — demandèrent le retour de la police, et les élus qui avaient flatté la colère des foules furent chassés par les urnes.
Or de tout cela, Mediapart ne dit mot. Madame Turchi évoque pieusement des lettres jaunes peintes sur l’asphalte et des roses jaunes déposées sur une place rebaptisée, mais se garde bien d’examiner ce que ces signes ont produit, en dehors du pathos symbolique. On ne saurait imaginer caricature plus achevée de l’intellectuel organique à la française, pour qui l’Amérique ne saurait être qu’un grand théâtre progressiste où se jouent les luttes que Paris n’a pas le courage d’entreprendre. Elle déplore la disparition des slogans dans l’espace public, comme si le recouvrement d’un marquage de rue était une preuve de régression morale, oubliant qu’une société ne se gouverne pas à coups de hashtags.
Quant aux faits — les seuls qui devraient guider un observateur sérieux — ils sont absents ou relégués au rang d’anecdotes. Ainsi des statistiques du FBI, ignorées ou dédaignées, alors qu’elles dessinent un tableau bien différent de celui que nous dépeint la journaliste. En 2023, les homicides interraciaux indiquaient que les Noirs, 13 % de la population, étaient responsables de 566 homicides de Blancs, contre 246 dans l’autre sens. Rapportés à la démographie, cela signifie qu’un Noir a en moyenne dix fois plus de chances de tuer un Blanc qu’un Blanc de tuer un Noir. Ces chiffres, ignorés par les médias engagés, sont pourtant massivement relayés sur les réseaux, alimentant ce que l’on nomme désormais la Black fatigue : ce sentiment, diffus mais croissant, d’exaspération d’une partie de la population blanche — y compris d’anciens soutiens de BLM — face à une criminalité perçue comme tolérée, excusée, ou minimisée dès lors qu’elle vient des « bons » opprimés.
À cela s’ajoute le scandale — là encore passé sous silence — des finances de la BLM Foundation. En 2021, l’organisation récolte près de 80 millions de dollars. Deux ans plus tard, ses comptes affichent un déficit abyssal, et les dirigeants sont accusés d’avoir détourné des sommes considérables pour acheter des villas de luxe, financer des modes de vie mondains, et soutenir des causes personnelles sans lien avec les objectifs initiaux. Que resterait-il d’un mouvement nationaliste ou conservateur pris dans une affaire comparable ? Rien. Et pourtant, BLM continue de bénéficier, dans certains cercles médiatiques, d’une indulgence suspecte, celle-là même que Carl Schmitt nommait l’ami politique, ce complice idéologique dont les fautes sont des vertus mal comprises.
Marine Turchi ne veut pas voir non plus que la sanction de l’opinion a déjà eu lieu. Sans évoquer l’élection de Donald Trump (horresco referens), les procureurs et élus qui, entre 2020 et 2022, surfèrent sur la vague BLM, en criminalisant la police et relâchant les délinquants, ont été balayés lors des scrutins locaux. À San Francisco, à Chicago, à New York, les électeurs ont rejeté l’anarchie compassionnelle. Le réel, comme toujours, a repris ses droits. Et pourtant, Mediapart s’obstine à croire qu’il suffit d’évoquer Nelson Mandela, quelques t-shirts à l’effigie de Floyd, ou des citations de professeurs militants pour raviver l’élan d’un soulèvement dont les effets ont été à la fois ruineux et déceptifs.
On chercherait en vain, dans ce long panégyrique, une seule ligne consacrée aux morts des émeutes — plus d’une vingtaine en 2020 —, aux centaines de commerces détruits, ou aux quartiers ruinés par des semaines de violence. On n’y trouve pas davantage d’analyse des effets délétères de cette stratégie victimaire sur les relations interraciales, aujourd’hui plus tendues que jamais. Le mouvement qui devait réconcilier a en réalité divisé, enfermé les communautés dans une logique de ressentiment perpétuel, où chaque désaccord devient une preuve de racisme, et chaque crime une preuve d’injustice structurelle.
En fin de compte, l’article de la Miss Turchi ressemble moins à une enquête qu’à une oraison funèbre rédigée par un clerc idéologique pour qui le deuil n’est pas celui d’un homme mais celui d’un levier militant. Car BLM, dans sa version 2020, n’a jamais été qu’un moyen d’ébranler la société américaine en frappant son fondement : la légitimité de l’ordre. C’est cela, et non la mort de Floyd, que Marine Turchi regrette. Et c’est ce deuil, non d’un homme mais d’une illusion politique, qu’elle tente de masquer par des fleurs roses, des slogans creux et des souvenirs frelatés.
Balbino Katz — chroniqueur des vents et des marées —
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine