Ce fut au bar l’Océan, à l’enseigne ornée d’un chalutier, juste en face du bâtiment de la criée du Guilvinec où un de mes oncles fut longtemps capitaine d’armement, que j’ai fait la connaissance autour d’un verre de blanc d’un jeune retraité qui avait bourlingué dans un univers bien éloigné des chalutiers : celui du commerce international des denrées alimentaires. Il avait jadis œuvré chez Louis Dreyfus Company, cette maison fondée en 1851 par Léopold Louis-Dreyfus, toujours debout, toujours conquérante, et qui demeure l’un des cinq géants planétaires du négoce agricole, aux côtés d’ADM, Bunge, Cargill, et parfois Glencore. Notre conversation s’anima soudainement lorsque je lui confiai qu’étudiant, j’avais rêvé d’entrer chez eux comme d’autres rêvent de l’École navale, ou, à défaut, d’aller exporter des pâtés aux anglais chez Hénaff, à Pouldreuzic.
Il me parla alors d’un phénomène discret mais profond, un de ces glissements tectoniques qui échappent au commun mais que les initiés pressentent : l’effritement du rôle hégémonique des États-Unis sur le marché mondial du blé. Ce blé d’Amérique, autrefois « standard-or » de la planète farine, n’est plus ce qu’il fut. Il semble que les moulins de Manille, de Milan ou de Mexico n’en veulent plus comme avant. Il ne s’agit point d’une querelle de prix, ni d’une de ces crises passagères nées d’une mauvaise récolte ou d’un coup de froid sur les Plaines. Non. C’est plus grave. C’est une question de confiance, de logistique, de traçabilité. En un mot : de crédibilité.
Le phénomène, amorcé subrepticement durant l’été 2024, s’est amplifié en 2025 : le Canada, l’Australie et même l’Argentine captent désormais une part croissante des marchés jadis tenus d’une main ferme par les blés du Kansas et du Dakota. Les acheteurs, de Séoul à Jakarta, se détournent du Chicago Board of Trade pour lui préférer Winnipeg, Melbourne, ou Rosario en Argentine. Et dans les ports d’Europe, le blé américain subit désormais les affres d’un regard suspicieux : défauts dans les certificats carbone, irrégularités dans la traçabilité, taux de glyphosate flirtant avec l’intolérable. À Rouen, à Gênes, à Yokohama, les silos s’emplissent de grains venus d’ailleurs.
Les causes de ce désamour sont nombreuses, mais elles convergent. D’abord, l’Amérique n’est plus perçue comme fiable. Ses ports sont devenus capricieux, son administration versatile, et ses conflits internes, ces guerres de papiers entre Washington et ses partenaires, ralentissent les flux. Ensuite, l’Europe, avec son CBAM et sa religion de la traçabilité, réclame désormais des preuves numériques, des QR codes, des bilans carbone par silo et par train. Le Canada, pragmatique et méthodique, a su répondre présent. L’Australie, disciplinée et lointaine, a séduit par sa stabilité. L’Argentine, enfin, s’est engouffrée dans la brèche, armée de sa proximité géographique avec le Brésil et d’un savoir-faire agricole modernisé.
Ainsi, en Indonésie, les meuniers de Bogasari troquent le Hard Red Winter pour du blé australien, moins chargé en pesticides, plus prévisible. Au Japon, les moulins préfèrent désormais Fremantle à Portland, par prudence sanitaire. À Mexico, les camions canadiens franchissent les frontières plus vite que ceux de leurs voisins du Nord, englués dans les contrôles et les tensions migratoires. Même en Corée du Sud, le glyphosate fait peur : on teste, on reteste, et l’on finit par acheter canadien. La mécanique s’enraye. La confiance, une fois rompue, met longtemps à se réparer. Comme le notait déjà Ernst Jünger, dans La Paix, « ce qui s’effondre n’est pas nécessairement ce qui est faible, mais ce qui cesse d’être croyable ».
Dans les grandes plaines du Midwest, les silos débordent. Le prix chute. Les fermiers tirent la langue, le cœur amer, car le monde n’attend pas. À Washington, le ministère de l’Agriculture tente bien de réagir, avec un projet de loi sur la fiabilité logistique, un plan pour numériser les certificats et fluidifier les données. Mais la machine législative s’embourbe dans les couloirs du Capitole. Et pendant ce temps, les contrats s’envolent vers d’autres latitudes. Même les Italiens, ces fidèles du blé dur américain, se tournent vers le Canada pour leurs pâtes, vers la Roumanie pour leurs farines.
Il ne s’agit pas ici de pleurer sur le sort de l’Amérique, ni de célébrer celui de ses concurrents. Ce qui est en jeu, c’est le basculement discret d’un monde. Le marché du blé, comme la monnaie ou le pétrole, n’est pas qu’un marché : c’est une forme de souveraineté. Et quand cette souveraineté se délite, quand le blé cesse d’être une promesse tenue, alors d’autres puissances se lèvent. Comme le soulignait Guillaume Faye dans L’Archéofuturisme, les empires ne chutent pas sous l’effet d’un coup de canon, mais d’une érosion interne, silencieuse, imperceptible, jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
Le blé américain était un gage. Il est devenu un doute. Et les moulins du monde entier, ces sentinelles tranquilles du goût et de la tradition, ont déjà tranché.
Balbino Katz — chroniqueur des vents et des marées —
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine












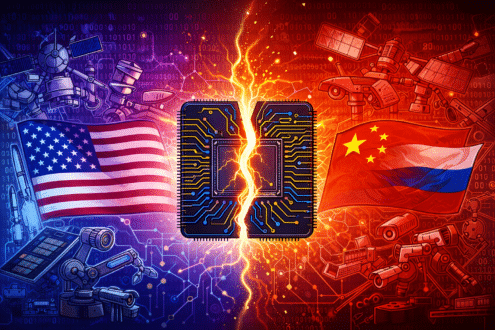

Une réponse à “Le vent tourne pour le blé américain”
Bonjour et merci de cet article qui se lit … comme un roman.
Donc la culture américaine porte enfin ses fruits?
Le mensonge, le mépris de la vie d’autrui et l’empoisonnement, n’ont plus cours?
Enfin… n’ont plus exactement le même cours?
Eh bien, ce n’est pas tout à fait une mauvaise nouvelle.
Et cela redonnerait même un peu d’optimisme.
En particulier à l’heure où nos chers- tellement chers que c’est à se demander s’ils en valent le coût- députés européens ont refusé de voter la motion de censure contre «von der Layette ».
Oui, c’est une douce brise pour les voiles des résistants.