La route qui mène à Aups depuis Salernes, en cette fin de matinée de juillet, est un enchantement lent, tissé de lumière et de parfums. Elle serpente avec grâce dans un paysage de collines douces, et voici qu’au détour d’un virage, les premiers champs de lavande apparaissent, ourlant les bords de la route de leurs bouquets violets. L’air, saturé d’arômes, a cette densité presque sacrée des matins provençaux. Le silence du moteur électrique est seulement troué par le crissement des pneus. On songe à Giono, bien sûr, à ses paysans noueux dont les mots sentaient le cuir et la pierre, et à Joseph d’Arbaud, poète des gardians et des bêtes à cornes, qui, lui aussi, savait que le vent du Midi est une parole.
À l’approche du bourg, Aups se dévoile comme un coquillage ancien oublié sur le rivage d’un autre temps. À deux pas de la placette centrale, au parking en face de la piscine municipale, une place libre nous attend, offrande du hasard ou clin d’œil complice d’un village habitué à faire plaisir à ses visiteurs. De là, c’est tout un monde qui se déroule : les maisons aux murs patinés, les volets bleus un peu délavés, les treilles enroulées autour des balcons, comme pour retenir le soleil.
C’est jour de marché. La place vibre d’un mouvement tranquille, loin des emballements hostiles de ces banlieues grises où l’on n’aime guère la daube de sanglier ou les pieds paquets, ces plats d’un autre âge où le cochon, sacrifié, disait la joie d’un repas partagé. À Aups, on ne se presse pas. On choisit ses olives une à une, on goûte un morceau de saucisson, on compare les melons. Et on devine que, jadis, le provençal s’y glissait entre deux paroles, comme un souvenir d’enfance dans la voix d’un grand-père. Aujourd’hui, les phrases sont simples, les échanges sincères, et c’est peut-être cela la vraie poésie : l’absence de bruit inutile.
Les rues du village nous sollicitent, comme un ruisseau attire les pas d’un promeneur sans but. Elles montent, descendent, tournent, s’ouvrent sur des placettes inattendues, des recoins secrets. Une vieille porte voûtée, une niche à la Vierge, une fontaine moussue. Les volets, souvent bleus, sont clos mais pas hostiles. Ils parlent d’intimité, de discrétion, de ce refus du tapage qui est peut-être la dernière forme de l’élégance. Quelques inscriptions en noir sur les murs faisant des rappels à la loi laissent suggérer que ces murs n’ont pas été repeints depuis que le tocsin a sonné en 1914 la fin de notre monde.
Au terme de notre visite méridienne, il fallut bientôt nous mettre en quête d’un lieu pour déjeuner. Une faim calme mais décidée, celle du promeneur qui ne veut pas se contenter d’un panini mou ou d’une assiette à touristes. Coup d’œil sur Google Maps, eh oui, même les hommes du passé finissent par s’incliner devant l’oracle numérique. Et voilà qu’apparaît en tête Chez ta mère, nom bravache s’il en est, pour ne pas dire oulipien, et flanqué d’une note stupéfiante : 4,9 sur 5, fondée sur plus de cinq cents avis.
Je me méfie. Les notations enthousiastes ont parfois l’accent louche des républiques bananières. Je cherche donc à recouper. Avis de guides locaux ? Même musique admirative. On parle d’une cuisine sincère, de vins sans prétention, d’un accueil chaleureux. Bon, on se dit prenons le risque, d’autant qu’il est déjà 13h30, et que le restaurant, selon ce même oracle digital, n’accepte plus de clients après 14h. C’est le genre de détail que je respecte : j’ai trop vu de tables mal servies pour avoir été dressées à l’heure où la brigade pensait plier les torchons.
Nous nous faufilons donc à travers les dernières effluves d’un marché qui remballe ses tréteaux, saluons au passage l’armurerie Montbarbon, dernier bastion d’un monde où l’homme savait encore tenir un fusil, et enquillons tranquillement la rue Gabriel Péri. Au bout, la place Général-Girard, un nom ronflant pour une placette paisible. Là, le bar «Chez ton père» s’offre au regard, avec son humour de zinc. Mais où donc se trouve la mère ?
Elle est là, bien sûr, mais l’enseigne est cachée sous une profusion de parasols crème qui dissimulent la façade comme les plumes d’un paon fatigué. On n’ose pas s’avancer trop vite, de peur de troubler une terrasse concentrée sur ses flacons et ses assiettes. Alors nous hélons un serveur au visage sympathique pour lui demander si l’on sert encore. Il répond par une affirmative joyeuse et nous propose deux places côte à côte, pile face à une petite fontaine au chant discret, comme il sied aux fontaines provençales qui ne veulent pas déranger les conversations.
Je m’étonne : « Mais la limite de 14h, annoncée par Google ? » Le garçon sourit. « C’est pour éviter les importuns qui débarquent à seize heures passées, s’installent avec l’air conquérant de ceux qui pensent tout devoir, et exigent une entrecôte saignante pendant qu’on balaie la salle et qu’on songe à rentrer à la maison. » Voilà une parole juste. Une parole humaine.
Nous nous installons. L’air est tiède, l’ombre des parasols palpite légèrement, les assiettes passent, généreuses et colorées. À la table voisine, on parle de vignes. À celle d’en face, un jeune couple rêve d’avenir. Lui est Américain, elle est russe. On leur souhaite la paix. Nous, on est bien car l’heure de pointe est passée. Il y a du monde, oui, mais point de foule. On respire. C’est une de ces heures bénies où la clameur du service laisse place à la respiration tranquille des lieux habités. Le personnel sourit sans précipitation. Les convives mâchent, devisent ou rêvassent. Le monde reprend son rythme humain.
Notre serveur est un homme jeune, affable et engageant, au regard clair, au ton juste. Il possède cette science rare de ceux qui ont compris que le service est une chorégraphie morale : chaleureux, ma non troppo. Il s’adapte à l’humeur de ses hôtes avec l’élégance des vrais professionnels. Avec les empathiques, il engage la conversation ; avec les solitaires, il leur tient compagnie sans intrusion ; avec les hurons, ces visiteurs bruyants, dépaysés mais exigeants, qui parlent fort dans toutes les langues sauf celle du lieu et du coeur, il respecte stoïquement leur désir de voyante prépotence. C’est un métier.
Nous sommes assis face à la fontaine, dont les jets d’eau, discrets mais précis, jouent cette musique légère qu’on entend dans les patios de l’Alhambra de Grenade, les Maures en moins, Dieu merci. L’eau chante, non pas comme une sirène mais comme une musique ancienne, revenue d’un autre siècle, dont chaque vibration, à peine perceptible, ranime la cendre tiède d’un monde effacé.
Sur la margelle de la fontaine, un panneau au lettrage manuel : eau non potable. Sans doute pour encourager la consommation de quelque vin local, blanc ou rosé, ces élixirs pâles que le soleil d’ici rend presque spirituels. Car même à l’ombre bienfaisante des grands parasols, et malgré la fraîcheur dégagée par la proximité de l’eau, la chaleur impose ses lois. On ne sort d’elle que par le biais d’un verre.

Arrivent alors quelques rôties, dorées, craquantes, servies avec une sauce rouille d’une intensité méridionale, à la fois iodée et piquante, qui est l’accélérant exact d’une soif inextinguible — une soif pareille à ces incendies de forêt qui, plus bas dans la vallée, ravagent les garrigues et font fuir les chevreuils. Il faut agir vite. Il nous faut un hydrant, et non une gourde. Une source, pas un filet.
Et voici qu’apparaît notre sauveur, tel un porteur d’eau au seuil du désert, qui dépose sur notre table un pichet de blanc. Il est frais comme la salvation de l’âme, embué juste ce qu’il faut, et sa blancheur trouble annonce une vivacité sans acrimonie. Nous trinquons, sans un mot. Car certains silences sont des prières.
Le menu, qu’on nous pose directement sur la table, fait office de nappe. Il est court, lisible, sans ces prétentions romanesques qui transforment parfois les cartes de bistrots en nouvelles mal écrites de toqués prétentieux. Ici, point de jargon culinaire. Quelques pains à la viande, des salades, des assiettes. Voilà tout. Et c’est tant mieux. La brièveté oblige à décider, et non à hésiter.
La composition des salades détaillées dans le menu, reconnaissons-le, ont cet aspect mathématique propre aux assemblages de pièces de Lego : tout y est distinct, compartimenté, en couleurs nettes. Pourtant, elles sont bien pensées, diverses, adaptées aux goûts les plus divers, et proposées à 12 euros, prix rare pour qui a récemment mis le pied dans une grande ville.
Les pains à la viande, eux, sont la seule vraie concession de la maison à l’air du temps. Ce sont des sandwiches chauds, garnis de viandes honnêtes, présentés avec sérieux. Un léger froncement de sourcil peut toutefois apparaître, comme ce fut mon cas, à la lecture du mot «cheddar» dans la liste des ingrédients. Qu’allait faire, dans cette galère, ce fromage d’Albion ? Je ne suis pas de ceux qui dénoncent les Anglais à chaque tournant, mais tout de même : du cheddar dans le Haut-Var ?
Les assiettes, elles, tiennent leur promesse : des plats simples, rustiques, efficaces. Camembert rôti, andouillette, steak haché ou filet de poulet. Rien de révolutionnaire, mais tout est là pour combler une faim réelle, pas une nostalgie de carte étoilée.
La décision se prend sans effort : je choisis l’andouillette, fidèle à mon goût pour les mets que la modernité néglige ; mon convive opte pour une bruschetta, cette tartine méridionale qui, bien exécutée, dit le soleil mieux que bien des poètes.
Le service est rapide et généreux. Les frites sont chaudes, croustillantes, elles chantent sous la dent. Le pain est bon. L’andouillette , savoureuse. Et nous, nourris, rafraîchis, à la fois par la fontaine et par le vin blanc, nous nagions dans ce bonheur tranquille que donnent les plaisirs simples de la vie, lorsqu’ils sont servis sans apprêt mais avec justesse.
Et c’est là que survint le vrai dessert, non pas sur l’ardoise, mais à notre table : le contact avec l’équipe de Chez ta mère. Le serveur, aimable et urbain, n’était que le sommet de l’iceberg, l’avant-poste de cette petite troupe. Un éclaireur, pourrait-on dire, la sonnette (pour écrire comme Gaston de Galliffet dans « Aux avant-postes de la cavalerie légère »,) qui capte le souci avant qu’il n’ose se produire.
La fin du service approchant, les langues se délient. La patronne nous rejoint, son époux qui a en charge Chez ton père, l’abreuvoir d’en face, s’assied un instant, la jeune apprentie forestière, qui passe son été derrière les fourneaux pour gagner quatre sous, vient souffler un peu. Les autres membres de la brigade passent, plaisantent, s’arrêtent une minute. On nous parle sans forcer, comme à des voisins, non comme à des clients. Et, tout à coup, tout s’éclaire.
Nous comprenons la cohérence des notes élogieuses : une carte simple, bien pensée, servie avec générosité, par des gens présents à ce qu’ils font, qui donnent du sourire sans l’acheter, et dont l’hospitalité a le goût de l’authentique, non du frelaté.
Il y a, dans cet endroit nommé pour faire rire, une gravité discrète du métier bien fait, une petite musique de justesse. On y vient pour manger, et l’on repart rassasié, respecté, et un peu consolé du monde.
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine









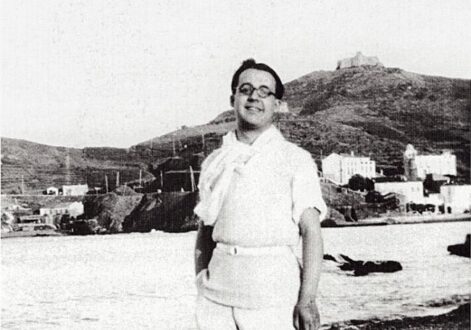
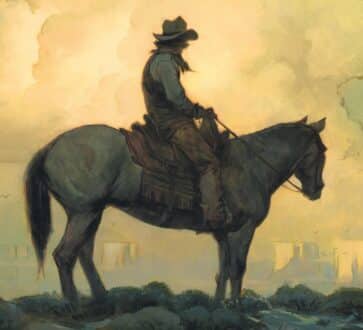



7 réponses à “Chez ta mère à Aups, les fontaines chantent comme celles de l’Alhambra, mais les Maures en moins”
Bonjour
article remarquablement écrit. De la justesse, de la poésie, un appétit pour les expressions qui émeuvent et rendent hommage.
On cerne ce qui est l’âme provençale. Ouverture et retenue, goût pour le travail bien fait, plaisir aux rencontres respectueuses.
Bravo.
Enzo le Provençal.
C’était simple, c’était bon…amusant cette référence à Monsieur de Galliffet. En effet certains silences peuvent être des Miserere.
C est quoi le gars qui fait les cornes ?,le diable se cache dans les details
J’ai découvert ce village récemment le récit est d’une grande justesse, je croyais lire du Pagnol.merci pour cette lecture
Je ne peux qu’approuver. Ce lieu est un bonheur de tranquillité et d’accueil chaleureux.
La cuisine sans prétention vaut le détour et elle est servie avec un sourire.
Si vous préférez prendre un verre en face,Chez Ton Père, l’accueil sera identique.
Cela sent bon la Provence , la vraie …
De la générosité avec un accueil sympathique repas sans prétention mais excellent bravo a l équipe continuer a bientôt