Canterbury. Le 7 juillet dernier. Une messe romaine fut dite dans la cathédrale-mère de l’anglicanisme. Cette phrase eût paru absurde au XVIe siècle. Elle eût été jugée sacrilège au XVIIe. Elle eût encore choqué au XIXe. Aujourd’hui, elle glisse, sans bruit, dans le flux des dépêches. L’événement, pourtant, est d’un poids de granit : pour la première fois depuis la Réforme, le rite latin a retrouvé la nef de l’Angleterre révoltée. La messe fut célébrée à l’occasion de la fête de la translation des reliques de Thomas Becket, martyr du XIIe siècle, archevêque tranché en plein sanctuaire par les sbires de son roi.
Trois jours plus tard, à quelques encablures de là, l’église anglicane de St Dunstan annonçait sa volonté d’exhumer la tête de saint Thomas More, autre figure décapitée pour avoir tenu son âme droite face à la volonté royale. Becket fut tué par excès de fidélité à Rome. More le fut pour avoir refusé de renier Rome. L’un et l’autre, aujourd’hui, reviennent à la lumière. On réclame leurs crânes, leurs os, leurs poussières. On veut les mettre sous verre, dans des châsses, pour les vénérer. Les reliques s’éveillent. Les morts parlent.
Que nous dit cette résurgence ? Rien de moins que ceci : l’oubli guette ceux qui refusent l’incarnation. Et le protestantisme, dans sa haine de la chair sacrée, a creusé sa propre fosse mémorielle.
Les figures réformées se sont dissipées comme des esprits trop éthérés. Calvin dort quelque part sous un gazon anonyme ; Knox est une plaque au sol qu’un automobiliste piétine ; Zwingli, mort sur un champ de bataille, a disparu corps et biens. Leurs noms ne sont plus que titres de rues ou sujets de colloques. Ils ne suscitent ni dévotion ni souvenir. L’âme protestante, qui s’était voulue pure, a fini par devenir légère, au double sens du mot.
Rome, elle, ne laisse pas mourir ses morts. Elle les incorpore, les encense, les sanctifie. Elle sait que le corps est l’ancre du souvenir. Le catholicisme ne pense pas : il sculpte. Il n’argumente pas : il chante. Il enterre ses martyrs sous l’autel, les vénère, les ressort à la lumière lorsque le temps l’exige. Il agit en stratège des siècles. Ce que la modernité nomme superstition, Rome l’appelle fidélité.
On peut ne pas aimer cela. On peut s’en gausser. Mais cela dure.
La Réforme, en chassant les saints, a perdu la mémoire. Elle a détruit les statues et laissé le vide. Elle a nié les reliques et aboli les pèlerinages. Elle a désincarné le culte, et avec le culte, l’histoire. Le protestantisme a voulu purifier la foi. Il a stérilisé le souvenir. Il a préféré la lecture à la procession, le texte au geste, le sermon à l’encensoir. Résultat : les temples sont devenus des bibliothèques, puis des musées, puis des logements.
Genève, ville sainte du calvinisme, offre aujourd’hui l’exemple d’un oubli bien tenu. Il y reste des pierres, certes, et même quelques temples, mais l’âme s’est retirée. Le visiteur passe, indifférent. Le culte a laissé place à la conférence. Le sacré au mobilier scandinave. À Canterbury comme à Wittenberg, les lieux protestants se vident, non faute de foi seulement, mais faute de souvenir.
La tête de Thomas More, par sa fille Margaret, fut sauvée pour l’éternité. Son crâne, porté dans un coffret de plomb, gît depuis cinq siècles dans une niche murée. On l’a oublié, puis on s’en est souvenu. On songe à l’exhumer, à le sécher, à l’exposer. On discute, même, de ce qu’il convient de faire du reste de mandibule. Voilà l’Église catholique : elle veille sur ses os comme sur ses dogmes. Elle comprend ce que les modernes ont désappris : que la mémoire s’attache à ce que l’on peut toucher.
C’est là son génie : elle fait de l’histoire un organe. Elle conserve dans ses cryptes des arguments qui enrichissent sa théologie. Elle fait parler les morts. Et cela suffit, souvent, à ramener les vivants.
Ernst Jünger écrivait que le souvenir est une forme d’énergie. Le catholicisme, malgré ses rides, en déborde encore. Il a perdu des batailles, mais jamais le fil du récit. Le protestantisme, lui, a gagné un temps l’État, puis les mœurs, puis le silence.
— Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



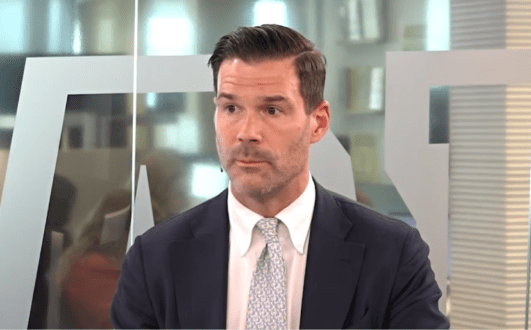
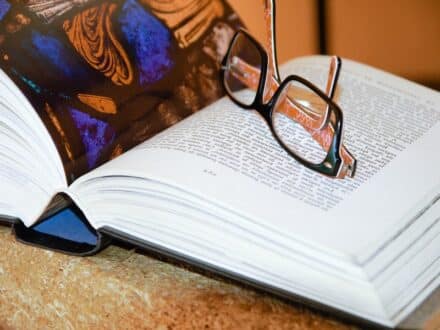

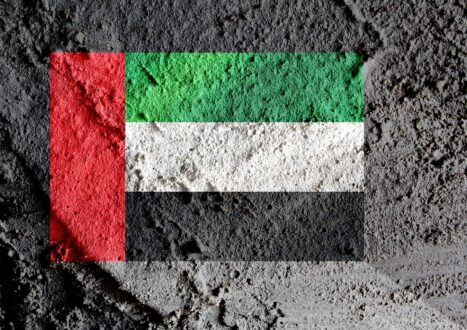


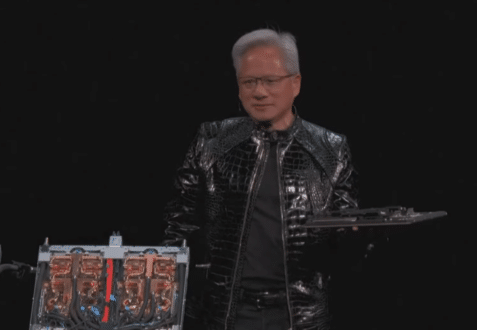




5 réponses à “La cendre des réformés. Sur l’oubli des églises protestantes et la puissance mnésique de Rome”
Le poste d’ observation de l’auteur, peut-être extérieur à l’Eglise, n’ empêche rien de la qualité de son article, ne gêne pas la finesse de sa remarque centrale : l’ Incarnation est l’ » outil » par lequel le chrétien va au divin.
Remarquable »papier « .
Oui.. Et des « évêques », prêtres anglicans deviennent catholiques (Benoît XVI a créé un ordinariat, qui garde et valorise ce que la haute Église avait gardé des traditions liturgiques catholiques chant; office divin des heures.. )…
Cette célébration n’ est-elle pas aussi signe d’espérance envoyé aux anglicans désabusés: il reste une porte, et ouverte?
Les martyrs meurent sans haine ni désir de revanche politico-culturelle…Ils deviennent les pierres vives d’une réconciliation possible…
Me souviens d’une année où Charles, encore prince, se vit interdire par sa mère d’aller voir le.pape comme il le souhaitait..
il y vint comme roi, peu de jours avant la mort de François qu’il fut un des derniers à rencontrer.
Newman fut canonisé en Angleterre même par le pape Benoît.. Lui qui écrivit les étapes de son retour à l’Église; susceptible d’en aider plus d’un..
Signes discrets; et signes profondément ancrés..
Cette célébration alors que le siège du primat anglican est vacant…Et sur démission; par manquement reconnu à la justice morale…
Tiens don Balbino a quitté sa table au Bar de l’Océan!!! Chez moi nous n’avons jamais compris la raison de ces querelles religieuses sinon que c’était une façon de tenir tête au Roi! Ce fut le cas des Rohan chez nous. Henri VIII bouffi de graisse rongé par les maladies vénériennes il pourrissait sur pied! Pour lui s(opposer à Rome.
Quoique ayant du retard dans mes lectures je tiens à remercier M. Balbino Katz pour son article qui, outre d’être précis et riche en Histoire, murmure avec la Poésie ! Merci
Bambino, je crois que vous confondez l’Église catholique avec la secte moderniste. Vous savez, même les anglicans (la Hight Church) alors qu’ils miment l’Église catholique n’en deviennent pas moins catholiques pour autant. Idem pour les modernistes. Ils peuvent toujours nous faire croire qu’ils vénèrent les reliques des saints, il n’empêche qu’ils leur crachent dessus en mettant Luther au pinacle ou en tentant de nous persuader qu’on peut se sauver dans toutes les religions. Poubelle le modernisme !
Mais vous avez une belle plume autrement.