Longtemps, l’histoire de la Bretagne s’est racontée à travers ses ducs, figures guerrières et politiques. Mais dans l’ombre des couronnes et des épées, un autre pouvoir pesait sur le destin du duché : celui des évêques. L’étude universitaire de Laetitia Barou-Guichet parue en 2001, Les évêques et le pouvoir ducal en Bretagne sous les Premiers Montforts éclaire ce rôle méconnu, où la crosse pouvait peser presque autant que le sceptre.
Des pasteurs… et des seigneurs
Au Moyen Âge, l’évêque n’était pas seulement un homme d’Église. Dans la Bretagne des XIᵉ à XVᵉ siècles, il cumulait les rôles : chef spirituel, seigneur terrien et conseiller politique.
Installés à la tête des diocèses, ils siégeaient dans les conseils ducaux, arbitraient les conflits entre seigneurs, levaient des troupes si nécessaire et géraient un patrimoine considérable. Châteaux, terres, dîmes et péages assuraient leur richesse et leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs laïcs.
Si les ducs de Bretagne pouvaient compter sur les évêques pour consolider leur autorité – en légitimant leurs décisions ou en mobilisant les réseaux ecclésiastiques –, la relation n’était pas toujours paisible. Les tensions éclataient lorsque le pouvoir ducal tentait de s’immiscer dans les affaires religieuses, notamment pour imposer ses candidats à un siège épiscopal ou s’approprier des revenus de l’Église.
À l’inverse, certains prélats n’hésitaient pas à s’opposer au duc, voire à se tourner vers le roi de France pour défendre leurs intérêts. Dans un duché jalousement indépendant, ces manœuvres faisaient parfois grincer des dents.
Diplomates et acteurs de la guerre
L’étude rappelle que plusieurs évêques ont joué un rôle direct dans les grands événements militaires ou diplomatiques. On les retrouve à la table des négociations lors de traités de paix, dans les délégations envoyées à la cour de France ou d’Angleterre, et même sur le terrain en période de guerre.
Pendant la guerre de Succession de Bretagne (1341-1364), leur position – soutenir un camp ou tenter de concilier – pouvait influer sur l’issue des alliances.
L’influence des évêques reposait aussi sur des bases solides :
- la perception des dîmes agricoles,
- les droits seigneuriaux sur de vastes terres,
- la justice qu’ils rendaient sur certaines zones,
- et le contrôle d’activités économiques stratégiques comme les foires ou les marchés.
Ces ressources leur permettaient de financer la construction de cathédrales, de soutenir les pauvres… mais aussi de peser dans les luttes politiques.
À la fin du Moyen Âge, avec l’union de la Bretagne et de la France, l’équilibre bascule. Les mariages d’Anne de Bretagne avec Charles VIII puis Louis XII, puis l’intégration du duché au royaume, donnent au pouvoir royal la main sur les nominations épiscopales. Les évêques deviennent alors des relais de la politique du roi, au détriment de l’ancienne autonomie bretonne.
Leur rôle reste important dans la vie locale, mais ils ne sont plus ces contrepoids politiques que craignaient – ou courtisaient – les ducs.
En filigrane, cette étude rappelle que la Bretagne médiévale ne se résume pas à un affrontement entre barons et princes. L’autorité religieuse et l’autorité ducale se mêlaient, parfois alliées, parfois rivales, dans un jeu d’influence constant. Les évêques, figures à la fois spirituelles et politiques, ont façonné l’histoire du duché autant que les souverains qu’ils conseillaient… ou défiaient.
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine











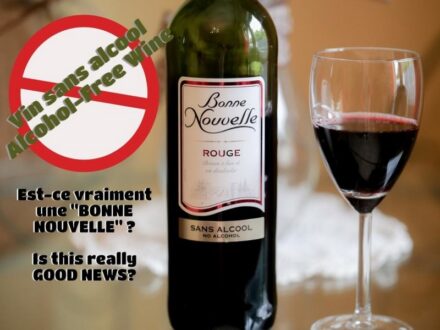


2 réponses à “Bretagne médiévale : quand les évêques partageaient le pouvoir avec les ducs”
Les clowns épiscopaux étaient inféodés à Tours et Tours obéissait au roi de France (mais d’abord à Rome car le moindre pet était rapporté à Rome!) Pierre de Dreux qui fut sorti de son couvent comme Edouard le Confiseur ne connaissait que trop ces escrocs de la « Sainte » Religion d’où son appétence pour les mettre au pas mais ils eurent le dernier mot! Un modèle à suivre, ah Maison de Dreux…
Les clowns épiscopaux étaient inféodés à Tours et Tours obéissait au roi de France (mais d’abord à Rome car le moindre pet était rapporté à Rome!) Pierre de Dreux qui fut sorti de son couvent comme Edouard le Confiseur ne connaissait que trop ces escrocs de la « Sainte » Religion d’où son appétence pour les mettre au pas mais ils eurent le dernier mot! Un modèle à suivre, ah Maison de Dreux…
And another one!