En 1609, la province basque du Labourd est le théâtre de la plus meurtrière chasse aux sorcières en France. Près de quatre-vingts personnes sont brûlées vives après un procès itinérant de quatre mois mené par Pierre de Lancre, juge du Parlement de Bordeaux, et Jean d’Espagnet. Un documentaire de Marie Thiry revient sur cet épisode dramatique, en explorant les mécanismes qui ont conduit à cette vague de persécutions.
D’une querelle locale à une répression brutale
À l’origine, Henri IV envoie ses magistrats pour régler un simple conflit autour des revenus du nouveau port de Ciboure. Mais très vite, l’affaire prend une tournure inattendue : de village en village, les accusations de sorcellerie se multiplient, alimentées par la peur, les rivalités locales et l’autorité des juges.
Le tribunal itinérant met en place une mécanique implacable : dénonciations, aveux forcés sous la torture, mise en scène des procès.
L’action des juges s’inscrit dans un contexte où la croyance au diable et aux sabbats est renforcée par des textes influents, comme le Malleus Maleficarum de 1486. Ces ouvrages, largement diffusés grâce à l’imprimerie, servent de référence et légitiment les excès judiciaires.
Au Labourd, contrairement à d’autres régions, de nombreuses jeunes filles sont visées, accusées de participer aux sabbats et de pactiser avec le démon.
Une chasse aux sorcières qui suscite des résistances
Pierre de Lancre va jusqu’à instrumentaliser des enfants, contraints à témoigner contre leurs proches. Mais son zèle finit par inquiéter : le retour des marins pêcheurs de Terre-Neuve et l’intervention de l’évêque de Bayonne contribuent à freiner cette spirale d’accusations. L’épisode marque durablement la mémoire locale et illustre les dérives possibles d’une justice instrumentalisée par la peur.
La réalisatrice Marie Thiry s’appuie sur des entretiens avec historiens, archivistes et chercheurs, de Bayonne à Strasbourg, ainsi que sur des extraits de films (Les Sorcières d’Akelarre, 2020 ; La Sorcellerie à travers les âges, 1922).
Reconstitutions, séquences animées et gravures d’époque viennent illustrer cette enquête rigoureuse sur un des épisodes les plus sombres de la Renaissance française.
Au-delà du récit, ce documentaire met en lumière la logique implacable qui pouvait conduire, en quelques semaines, une population à basculer dans la peur et la dénonciation, jusqu’à provoquer la mort de dizaines de personnes. Quatre siècles plus tard, cet épisode rappelle combien la croyance, la peur et la justice expéditive pouvaient transformer une querelle locale en tragédie collective.
Crédit photo : DR
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



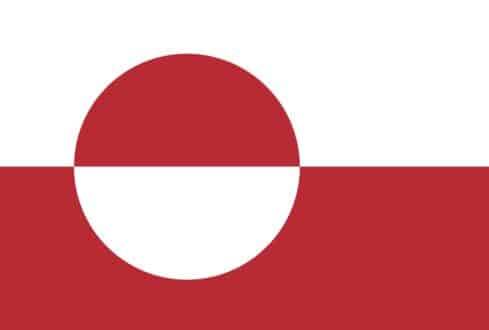

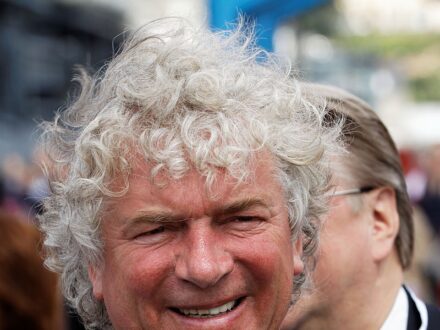








7 réponses à “1609, la chasse aux sorcières du Pays basque : un documentaire plonge dans la folie démonologique”
Remarques:
– cela se passe plus de cent ans après la fin « officielle » du moyen-âge
– l’Église intervient pour juguler cette folie meurtrière
– la cause première de l’intervention d’un juge est un problème d’argent
Par ailleurs:
Les conciles d’Elvira (306 après J.-C.), d’Ancyre (314 après J.-C.) et in Trullo (692 après J.-C.) ont imposé certaines pénitences ecclésiastiques pour le culte du diable. Cette approche modérée a représenté le point de vue de l’Église pendant de nombreux siècles. La volonté générale du clergé de l’Église catholique d’endiguer le fanatisme en matière de sorcellerie et de nécromancie est illustrée par les décrets du concile de Paderborn qui, en 785, a explicitement interdit de condamner des personnes en tant que sorcières et a condamné à mort quiconque brûlait une sorcière. Le code lombard de 643 après J.-C. stipule ce qui suit: « Que personne n’ait la prétention de tuer une servante étrangère comme sorcière, car cela n’est pas possible et ne doit pas être cru par les esprits chrétiens. »
Le principe général était que la chasse aux sorcières était interdite car les sorcières, c’est à dire les « personnes auxquelles on attribue des pouvoirs surnaturels et en particulier la faculté d’opérer des maléfices avec l’aide du diable ou de forces malfaisantes » n’existent pas. Non seulement la tentative de pratiquer de telles choses, mais la croyance même en leur possibilité, est traitée par l’Église comme fausse et superstitieuse. En 1258, le pape Alexandre IV a déclaré que l’Inquisition ne s’occuperait pas des cas de sorcellerie à moins qu’ils ne soient liés à l’hérésie. Bien que le pape Jean XXII ait ensuite autorisé l’Inquisition à poursuivre les sorciers en 1320, les tribunaux inquisitoriaux ont rarement traité de la sorcellerie, sauf de manière incidente lorsqu’ils enquêtaient sur l’hétérodoxie.
Saint Bernardin de Sienne dit dans un sermon en 1427 sur les pratiques de sorcellerie la chose suivante « L’une d’elles a dit et avoué, sans aucune pression, qu’elle avait tué trente enfants en les saignant… [et] elle a avoué davantage, en disant qu’elle avait tué son propre fils… Répondez-moi: vous semble-t-il vraiment que quelqu’un qui a tué vingt ou trente petits enfants de cette manière s’en est si bien sorti que, lorsqu’il sera finalement accusé devant le tribunal, vous devrez lui venir en aide et implorer la pitié pour lui? » Ainsi la lute contre les crimes associés aux pratiques de sorcellerie justifieront des enquêtes approfondies.
Le procès de Jeanne d’Arc est peut-être le procès de sorcières le plus célèbre de l’histoire. Bien que le procès ait été motivé par des considérations politiques et que le verdict ait été annulé par la suite, la position de Jeanne en tant que femme et accusée de sorcellerie a joué un rôle important dans son exécution. La punition de Jeanne, qui a été brûlée vive (les victimes étaient généralement étranglées avant d’être brûlées), était réservée uniquement aux sorcières et aux hérétiques.
La résurgence de la chasse aux sorcières à la fin de la période médiévale, avec le soutien au moins partiel ou la tolérance de l’Église, s’est accompagnée d’un certain nombre de développements dans la doctrine chrétienne, par exemple la reconnaissance de l’existence de la sorcellerie en tant que forme d’influence satanique et sa classification en tant qu’hérésie. À mesure que l’occultisme de la Renaissance gagnait du terrain parmi les classes cultivées, la croyance en la sorcellerie, qui, à l’époque médiévale, faisait au mieux partie de la religion populaire de la population rurale sans instruction, était intégrée dans une théologie de plus en plus complète de Satan en tant que source ultime de tous les maléfices.[Ces changements doctrinaux ont été achevés au milieu du 15e siècle, en particulier dans le sillage du concile de Bâle et centrés sur le duché de Savoie dans les Alpes occidentales, conduisant à une première série de procès de sorcières par les tribunaux séculiers et ecclésiastiques dans la seconde moitié du 15e siècle.
En 1484, le pape Innocent VIII publie Summis desiderantes affectibus, une bulle papale autorisant à « corriger, emprisonner, punir et châtier » les adorateurs du diable qui ont « tué des nourrissons », entre autres crimes. Il le fait à la demande de l’inquisiteur Heinrich Kramer, à qui les évêques locaux d’Allemagne avaient refusé l’autorisation d’enquêter, mais des historiens comme Ludwig von Pastor insistent sur le fait que la bulle ne permettait rien de nouveau et n’était pas nécessairement contraignante pour les consciences catholiques. Trois ans plus tard, en 1487, Kramer publie le tristement célèbre Malleus Maleficarum (littéralement « Marteau contre les malfaiteurs ») qui, grâce aux presses à imprimer nouvellement inventées, jouit d’un large lectorat. Il a été réimprimé en 14 éditions jusqu’en 1520 et est devenu indûment influent dans les tribunaux séculiers.
Les chasses aux sorcières se sont alors déchaînées, principalement en terres protestantes… et cela jusqu’au milieu du XVIII ème siècle. On estime à environ 35000 les personnes condamnées pour sorcellerie dans la période 1520 – 1735, dont l’essentiel en Allemagne.
Habitant le Pays Basque et connaissant bien cette histoire , je trouve votre article malhonnête et qui reprend les affirmations gauchisantes des historiens. Henri IV , roi de France et de Navarre reçoit un grand nombre de plaintes provenant du pays Basque , des Landes et du Béarn concernant des affaires de » sorcellerie » . Des personnes provenant d’Espagne se sont réfugiés au Pays Basque On les appelle les cascarots ou Kaskarots. Déjà du temps de Philippe le Bel des bohémiens étaient venus s’installer et avaient posé des problèmes .Les plaintes sont nombreuses , vols , viols , jeteurs de sorts , escroqueries , prostitution , et les plaintes remontent jusqu’à Henri IV . Il nomme Pierre de Lancre qui fait un travail remarquable et élimine les personnes dangereuses . D’ailleurs le calme reviendra aussitôt !
Ventre saint gris Urbain Grangier qu’en penses-tu? Même les pourritains ont leurs sorcières de Salem avaient-ils déjà des cases de vides et des courants d’air? Conservons la Raison de nos maîtres Montesquieu et Voltaire. Et comme Rutebeuf et Villon laissons donc la jeunesse vaquer comme les dames catins de Bordeaux et d’ailleurs!
Les parlements étaient souvent des repaires d’obscurantistes. Leur suppression par Louis XV fut une mesure de salubrité publique. Louis XVI, hélas, les rappela, ce qui lui fut fatal…
@pierre : on t’a perdu… Ta réponse est si longue. N’est pas Ken Follet qui veut, désolé 🤭
Totalement d’accord avec Asinus, Sa Majesté Louis XV avait pris une juste et saine mesure.
Bonjour,
Et Lola, a-t-elle été tuée par une sorcière ? Vu que notre système judiciaire a déclaré Dabiah responsable, c’est bien à croire que oui. Comme quoi rien de neuf sous le soleil.
Cdt.
M.D