À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre 2025, plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées au manoir de La Motte, à Saint-Brieuc-des-Iffs (Ille-et-Vilaine), pour participer à un chantier peu commun : la restauration du dernier four à chanvre de Bretagne.
Encadrée par l’association Tiez Breiz – Maisons et Paysages de Bretagne, l’opération a permis de consolider ce bâtiment dont les fondations remontent au XVIIe siècle. Les fissures de ses murs en bauge ont été comblées, la base en pierre renforcée et une structure en chêne posée. De quoi prolonger la vie de ce témoin d’une époque où le chanvre occupait une place centrale dans l’économie bretonne.
Une filière historique au cœur de la Bretagne
Du XVIe au XIXe siècle, la culture et la transformation du chanvre ont largement contribué à la prospérité régionale, notamment grâce à la fabrication des toiles. Le four restauré à Saint-Brieuc-des-Iffs rappelle cette mémoire économique et agricole.
Le chantier a attiré des profils variés : passionnés de techniques traditionnelles de construction, curieux venus découvrir l’histoire de ces fours, mais aussi étudiants du master Restauration et réhabilitation du patrimoine bâti et des sites (Rennes 2) et jeunes diplômés de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB). Tous ont travaillé aux côtés de bénévoles aguerris et de représentants associatifs impliqués dans la sauvegarde du bâti ancien et des filières biosourcées.
Soutiens et rencontres autour du projet
La mobilisation a aussi attiré l’attention des élus et des institutions : le maire de Saint-Brieuc-des-Iffs, Rémi Couet, ainsi qu’Élisabeth Loir-Mongazon, cheffe du service régional de l’inventaire du patrimoine, se sont déplacés pour constater l’avancée des travaux.
Les propriétaires du manoir de La Motte ont salué le dynamisme de Tiez Breiz et l’esprit collectif qui a animé le chantier : « Au-delà de la restauration, c’est une part précieuse de notre mémoire collective qui a été préservée. »
50 ans d’engagement de Tiez Breiz
Fondée en 1975, l’association Tiez Breiz fête cette année ses 50 ans. Avec plus de 700 adhérents, elle poursuit son action en faveur de la connaissance et de la mise en valeur de l’architecture et des paysages ruraux bretons. Ses moyens d’action vont de l’accompagnement technique aux formations, en passant par l’organisation de chantiers participatifs tels que celui de Saint-Brieuc-des-Iffs.
Ce dernier four à chanvre, désormais consolidé, n’est pas seulement une relique : il devient un symbole de transmission et de rencontres, témoignant de la vitalité du patrimoine rural breton et de ceux qui œuvrent à sa sauvegarde.
Le four à chanvre : mémoire d’un savoir-faire paysan oublié
Avant d’être un produit controversé, le chanvre fut pendant des siècles une culture essentielle dans de nombreuses régions françaises. On l’utilisait pour fabriquer cordages, voiles, tissus, huile ou litière. Mais avant d’être filée, la fibre devait subir plusieurs étapes de transformation : rouissage, séchage, broyage et peignage. C’est à cette étape cruciale du séchage qu’intervenait le four à chanvre, une construction aujourd’hui tombée dans l’oubli, mais encore visible dans nos campagnes.
Dans un premier temps, le séchage du chanvre se faisait dans les fours à pain. Rapidement, on a construit des bâtiments spécifiques, mieux adaptés à cette opération longue et délicate. Car une fibre mal séchée devenait cassante et inutilisable.
Ces fours jalonnent encore les paysages de la Sarthe, de l’Orne, de la Mayenne, de Touraine ou de Charente. Leur implantation dépendait des habitudes locales : en Sarthe, ils étaient souvent isolés, à l’écart des habitations, pour éviter les nuisances des fumées. En Touraine, on les trouvait parfois accolés aux maisons.
Les fours à chanvre, ronds ou carrés, se distinguaient par leur robustesse. Construits en pierre, en grès roussard ou en brique, ils mesuraient généralement 3 à 4 mètres de diamètre pour 4 à 5 mètres de hauteur. Certains étaient recouverts d’un enduit de sable et de chaux pour mieux retenir la chaleur.
Leur toiture, conique, à pans ou en pavillon selon les régions, dépassait largement des murs afin de protéger les enduits. En Touraine, on trouvait parfois des fours intégrés à un pigeonnier, preuve de l’ingéniosité paysanne qui combinait les usages.
À l’intérieur, deux niveaux :
- Au rez-de-chaussée, la chambre de chauffe, où l’on installait un brasier de coke dans une corbeille en fonte. Le coke avait l’avantage de dégager une chaleur constante sans flamme directe.
- Au premier étage, la chambre du chanvre, haute de près de trois mètres, où l’on plaçait les bottes sur une claie ou suspendues.
Entre les deux, un plancher à claire-voie permettait à la chaleur et à la fumée de circuler vers les fibres.
Le processus demandait patience et rigueur. Les bottes de chanvre étaient introduites par la porte haute et disposées sur la grille. Dans la chambre basse, on entretenait un feu de coke ou de fagots pendant une dizaine d’heures, généralement la nuit, à une température d’environ 60°C.
La chaleur montait, traversait les fibres et s’échappait ensuite par le toit ou par de petites ouvertures, appelées lucarnons, percées dans les murs. Le séchage terminé, la fibre pouvait être broyée puis peignée, prête à être transformée en fil.
Aujourd’hui, nombre de ces fours sont à l’abandon, engloutis par la végétation ou réemployés comme remises agricoles. Mais certains ont été restaurés, notamment grâce à l’action d’associations de sauvegarde du patrimoine rural, comme Maisons Paysannes de la Sarthe.
Ces bâtiments modestes rappellent une époque où le chanvre structurait la vie économique des villages. Chaque commune, chaque hameau avait son four, parfois partagé entre plusieurs familles. Leur silhouette, ronde ou carrée, reste un marqueur de nos campagnes, au même titre que les moulins ou les lavoirs.
Redécouvrir les fours à chanvre, c’est rappeler que nos ancêtres maîtrisaient une filière complète, de la culture au filage. C’est aussi se souvenir que le chanvre, bien avant d’être associé à des débats contemporains, fut une ressource écologique avant l’heure : local, durable, polyvalent.
Crédit photo : DR
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine












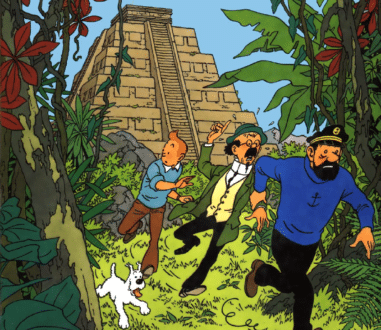

2 réponses à “Saint-Brieuc-des-Iffs : le dernier four à chanvre de Bretagne sauvé grâce à un chantier participatif”
Le rédacteur de cet article, pourtant long, réussit l’exploit de ne pas dire un mot sur ce qu’était un four à chanvre, à quoi ça servait et comment ça fonctionnait… En revanche de l’administratif, de l’associatif, etc : à foison !
c’est dans le dernier paragraphe comment le faire et à quoi ça sert