La plateforme Netflix continue de creuser le sillon du true crime avec sa série d’anthologie Monstre, signée Ryan Murphy et Ian Brennan. Après un démarrage tonitruant consacré à Jeffrey Dahmer, puis une seconde saison décevante sur les frères Menendez, voici le troisième volet, centré sur Ed Gein, le « boucher de Plainfield ». Un nom qui, s’il évoque moins de choses en France qu’un Ted Bundy ou qu’un Charles Manson, hante pourtant la culture américaine et a inspiré certaines des œuvres les plus marquantes du cinéma d’horreur. Autant dire que la matière était là. Pourtant, le résultat est une dégringolade spectaculaire, où l’ennui le dispute à la complaisance visuelle.
Dahmer, sommet de l’anthologie
Difficile de ne pas comparer cette saison à la première, consacrée à Jeffrey Dahmer. Portée par un jeu habité d’Evan Peters, la série avait réussi à imposer une atmosphère oppressante, tout en questionnant le rôle des institutions américaines dans la carrière sanglante du tueur de Milwaukee. Certes, le programme avait suscité des polémiques, notamment du côté des familles de victimes. Mais en termes de narration et d’efficacité, le coup était réussi : Netflix avait frappé un grand coup.
Avec les frères Menendez, accusés d’avoir assassiné leurs parents dans la riche banlieue de Beverly Hills, le souffle retombait. L’affaire, déjà surexposée dans les médias américains, n’offrait pas la même intensité dramatique. Reste que la saison se laissait regarder. Avec Ed Gein, on touche le fond.
Un criminel devenu mythe macabre
Arrêté en 1957 après la disparition de Bernice Worden, Gein a laissé une empreinte cauchemardesque. On découvrit alors, dans sa ferme isolée du Wisconsin, un véritable cabinet de curiosités macabres : des crânes transformés en bols, des chaises recouvertes de peau humaine, des organes conservés dans des bocaux, sans oublier une « seconde peau » façonnée à partir de cadavres féminins déterrés dans les cimetières alentour.
Ce tableau d’horreur a nourri l’imaginaire des cinéastes. Alfred Hitchcock s’en inspira pour Psychose (1960), Tobe Hooper pour Massacre à la tronçonneuse (1974), Jonathan Demme pour Le Silence des agneaux (1991). Ed Gein est devenu, malgré lui, une matrice culturelle : la figure du tueur solitaire, vivant sous l’emprise d’une mère castratrice, enfermé dans un univers sordide où la folie se mue en rituel.
Il y avait là de quoi réaliser une série sombre, fascinante, explorant la frontière entre crime, société et imaginaire collectif. Mais Ryan Murphy choisit une autre voie : celle du délire formel.
Quand la mise en scène étouffe le récit
Dès les premiers épisodes, la série accumule les partis pris de mise en scène : coupures incessantes, allers-retours avec des films cultes, brèches méta où Ed Gein s’adresse presque au spectateur. L’intention est claire : montrer comment l’histoire du criminel a été digérée, transformée, instrumentalisée par Hollywood. Sur le papier, l’idée est séduisante. À l’écran, elle devient lourde et artificielle.
Plutôt que d’explorer la psychologie de Gein ou l’Amérique rurale des années 1950, le récit se perd dans des séquences étirées, complaisantes, où la caméra s’attarde sans fin sur des détails glauques. La violence devient décor, le sordide spectacle. À force de vouloir « dénoncer » le voyeurisme du public, la série en fait sa raison d’être.
Le choix de confier le rôle de Gein à Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) pouvait intriguer. L’acteur, habitué aux rôles charismatiques, apporte une certaine prestance. Mais la direction d’acteurs hésite constamment : Gein apparaît tour à tour comme un homme frustre et pathétique, puis comme une figure presque glamourisée. Ce flou dessert le récit. Le spectateur ne sait jamais s’il doit être horrifié, compatissant ou simplement dégoûté.
Cette ambiguïté aurait pu nourrir une réflexion subtile sur la construction des monstres dans la culture américaine. Elle se réduit ici à un effet de surface, un brouillage de ton qui finit par lasser.
Le plus frustrant reste le gâchis. Ed Gein est un personnage historique hors norme, dont la trajectoire interroge la solitude, la religion, la famille et la violence enfouie dans l’Amérique profonde. Le relier à son héritage cinématographique – Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Le Silence des agneaux – aurait pu donner une fresque puissante sur la manière dont le cinéma recycle le crime pour nourrir l’imaginaire collectif.
Mais à trop vouloir être « intelligent » et démonstratif, Monstre : Ed Gein se perd en route. Là où la première saison oppressait et captivait, celle-ci ennuie et agace.
Une anthologie en perte de vitesse
Avec cette troisième saison, la franchise Monstre semble avoir perdu son cap. La mécanique du true crime, lorsqu’elle n’est pas nourrie par une écriture solide et une mise en scène rigoureuse, tourne vite à vide. Et Netflix, en misant sur le choc visuel et la complaisance morbide, prend le risque d’épuiser son filon.
Reste la question : fallait-il raconter encore une fois Ed Gein ? Sans doute. Mais il aurait fallu le faire autrement, avec plus de sobriété, plus d’épaisseur, moins de narcissisme de réalisateur. Car au bout du compte, ce que cette saison raconte le mieux, c’est l’impuissance d’une anthologie qui croyait tenir la recette miracle et qui, trois saisons plus tard, donne surtout l’impression de s’être perdue.
Verdict : un ratage. Ce Monstre-là ne fascine plus, il lasse.
YV
Illustration : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine..










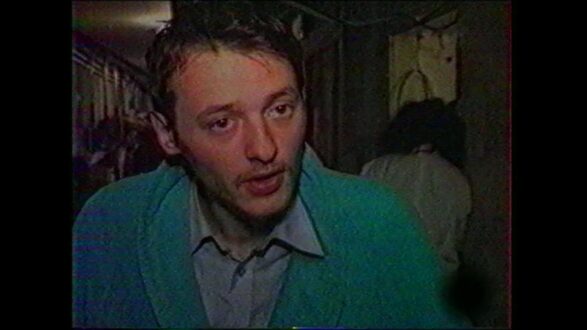



2 réponses à “« Monstre : Ed Gein » sur Netflix, quand la série vire au naufrage”
Mais pourquoi sanctifier toujours ces créatures perverses et maléfiques qui ne font que révéler ce qu’il y a de mauvais dans l’être humain? Dans l’Histoire de tous pays il y a de « grandes figures » qui devraient être données en exemple à toute cette jeunesse déboussolée et en recherche
Massacre à la tronçonneuse ce doit être le réalisateur Milei qui ne connaît pas la tondeuse du coiffeur pour avoir une coupe de cheveux digne du 3e RIMA.