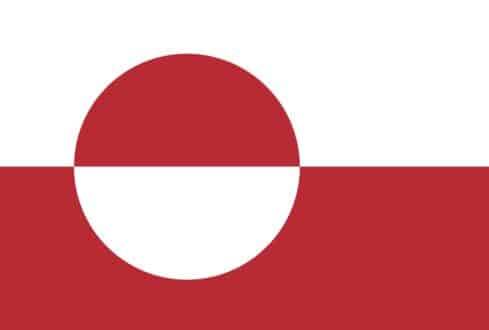Et si nous mesurions mal, depuis des années, le cœur de nos chiens au repos ? C’est l’hypothèse – solidement étayée – d’une vaste étude française conduite par la Pr Valérie Chetboul (École nationale vétérinaire d’Alfort/INSERM) avec une équipe d’ingénieurs : 703 chiens, 113 races, suivis pendant des mois à domicile, grâce à un collier biométrique qui enregistre automatiquement fréquence cardiaque (HR) et respiratoire (RR) lorsque l’animal est immobile. Résultat : les constantes « normales » relevées en clinique seraient… surestimées.
Des chiffres qui font tomber un dogme
Les manuels parlent volontiers d’un repos entre 70 et 120 battements/minute (voire plus pour les chiots). Or l’étude, menée en conditions réelles, retrouve des valeurs nettement plus basses :
- 78,5 bpm chez les chiots (≤ 12 mois)
- 59,1 bpm chez les adultes (1–10 ans)
- 68,7 bpm chez les seniors (≥ 10 ans)
Deux tendances se confirment : le cœur bat plus lentement la nuit (p < 0,0001) et plus le chien est grand, plus le rythme est bas (médiane 59,5 bpm > 20 kg contre 62,1 bpm ≤ 20 kg). Côté races, Golden Retrievers et Border Collies affichent des fréquences particulièrement basses, tandis que les Bergers Australiens respirent plus vite que la moyenne. Autre enseignement inédit : une saisonnalité opposée des courbes – la fréquence cardiaque décroît en étéquand la respiratoire grimpe, reflet probable de la thermorégulation.
Pourquoi ces écarts avec la « clinique » ?
Parce qu’un chien stressé au cabinet n’a pas le même cœur qu’un chien chez lui. Ici, le suivi est continu, non invasif, basé sur la sismocardiographie et des algorithmes d’IA embarqués (Biotracker GPS, Invoxia). Les mesures ne partent qu’au vrai repos (animal couché, immobile), captant la physiologie domestique plutôt que l’« effet blouse blanche ».
Au-delà de la révision des bornes « normales », l’étude ouvre la porte à l’alerte précoce. Cas parlant : un chien qui développera un œdème pulmonaire lié à une maladie valvulaire présente, des semaines avant les symptômes, une hausse silencieuse de sa fréquence cardiaque au repos – détectée par l’algorithme, invisible à la mesure ponctuelle. Demain, des seuils personnalisés pourraient aider le vétérinaire à anticiper une décompensation et ajuster plus tôt le traitement.
Méthode et garde-fous
- Cohorte : 703 chiens « apparemment sains », 29 pays, médiane de port du dispositif : 189 jours.
- Mesures : HR et RR uniquement au repos réel, de jour comme de nuit, sur des mois.
- Limites : statut « sain » déclaré par les propriétaires, pas d’examen systématique ; sous-représentation des très petits gabarits ; trois co-auteurs sont salariés du fabricant du collier (Invoxia), ce que l’article signale. Le dispositif ne remplace pas un Holter pour l’arythmie, mais il ajoute la respiration, absente des enregistreurs classiques.
Ce que ça change pour vous (et pour votre vétérinaire)
- Ne paniquez pas devant un chiffre « bas » pris à la maison : chez l’adulte, ~60 bpm au repos peut être parfaitement normal.
- Surveiller la tendance compte plus qu’un chiffre isolé : une montée progressive sur plusieurs semaines mérite un avis.
- La nuit est le meilleur moment pour des valeurs de référence stables.
- Taille et race influencent la ligne de base : comparez-vous… à vous-même.
Publiée en 2025 dans Frontiers in Veterinary Science (étude « AI-COLLAR », Chetboul et al., CC BY 4.0), cette base de données « du monde réel » pourrait amener la profession à recalibrer ses repères et intégrer davantage de télésuividans le suivi des cardiopathies canines. Un pas de plus vers une médecine vétérinaire préventive et personnalisée.
Illustration : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine..